
Acte de vente d'un logement existant
Dès que toutes les conditions pour la réalisation de la vente sont réunies, un acte de vente définitif est rédigé et signé chez un notaire. Le transfert de propriété est immédiat.
1- Contenu de l’acte
L'acte de vente doit mentionner les informations suivantes :
- Coordonnées du vendeur et de l'acheteur
- Adresse du bien
- Origine du bien (date du précédent acte de vente, nom du précédent propriétaire, acte notarié...)
- Descriptif détaillé du bien, de ses équipements et annexes
- Existence d'une hypothèque et/ou d'une servitude
- Prix de vente
- Modes de paiement (avec ou sans l'aide d'un prêt immobilier)
- Montant des honoraires de la personne chargée de la vente et à qui en incombe le paiement
- Date de disponibilité du bien
- Conditions suspensives lorsqu'il en existe
- Informations relatives à la copropriété
- Informations relatives aux conditions d'exercice du droit de réflexion quand il n'y a pas eu de promesse de vente
L'absence d'information sur le droit de réflexion est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale
- L'acte de vente doit obligatoirement être accompagné du dossier de diagnostics techniques immobiliers.
2- Délai de réflexion
Si le contrat n'est pas précédé d'une promesse de vente, l'acheteur dispose d'un délai de réflexion de 10 jours avant de signer l'acte de vente.
Le projet d'acte de vente est remis à l'acquéreur par lettre recommandée ou en main propre. Le délai de réflexion commence le lendemain de la 1re présentation de la lettre recommandée ou de sa remise en main propre.
En aucun cas, l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de 10 jours.
Si le dernier jour du délai de réflexion est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'au 1erjour ouvrable
Attention
Aucune somme ne peut être réclamée durant le délai de réflexion.
3- Signature de l'acte
L'acte authentiqueest obligatoirement établi par un notaire.
L'acte doit être signé par le vendeur et l'acquéreur. Quand l'un d'entre eux ne peut être présent, il peut se faire représenter en confiant à un tiers une procuration
Le notaire garde le seul original de l'acte, appelé la minute. Il enregistre l'acte de vente au fichier immobilier, situé au service de publicité foncière dont dépend le bien, et au cadastre. Cet enregistrement rend l'acte de vente opposable aux tiers
Le jour de la signature du contrat de vente, le notaire remet une attestation de propriété immobilière à l'acheteur.
L'acte de vente peut être signé sur support électronique, on parle d'un acte authentique électronique (AAE). Dans ce cas, le notaire prépare l'acte sur un logiciel de rédaction. Il joint l'ensemble des pièces annexes qu'il scanne. L'acte est lu sur écran par l'ensemble des parties et le notaire recueille électroniquement les signatures.
L'acheteur reçoit une attestation de propriété. À sa demande, il peut également obtenir la copie de l'acte par voie électronique.
L'AAE est envoyé automatiquement dans un minutier central (MICEN) établi et contrôlé par le Conseil supérieur du notariat. L'acte, ses annexes et les signatures de toutes les parties sont conservés dans un fichier.
La remise des clés à l'acquéreur se fait, en principe, à l'issue de la séance de signatures.
4- Notification de l'acte de vente
Le notaire conserve la minute. Après l'enregistrement auprès du service de publicité foncière, il remet la copie de l'acte de vente à l'acheteur, en main propre, par lettre recommandée avec avis de réception ou par commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire).
Cette copie revêtue des cachets de l'administration fiscale constitue le titre de propriété.
5- Règlement du prix de vente
Le jour de la signature de l'acte, l'acquéreur paye le prix indiqué dans le contrat, déduction faite du montant de la somme versée lors de la signature du compromis de vente.
En général, l'acheteur paye les frais de notaire.
Source : Service-Public.fr

Lorsque le vendeur et l'acheteur sont parvenus à un accord sur la vente d'un bien immobilier, ils peuvent signer une promesse de vente avant la signature de l'acte de vente définitif. Ce document n'est pas obligatoire, mais il est recommandé pour exprimer l'accord mutuel du vendeur et de l'acheteur. Il détermine les conditions précises dans lesquelles la vente du logement s'effectuera
La promesse de vente pour l'achat d'un logement existant peut prendre la forme
- Soit d'une promesse unilatérale de vente,
- Soit d'un compromis de vente (également appelé promesse synallagmatique de vente).
1- Définition d’un compromis de vente
Un compromis de vente peut être signé lorsque le vendeur et l'acheteur sont sûrs de vouloir conclure la vente du logement. Cet acte engage définitivement le vendeur et l'acheteur sauf s'il comporte une clause prévoyant, sous certaines conditions, un désistement de l'une ou des 2 parties.
Le compromis peut être réalisé sous 2 formes :
- Acte sous signature privée réalisé directement par le vendeur et l'acheteur ou avec l'appui d'un agent immobilier par exemple
- Acte authentiqueétabli par un notaire (obligatoire lorsque le vendeur est une personne physique et que la durée de validité du compromis dépasse 18 mois)
2- Définition d’une promesse unilatérale de vente
Une promesse unilatérale peut être signée lorsque l'acheteur n'est pas sûr de vouloir conclure la vente. Cet acte lui laisse la liberté de lever l'option ou non (c'est-à-dire d'acheter ou non le logement). Il réserve ainsi le logement pendant un délai clairement précisé. Le vendeur s'engage à ne pas vendre le logement à un autre acheteur.
La promesse unilatérale de vente peut être réalisée sous 2 formes :
- Acte sous signature privéeréalisé directement par le vendeur et l'acheteur ou avec l'appui d'un agent immobilier par exemple
- Acte authentique établi par un notaire (obligatoire lorsque le vendeur est une personne physique et que la durée de validité de la promesse dépasse 18 mois)
À compter de sa signature, une promesse unilatérale sous signature privée doit être enregistrée dans les 10 jours au service de l'enregistrement du vendeur ou de l'acheteur. Cet enregistrement sert à authentifier la promesse de vente.
Le vendeur et/ou l'acheteur peuvent soit déposer la promesse directement au service de l'enregistrement, soit l'envoyer par courrier simple ou recommandé.
3- Contenu d’une promesse ou compromis
La promesse de vente doit mentionner les coordonnées du vendeur et de l'acheteur.
La promesse de vente doit mentionner les informations suivantes :
- Adresse du bien
- Origine du bien (date du précédent acte de vente, nom du précédent propriétaire, acte notarié...)
- Descriptif détaillé du bien, de ses équipements et de ses annexes
- Existence d'une hypothèque et/ou d'une servitude
- La promesse de vente d'un logement en copropriété doit par ailleurs contenir les informations spécifiques à la copropriété.
La promesse de vente doit mentionner les informations suivantes :
- Montant des honoraires du professionnel chargé de la vente (s'il y a intervention d'un professionnel) et à qui en incombe le paiement
- Prix de vente et modalités de paiement (avec ou sans l'aide d'un prêt immobilier)
- Durée de validité de la promesse de vente et date limite de signature de l'acte de vente définitif
- Informations relatives aux conditions d'exercice du droit de rétractation : le manquement à cette obligation d'information est passible d'une amende d'un montant maximum de 15 000 €
- Date de disponibilité du bien
À savoir
Des clauses suspensives peuvent être inscrites dans la promesse de vente. Ainsi la vente ne pourra se réaliser que sous certaines conditions. Par exemple, il peut s'agir de l'obtention d'un certificat d'urbanisme opérationnel ou d'un permis de construire, de l'obtention d'un prêt immobilier ou encore de travaux à réaliser par le vendeur avant la vente.
La promesse de vente doit être accompagnée du dossier de diagnostic technique (DDT).
4- Notification d’une promesse
La promesse de vente peut être remise en main propre ou envoyée à l'acheteur par lettre recommandée avec avis de réception.
Elle doit être réalisée en 2 exemplaires originaux (1 pour le vendeur, 1 pour l'acheteur), excepté dans le cas où un original unique est conservé par un professionnel (notaire, agent immobilier).
5- Sommes à payer
De nombreux mécanismes d'indemnisation ou de contrainte, plus ou moins différenciés, peuvent être prévus dans une promesse de vente. Par exemple, il peut s'agir de l'astreinte (versement d'une indemnité par jour de retard, notamment dans le cas où le vendeur ne délivre pas le logement à la date prévue), ou du séquestre qui est un acompte sur le prix total.
Certains de ces mécanismes sont couramment utilisés et diffèrent suivant la forme de la promesse de vente.
- Dans un compromis de vente
Des clauses inscrites dans le compromis de vente peuvent prévoir le versement de sommes d'argent dès sa signature ou sous un délai déterminé.
Cependant, avant la fin du délai de rétractation, une demande de versement est autorisée si 2 conditions sont remplies. Le compromis doit être conclu par l'intermédiaire d'un professionnel mandaté pour contribuer à la vente (un notaire ou un agent immobilier par exemple). Aussi, le versement doit être consigné chez un professionnel ayant une garantie financière dédiée au remboursement des fonds déposés (recommandé même en l'absence de demande de versement avant la fin du délai de rétractation).
Sinon, le fait d'exiger, de recevoir un versement ou un engagement de versement avant la fin du délai de rétractation est puni d'une amende de 30 000 €.
À noter
Si l'acheteur exerce son droit de rétractation, le professionnel doit lui restituer les sommes versées sous 21 jours à compter du lendemain de la rétractation.
Le montant demandé à l'acheteur se situe en général entre 5 % et 10 % du prix de vente. Il est recommandé de le consigner chez un professionnel ayant une garantie financière dédiée au remboursement des fonds déposés. Il peut s'agir d'un agent immobilier ou d'un notaire. Sauf pour un versement pendant le délai de rétractation, ce n'est pas une obligation, mais cette consignation offre une meilleure garantie de restitution des fonds si nécessaire. À la signature de l'acte définitif, ce montant sera déduit du prix total de la vente quelle que soit la clause du compromis à l'origine du versement.
- Dans une promesse unilatérale de vente
Des clauses inscrites dans une promesse unilatérale de vente peuvent prévoir le versement de sommes d'argent dès sa signature ou sous un délai déterminé.
Cependant, avant la fin du délai de rétractation, une demande de versement est autorisée si 2 conditions sont remplies. La promesse doit être conclue par l'intermédiaire d'un professionnel mandaté pour contribuer à la vente (un notaire ou un agent immobilier par exemple). Aussi, le versement doit être consigné chez un professionnel ayant une garantie financière dédiée au remboursement des fonds déposés (recommandé même en l'absence de demande de versement avant la fin du délai de rétractation).
Sinon le fait d'exiger, de recevoir un versement ou un engagement de versement avant la fin du délai de rétractation est puni d'une amende de 30 000 €.
À noter
Si l'acheteur exerce son droit de rétractation, le professionnel doit lui restituer les sommes versées sous 21 jours à compter du lendemain de la rétractation.
Le montant demandé à l'acheteur se situe en général entre 5 % et 10 % du prix de vente. Il est recommandé de le consigner chez un professionnel ayant une garantie financière dédiée au remboursement des fonds déposés. Il peut s'agir d'un agent immobilier ou d'un notaire. Sauf pour un versement pendant le délai de rétractation, ce n'est pas une obligation, mais cette consignation offre une meilleure garantie de restitution des fonds si nécessaire. À la signature de l'acte définitif, ce montant sera déduit du prix total de la vente quelle que soit la clause de la promesse à l'origine du versement.
6- Rétractation
Le droit de rétractation permet à l'acheteur de réfléchir et renoncer à la vente en respectant un certain délai après la signature de la promesse.
Le vendeur est quant à lui engagé dès la signature de la promesse de vente. S'il conteste la vente, l'acheteur peut en demander l'exécution forcée devant le tribunal c'est-à-dire qu'il peut obliger le vendeur à lui délivrer le logement.
L'acheteur dispose de 10 jours calendaires : Correspond à la totalité des jours du calendrier de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre, y compris les jours fériés ou chômés pour renoncer à la vente.
Ce délai commence le lendemain de la 1re présentation de la lettre recommandée notifiant la promesse de vente ou de sa remise en main propre.
Si le dernier jour du délai de réflexion est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'au 1erjour ouvrable suivant.
L'acheteur doit notifier sa rétractation au vendeur par lettre recommandée avec avis de réception avant l'expiration du délai de 10 jours calendaires
Sources : Services public.fr
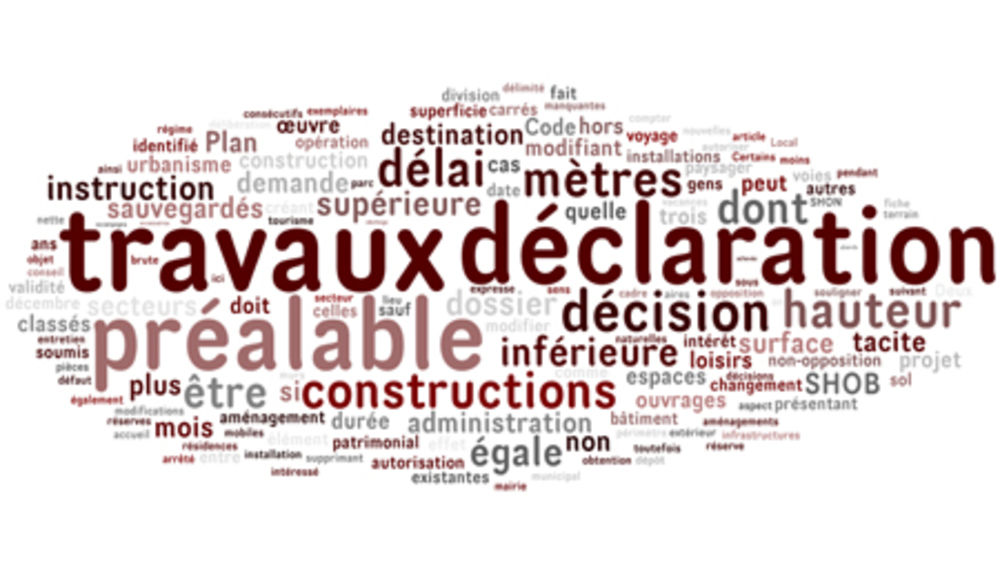
Une déclaration préalable de travaux (DP) est exigée pour des travaux qui ne sont pas soumis à un permis de construire. La DP peut être obligatoire pour l'agrandissement d'un bâtiment existant, pour des travaux modifiant son aspect extérieur ou pour changer sa destination (une grange devenant un hôtel par exemple). Elle est également nécessaire pour certaines constructions nouvelles. La DP permet à la mairie de vérifier que vous respectez les règles d'urbanisme en vigueur.
1- AGRANDISSEMENT : Surélévation, véranda, pièce supplémentaire…
L'agrandissement d'un bâtiment existant est vertical ou horizontal. Cela peut être une surélévation ou la création d'une véranda, par exemple.
Vous pouvez créer jusqu'à 40 m² d'extension avec une déclaration préalable de travaux.
Si l'agrandissement est compris entre 20 m² et 40 m² et qu'il porte la surface totale à plus de 150 m² de surface de plancher : Unité de calcul des surfaces des constructions servant à la délivrance des autorisations d'urbanisme, il faut demander un permis de construire et recourir à un architecte.
Votre projet doit respecter les règles du PLU: PLU : plan local d'urbanisme, même s'il n'est pas soumis à déclaration préalable. Avant de commencer vos travaux, vous devez consulter en mairie le PLU ou le document d'urbanisme en tenant lieu .
Aux abords des monuments historiques, des sites patrimoniaux remarquables ou d'un site protégé classé ou en instance de classement, une DP est exigée quelle que soit la surface de l'agrandissement.
2- MODIFICATION DE L’ASPECT EXTERIEUR D’UN BATIMENT : Portes, fenêtre, toiture ..
Une déclaration préalable (DP) est exigée par la mairie quand vous modifiez l'aspect extérieur d'un bâtiment notamment pour l'un des travaux suivants :
- Créer une ouverture (porte, fenêtre, velux)
- Changer une porte, une fenêtre ou un velux par un autre modèle
- Changer des volets (matériau, forme ou couleur)
- Changer la toiture
À savoir
Si les modifications de façade ou de structures porteuses s'accompagnent d'un changement de destination ( Il existe 5 types de destinations : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d'intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Il y a changement de destination lorsque l'on passe d'une catégorie à une autre.) de votre construction, vous devez déposer un permis de construire.
3- TRANSFORMATION D’UN GARAGE EN PIECE D’HABITATION
Vous devez déposer une déclaration préalable de travaux (DP) si vous transformez un garage de plus de 5 m² de surface close et couverte en une pièce de vie.
La modification de l'aspect extérieur comme la pose d'une fenêtre, par exemple, est également soumise à DP. Vous pouvez déclarer l'ensemble de votre projet avec le même formulaire.
En transformant votre garage, vous supprimez une place de stationnement. Le PLU: PLU : plan local d'urbanisme de votre commune peut comporter des règles concernant la création des aires de stationnement. Dans ce cas, vous devez prévoir d'installer une autre place sur votre terrain. Renseignez-vous auprès du service de l'urbanisme de votre commune.
4- CONSTRUCTION NOUVELLE (Abri jardin, garage ….)
Une nouvelle construction est indépendante du bâtiment d'habitation. Cela peut être un abri de jardin, une pergola, un carport, un garage...
Le projet est soumis à déclaration préalable (DP) quand son emprise au solou sa surface de plancher est supérieure à 5 m² et qu'il répond à un ou plusieurs des critères suivants :
- Emprise au sol inférieure ou égale à 20 m²
- Surface de plancher inférieure ou égale à 20 m²
- Hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 mètres
Votre projet devra respecter les règles du PLU: PLU : plan local d'urbanisme même s'il ne fait pas l'objet d'une autorisation d'urbanisme. Vous devez consulter le PLU ou le document d'urbanisme en tenant lieu, à la mairie.
Aux abords des monuments historiques, des sites patrimoniaux remarquables ou d'un site protégé classé ou en instance de classement, une DP est exigée pour toute construction quelle que soit sa taille.
5- RAVALEMENT DE FACADE
En principe, le ravalement n'est pas soumis à déclaration préalable.
Cependant, vous devez déposer une déclaration préalable si le bâtiment que vous ravalez est situé dans un des secteurs suivants :
- Périmètre d'un site patrimonial remarquable
- Abords des monuments historiques
- Site inscrit
- Site classé ou en instance de classement
- Réserves naturelles
- À l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités
- Immeuble protégé
- Commune ou périmètre de commune où le conseil municipal a décidé de soumettre le ravalement à autorisation d'urbanisme
Avant de commencer vos travaux, renseignez-vous auprès du service de l'urbanisme de votre mairie, pour savoir si vous êtes concerné.
6- PISCINE
- La construction d'une piscine non couverte est soumise à déclaration préalable (DP) quand la superficie de bassin est supérieure à 10 m² et inférieure ou égale à 100 m². Si vous construisez une piscine couverte, la couverture fixe ou mobile doit avoir une hauteur au-dessus du sol inférieur à 1,80 m.
- Une piscine plus petite devra respecter les règles du PLU même si elle n'est pas soumise à DP. Vous devez consulter le PLU: PLU : plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, à la mairie.
Si, pendant plus de 3 mois, vous installez une piscine hors-sol dont la superficie du bassin est supérieure à 10 m², vous devez déposer une déclaration préalable (DP) en mairie.
Si cette piscine est couverte, la hauteur de l'abri doit être inférieure à 1,80 m.
Attention
Si vous habitez dans le périmètre de sites patrimoniaux remarquables aux abords d'un monument historique ou d’un site protégé classé ou en instance de classement, vous devez déposer une DP quelle que soit la superficie du bassin.
7- CLOTURE ET MUR
Une clôture peut être constituée d'une haie végétale, de grillage, de parois ajourées, de tout autre élément permettant de fermer un terrain ou d'une combinaison de plusieurs éléments.
Si la clôture est nécessaire à l'activité agricole ou forestière, elle n'est pas soumise à une déclaration préalable (DP).
Les autres clôtures sont également dispensées de formalité. Cependant, le dépôt d'une DP est obligatoire dans certains secteurs :
- Secteur délimité par le PLU: PLU : plan local d'urbanisme
- Commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les murs à déclaration
- Périmètre d'un site patrimonial remarquable
- Abords des monuments historiques
- Site inscrit, site classé ou en instance de classement
Pour construire un mur, vous devez déposer une déclaration préalable de travaux à la mairie dans les cas suivants :
- Hauteur du mur à construire supérieure à 2 mètres
- Secteur délimité par le PLU: PLU : plan local d'urbanisme
- Périmètre d'un site patrimonial remarquable
- Abords des monuments historiques
- Site inscrit, site classé ou en instance de classement
8- PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SUR LE TOIT
Une déclaration préalable (DP) est exigée par la mairie quand vous installez des panneaux photovoltaïques sur le toit d'un bâtiment quelle que soit la surface de ces panneaux.
À noter
L'installation de panneaux solaires au sol peut nécessiter une autorisation d'urbanisme selon la hauteur de l'installation par rapport au sol et sa puissance crête (c'est-à-dire la puissance maximum délivrée par le panneau).
9- DEPOT DE LA DECLARATION PREALABLE
La déclaration préalable (DP) peut être faite par les personnes suivantes :
- Propriétaire(s) du terrain ou leur mandataire
- Personnes autorisées par le ou les propriétaires à effectuer les travaux
- Co-indivisaire (s) ou leur mandataire
Le dossier de DP comprend le formulaire complété par des pièces à joindre en fonction de la nature de votre projet. Un plan de situation du terrain à l'intérieur de la commune doit être fourni pour tous les projets.
En fonction de la nature de votre projet, des pièces complémentaires peuvent vous être demandées, par exemple :
- Plan de masse si vous créez une construction ou si vous modifiez le volume d'une construction existante
- Plan en coupe du terrain si vous construisez, par exemple, une piscine enterrée qui modifie le profil du terrain
- Plan des façades et des toitures pour la pose d'une fenêtre de toit, ou la création d'une porte, par exemple
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer votre demande par voie dématérialisée selon les modalités définies par la commune compétente pour la recevoir. Votre dossier peut aussi être déposé ou envoyé par courrier RAR: RAR : Recommandé avec avis de réception à la mairie.
La mairie vous délivre un récépissé. Il comporte le numéro d'enregistrement de votre dossier et les informations vous permettant de connaître la date à partir de laquelle les travaux pourront commencer.
Ce récépissé précise que, dans un délai d'1 mois à compter du dépôt du dossier, la mairie peut vous notifier un délai différent pour commencer vos travaux. Elle a également 1 mois pour vous signaler que votre dossier est incomplet.
10- DELAI D’INSTRUCTION
Le délai d'instruction est de 1 mois à partir de la date du dépôt de la déclaration préalable.
Il passe à 2 mois dans un secteur protégé (sites patrimoniaux remarquables, abords des monuments historiques, site classé ou en instance de classement ,réserves naturelles, espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national et cœur des parcs nationaux délimités).
Cependant, dans le mois suivant le dépôt de votre déclaration préalable, l'administration peut, par courrier vous notifier un délai supplémentaire de 1 ou 2 mois.
La mairie peut également vous réclamer des pièces manquantes si votre dossier est incomplet. Vous aurez alors 3 mois pour le compléter. Le délai d'instruction démarrera quand votre dossier sera complet. Si vous ne fournissez pas les pièces manquantes, votre DP sera considérée comme rejetée.
Dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration préalable, un extrait de la DP précisant les caractéristiques essentielles du projet est affiché en mairie. Cet affichage est maintenu pendant toute la durée de l'instruction du dossier
11- DECISION DE L’ADMINISTRATION
Le silence de l'administration vaut décision de non-opposition. L'absence d'opposition à l'issue du délai d'instruction vous permet de réaliser les travaux projetés, tels que mentionnés dans la déclaration.
Sur simple demande de votre part, la mairie doit vous délivrer un certificat de non-opposition. Vous disposez ainsi d'une preuve pour faire valoir vos droits (obtention d'un prêt, souscription d'assurances).
Si la mairie a des réserves, elle prend un arrêté assorti de prescriptions. Il précise les motivations de la décision et indique les voies et délais de recours. Vous devez alors exécuter les travaux en respectant ces règles imposées.
Cette décision vous est adressée par lettre RAR: RAR : Recommandé avec avis de réception.
Si la mairie refuse votre projet, elle prend un arrêté d'opposition. Il doit être motivé et préciser l'intégralité des motifs justifiant la décision d'opposition, notamment les absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires.
Cet arrêté vous est notifié par lettre RAR: RAR : Recommandé avec avis de réception. Dans les 2 mois qui suivent sa réception, vous pouvez adresser à la mairie un recours gracieux pour lui demander de revoir sa position. Elle a 2 mois pour vous répondre. L'absence de réponse signifie que votre demande est rejetée.
La mairie peut suspendre sa décision pendant 2 ans en prenant une décision de sursis à statuer.
L'arrêté de sursis à statuer doit être motivé. Il indique la durée du sursis et le délai dans lequel vous pourrez confirmer votre demande de travaux. Il vous précise également les voies et les délais de recours contre le sursis à statuer.
À savoir
Le propriétaire d'un terrain auquel a été opposé un sursis à statuer peut mettre en demeure la collectivité (ou le service public qui en a pris l'initiative) d'acheter son terrain
12- Affichage de la déclaration préalable
L'affichage de la déclaration préalable sur le terrain est obligatoire dès la notification de l'arrêté ou, si vous ne l'avez pas reçu, dès que le délai d'instruction de votre dossier est expiré.
L'affichage doit rester en place pendant toute la durée du chantier et être visible de l'extérieur. Les renseignements figurant sur votre panneau d'affichage doivent être lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public.
Vos voisins peuvent faire un recours gracieux auprès du maire, à partir du 1er jour d'affichage sur le terrain et pendant 2 mois. En l'absence d'affichage, ils peuvent contester l'autorisation encore 6 mois à partir de l'achèvement des travaux.
13- Durée de validité
La déclaration préalable de travaux a une durée de validité de 3 ans.
Elle est périmée si vous n'avez pas commencé les travaux dans les 3 ans ou si, passé ce délai, vous les interrompez plus d'1 an.
Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision n'est plus valable si ces opérations n'ont pas eu lieu dans les 3 ans.
Cependant, le délai peut être prolongé 2 fois pour 1 an si les règles d'urbanisme et les servitudes administratives n'ont pas changé.
Vous devez en faire la demande 2 mois au moins avant l'expiration du délai de validité initial de votre DP (ou avant l'expiration de votre 1re demande de prolongation). Cette demande de prolongation doit être adressée sur papier libre, en 2 exemplaires, par lettre RAR ou déposée en mairie. La prolongation est accordée si la mairie ne vous adresse aucune décision dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande en mairie.
Source : Service public

Le vendeur a une obligation générale d’information envers l’acheteur concernant tous les éléments qui pourraient déterminer son consentement. Parmi ces informations, figurent celles relatives à la situation sanitaire et environnementale du bien. C’est la raison d’être des différents diagnostics techniques obligatoires lors d’une vente immobilière. Ces diagnostics visent de nombreux aspects de la situation du bien : la présence d’amiante, de plomb, de termites, la performance énergétique etc. Ces diagnostics sont rassemblés dans un document unique appelé Dossier de diagnostic technique (DDT)
Diagnostics immobiliers : Dossier de diagnostic technique ou DDT - 11 documents
Le dossier de diagnostic technique (DDT), prévu par L’ordonnance du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction, réunit dans un seul document les états ou constats que le vendeur doit obligatoirement présenter en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, et ce quelle que soit sa destination (habitation, bureaux, commerces). Ce dossier doit obligatoirement être annexé par le vendeur à toute promesse de vente et à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente (Code de la construction et de l’habitation, art. L 271-4 à L271-6 et R 271-1 à D271-5). Des sanctions sont prévues en cas d’absence de l‘un des documents. Cette absence doit être constatée au moment de l’acte authentique. Le dossier de diagnostic technique comprend jusqu’à 11 documents énumérés à l’article L271-4 du Code de la construction et de l’habitation. Il ne comprendra pas nécessairement tous les documents. Par exemple, le diagnostic termite ne sera pas requis si l’immeuble n’est pas situé dans une zone infestée par les termites délimitée par arrêté préfectoral. Les frais d‘établissement du diagnostic technique sont normalement à la charge du vendeur car il relève de son obligation d’information. Les parties peuvent cependant prévoir de les imputer à l’acquéreur.
Vous êtes le vendeur :
- N'hésitez pas à interroger votre notaire sur vos obligations exactes. La loi en effet vous impose de fournir ces documents sous peine d’être responsable des conséquences de ce défaut d'information. Vous ne pouvez donc en être dispensé.
Vous êtes l'acheteur :
- Vous devez vous informer afin de ne pas vous tromper sur les caractéristiques du bien que vous envisagez d'acheter. Ces diagnostics permettent à l'acheteur d'avoir une idée plus précise sur son investissement, ses qualités et ses défauts.
- Il n'est pas impossible que dans l'avenir, d'autres contrôles soient ajoutés au dossier, dans le but constant d’une meilleure information et protection du consommateur.
1/ Le diagnostic PLOMB
Ce diagnostic est prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique.
- Nature du document : constat de risque d'exposition au plomb (CREP). Il doit être accompagné d'une notice d'information résumant les effets du plomb sur la santé (saturnisme) et les précautions à prendre en présence de revêtements contenant du plomb.
- Immeubles concernés : immeubles d'habitation ou partie(s) d'immeuble affectés à l'habitation dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1949.
- Durée de validité du document :
- diagnostic positif : il doit avoir été établi moins d’un an avant la signature de la promesse de vente (art. D 271-5 CCH). Toutefois, si l’état produit lors de la promesse n’est plus valide au moment de l’acte authentique, il devra être remplacé par un nouveau document (art. L 271-5 al 2 CCH).
- Illimitée si le diagnostic est négatif.
- Sanctions prévues : en cas d'absence de diagnostic, le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. La clause d’exonération de vices cachés sera donc inefficace quant à la présence de plomb.
2/ Le diagnostic AMIANTE
Ce document est prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la santé publique.
- Nature du document : “état” ou “constat” mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante.
- Immeubles concernés : tous les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
- Durée de validité du document : si aucune trace d'amiante n'est détectée, la durée de validité est illimitée.
Attention : si le diagnostic a été réalisé avant le 1er avril 2013, il doit être renouvelé en cas de vente du logement, même en l'absence d'amiante.
- Sanctions prévues : le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. Toute clause d’exonération de vices cachés sera donc inefficace quant à la présence d’amiante.
3/ Le diagnostic TERMITES
Ce document est prévu à l'article L. 126-24 du Code de la santé publique.
- Nature du document : état relatif à la présence de termites.
- Immeubles concernés : tous les immeubles bâtis situés dans les zones contaminées, délimitées par arrêtés préfectoraux).
Pour consulter la carte des départements couverts par un arrêté préfectoral délimitant les zones infestées par les termites
- Durée de validité du document : 6 mois maximum. A refaire en cas de nouvel arrêté municipal déclarant une zone nouvelle d'infestation (art. D 271-5 CCH). Et si l’état produit lors de la promesse n’est plus valide au moment de l’acte authentique, il devra être remplacé par un nouveau document (art. L 271-5 al 2 CCH).
- Sanctions prévues : en l’absence d’annexion d’un état de moins de 6 mois à l’acte authentique, le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. Toute clause d’exonération de vices cachés sera donc inefficace quant à la présence de termites.
4/ L'état de l'installation intérieur de GAZ
Ce diagnostic est prévu à l'article L. 134-9 du Code de la construction et de l’habitation.
- Nature du document : état de l'installation intérieure de gaz. Tient lieu d’état le certificat de conformité visé par un organisme agréé établi à l’occasion de travaux de l’installation de l’installation de gaz (art. R 126-41 CCH).
- Immeubles concernés : immeuble d'habitation ou partie(s) d'immeuble affectés à l'habitation, dont l'installation de gaz a été réalisée depuis plus de 15 ans.
- Durée de validité du document : l’état ( ou le certificat de conformité) doit avoir été réalisé moins de 3 ans avant son annexion à la promesse ou de l’acte (art. D 271-5 CCH). Et si l’état produit lors de la promesse n’est plus valide au moment de l’acte authentique, il devra être remplacé par un nouveau document (art. L 271-5 al 2 CCH).
- Sanctions prévues : en l’absence d’état de moins de 3 ans annexé à l’acte authentique de vente, le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. Toute clause d’exonération de vices cachés concernant l’installation de gaz sera donc inefficace.
5/ L’état des risques naturels et technologiques (état des risques et pollutions -ERP)
Ce diagnostic est prévu à L. 125-5 du Code de l'environnement.
- Nature du document : état risques et pollutions (aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon, et sols pollués). Immeubles concernés : tout type d'immeubles situés dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, dans une zone à potentiel radon ou dans une zone de sismicité définie par décret,
- Durée de validité du document : un état de moins de 6 mois doit être annexé à la promesse de vente et à défaut d’avant-contrat à l’acte authentique. Et si l’état produit lors de la promesse n’est plus valide au moment de l’acte authentique, il devra être remplacé par un nouveau document (L 271-5 al 2 CCH).
- Sanctions prévues : à défaut d’état en cours de validité annexé à l’acte authentique de vente, l’acquéreur peut poursuivre la résolution de la vente ou demander au juge du tribunal judiciaire une diminution du prix.
6/ Le diagnostic de performance énergétique (DPE) et audit énergétique
Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l'audit énergétique sont prévus aux articles L126-26 à L126-33-1 et R126-15 à R126-20 du Code de la construction et de l’habitation. Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un document qui sert principalement à estimer la consommation d'énergie et les taux d'émission de gaz à effet de serre du logement (art. L 126-28 Code de la construction et de l’habitation). Le DPE a fait l’objet d’une réforme importante issue de la loi « Climat et Résilience » publiée le 24 août 2021. Le texte rend notamment obligatoire, au 1er janvier 2022, la réalisation d’un audit énergétique lors de la vente d’une maison ou d’un immeuble en monopropriété considéré comme une passoire énergétique, c’est-à-dire dont le diagnostic de performance énergétique (DPE) est de classe F ou G. L’audit sera obligatoire au 1er janvier 2025 pour les logements de classe E et au 1er janvier 2034 pour les logements de classe D (article L 126-28-1 du CCH).
Le DPE doit être annexé à la promesse de vente ou à défaut à l’acte authentique de vente.
- Nature du document : le DPE est un document qui comporte la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée, et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance et du montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic.
- Immeubles concernés (art. R 126-15 CCH) : les immeubles concernés par le DPE sont les bâtiments clos et couverts situés en France métropolitaine et dotés d'une installation de chauffage ou d'eau chaude. Par exception, les immeubles listés à l’article R R126-15 du CCH ne donnent pas lieu à diagnostic (par exemple un bâtiment destiné à être habité moins de 4 mois par an).
- Durée de validité du document : la durée de validité du diagnostic de performance énergétique est fixée à dix ans.
Attention : lorsque les diagnostics de performance énergétique ont été réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 1er juillet 2021, leur durée de validité est fixée dans les limites suivantes :
a) Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valides jusqu'au 31 décembre 2022 ;
b) Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu'au 31 décembre 2024.
- Sanctions : les informations relatives à la performance énergétique (exemple : classement E) sont opposables au vendeur depuis le 1er juillet 2021. Le DPE a donc désormais une valeur contractuelle : en cas d’erreur, l'acquéreur peut saisir le tribunal pour demander des dommages-intérêts. Seules les recommandations (exemple : isolation des combles) conservent une valeur purement informative ; Pour plus d’information, voir notre article sur le diagnostic de performance énergétique.
7/ Le diagnostic ELECTRICITE
Ce diagnostic est prévu à l’article L. 134-7 et R 126-35 et R 126-36 du Code de la construction et de l’habitation.
- Nature du document : état de l'installation intérieure électrique.
- Immeubles concernés : immeubles d'habitation ou partie(s) d'immeuble affectés à l'habitation dont l'installation a été réalisée depuis plus de 15 ans.
- Durée de validité du document : l’état doit avoir été établi moins de 3 ans avant la date de la promesse (art. D 271-5 CCH) aussi bien en ce qui concerne l'état de l'installation intérieure et que l'attestation de conformité en cas de travaux de rénovation.
- Sanctions prévues : en l’absence d’état de moins de 3 ans annexé à l’acte authentique, le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
8/ Le diagnostic ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Ce document est prévu à l’article à l'article L. 1331-11-1 du Code de la santé publique.
- Nature du document : document issu du contrôle de l'installation individuelle d'assainissement.
- Immeubles concernés : tous les immeubles bâtis non raccordés au réseau public.
- Durée de validité du document : 3 ans.
- Sanctions prévues (art. L 271-4 CCH) : en l’absence de document datant de moins de 3 ans annexé à l’acte authentique de vente, le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. En cas de non-conformité de l’installation lors de la signature de l’acte authentique, l'acquéreur a pour obligation de mettre en conformité dans un délai d’un an après la signature.
9/ Le diagnostic MERULE
- Nature du document : information sur la présence d'un risque de mérule.
- Immeubles concernés : tous les immeubles bâtis situés dans les zones contaminées et délimitées par arrêté préfectoral (article L 131-3 du CCH).
- Durée de validité du document : pas de durée fixée.
- Sanctions prévues : aucune sanction n’est prévue par les textes en l’absence d’information.
10/ Le diagnostic BRUIT ou "état des nuisances sonores aériennes"
Le diagnostic Bruit est un document qui permet de faire connaître au futur acquéreur l'existence de nuisances sonores aériennes. Il est prévu à l’article L 112-11 du Code de l’urbanisme. Il est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.
- Nature du document : état des nuisances sonores aériennes.
- Zones concernées : ce diagnostic doit être établi lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu à l'article L. 112-6 du Code de l'urbanisme.
- Immeubles concernés : Les immeubles ou parties d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou les immeubles non bâtis constructibles qui font l’objet d’une vente. Lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit d, un document comportant l'indication claire et précise de cette zone, l'adresse du service d'information en ligne permettant de consulter le plan d'exposition au bruit ainsi que la mention de la possibilité de consulter le plan d'exposition au bruit à la mairie de la commune où est sis l’immeuble doit être intégré au dossier de diagnostic technique.
- Sanctions prévues : si l’état des nuisances n’a qu’une valeur indicative, son absence permet à l’acquéreur de poursuivre la résolution du contrat ou de demander au juge une diminution du prix.
11/ Les appareils de CHAUFFAGE à BOIS
Nouveauté : partant du constat que les cheminées à foyer ouvert sont à l'origine d'importantes émissions de dioxyde de carbone non compensées par la plantation de nouvelles forêts et d'une pollution aux particules fines, la loi Climat et résilience du 22 août 2021 (art. 158) a créé un onzième diagnostic à inclure au DDT (art. L271-4, I, 11° du CCH). Lorsque le bien est situé dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du Code de l'environnement, le vendeur doit joindre au dossier de diagnostic technique (DDT) un certificat attestant la conformité de l'appareil de chauffage au bois aux règles d'installation et d'émission fixées par le préfet du département.
DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES
a- Le certificat de mesurage LOI CARREZ
La loi n°96-1107 du 18 décembre 1996, dite loi Carrez, visait à protéger les acquéreurs de lots de copropriété, en encadrant le calcul des surfaces des parties privatives dévolues à l’acquéreur lors de l’achat d’un lot de copropriété. L’article L271-4 du CCH ne le mentionne pas parmi les 11 documents à joindre au DDT mais en pratique le métrage carrez est joint au dossier de diagnostic technique.
- Nature du document : certificat attestant de la surface du lot de copropriété vendu.
- Immeubles concernés : tous les lots de copropriété à usage d'habitation, professionnel ou commercial (exceptés les caves, garages, emplacement de stationnement et d'une manière générale, les lots ou fraction de lots inférieurs à 8 m2).
- Durée de validité du document : permanente
- Sanctions prévues : action en nullité de la vente en l'absence de mention. Si la superficie réelle est inférieure de plus de 5 % à celle exprimée dans l'acte de vente, l'acquéreur peut, dans un délai d'un an à compter de la date de l'acte authentique, demander au juge une diminution de prix au prorata du nombre de mètres carrés manquants.
b- Le diagnostic technique de l'immeuble en copropriété
c- L'étude géotechnique
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles consécutif à des épisodes de sécheresse suivis de périodes de pluie provoque de nombreux dégâts matériels, particulièrement sur les maisons individuelles. Mise en place par la loi ELAN du 23 novembre 2018, l'étude géotechnique des sols ne fait pas partie de la liste des documents figurant dans le dossier de diagnostic technique puisque ce dernier concerne la vente d'un immeuble bâti. Toutefois, cette étude géotechnique doit rester annexée au titre de propriété du terrain et suivre les mutations successives de celui-ci, notamment en cas de vente du terrain après construction. Elle est prévue par les articles L. 132-5 et L. 132-8 du CCH et R 132-3 du CCH.
- Nature du document : étude géotechnique préalable. Elle doit permettre à l'acquéreur de connaître la véritable qualité du terrain destiné à la construction et, aux professionnels, compte tenu de la nature du sol, de proposer soit des fondations adaptées et non surdimensionnées, soit de demander une étude du sol plus approfondie.
- Immeuble concerné : en cas de vente d’un terrain non bâti constructible situé :
- Dans une zone permettant la réalisation de maisons individuelles,
- Et dans une zone de sols argileux (zone où l’exposition au risque de mouvement de terrain est qualifiée de moyenne ou forte, (voir la carte des zones : www.georisques.gouv.fr ; rubriques « Retrait/gonflement des argiles »),
- Cette étude de sol "préalable" doit être fournie par le vendeur et annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. L’obligation est effective depuis le 1er octobre 2020.
A noter : une autre étude géotechnique, dite « de conception », prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment peut être requise dans le cadre de la réalisation de travaux de construction
- Durée de validité du document : 30 ans si aucun remaniement du sol n'a été effectué.
- Sanctions prévues : la loi n’a pas prévu de sanction spécifique en cas d’absence d’étude géotechnique. Ainsi, c’est le droit commun qui s’applique et la responsabilité du vendeur pourrait être engagée.
Source : Notaires.fr

Les frais de notaire sont en réalité composés de plusieurs parties et pour l'essentiel d'un ensemble d'impôts et de taxes collectés par le notaire pour le compte de différentes administrations. Il s'agit donc plutôt de frais d'acquisition, parmi lesquels on trouve les émoluments du notaire. Mais on a pris l'habitude d'appeler frais de notaire la somme versée au notaire au moment de la vente, car c'est lui qui est chargé d'en évaluer le montant et de la percevoir.
Seule une petite part revient au notaire pour sa rémunération, c'est ce qu'on appelle les émoluments du notaire. Le notaire reverse au Trésor public la part de taxe qu'il perçoit pour son compte et ce dernier reverse à son tour ce qui leur revient aux collectivités locales dont la part départementale est la plus importante.
Un des critères principaux qui détermine le montant des frais de notaire est le type d'achat : dans l'ancien ou dans le neuf. Voici comment se calculent les frais de notaire pour l'achat d'un bien ancien, car pour un achat dans le neuf, ils sont différents.
Les frais de notaire pour l'achat d'un bien ancien concernent tous les achats immobiliers de biens existants, récents ou non, y compris les biens construits depuis moins de cinq ans, à l'exclusion, simplement, des logements neufs, tels que les biens achetés en l'état futur d'achèvement.
Les acheteurs d'un bien récent sont donc logés à la même enseigne que ceux qui achètent un bien de plus de cinq ans, contrairement à ce qui se pratiquait jusqu'en 2012. Depuis, un acheteur ne peut plus bénéficier de frais de notaire réduits s'il achète un logement de moins de cinq ans à un vendeur qui l'avait acheté sur plans. Et le vendeur n'a plus à reverser de TVA sur la plus-value réalisée, comme c'était le cas à l'époque, dans cette hypothèse.
Les frais de notaire sont intégralement à la charge de l'acquéreur. Ils sont donc à intégrer dans son plan de financement, car ils représentent l'essentiel des frais à prévoir lors de l'achat d'un logement en plus de son prix. Et le notaire va détailler le plan de financement dès la signature du compromis de vente. Pour éviter les mauvaises surprises, il est donc important de les évaluer dès le départ !
Il n'est cependant pas exclu, très exceptionnellement, que les parties s'entendent pour que le vendeur les prenne en charge. Mais en pratique, cela peut arriver plutôt lors d'achat dans le neuf et reste l'exception.
Ces frais de notaire sont versés en même temps que le prix de vente du bien au moment de la signature de l'acte de vente définitif chez le notaire qui se charge de la rédaction de l'acte de vente. Ils sont réglés avec le prix de vente par virement bancaire et le notaire reverse ensuite au trésor public la part d'impôt perçue pour son compte.
Il existe de nombreuses possibilités sur Internet pour effectuer une simulation des frais de notaire. Il est possible d'anticiper ses frais de notaire depuis le site de la Chambre des notaires de Paris, par exemple.
Les frais d'acquisition d'un bien immobilier sont composés de plusieurs parties dont le montant se calcule indépendamment les unes des autres. Pour un logement ancien, on estime que le montant total de ces différentes parties représente environ 8 % du prix de vente. Toutefois, ce taux n'est pas fixe mais uniquement indicatif. Il représente presque 8 % pour un bien vendu 200.000 €. Mais plus le prix d'achat est élevé, plus cette proportion diminue, pour atteindre environ 7 % pour un bien de 700.000 €. A l'inverse, pour un bien de 100.000 €, ils dépassent 8,5 %.
Ils se décomposent en quatre postes : - Les droits de mutation, c'est-à-dire l'impôt sur la mutation ; - Les émoluments du notaire, c'est-à-dire sa rémunération pour la vente ; - Les formalités et frais divers ou débours engagés par le notaire pour la vente ; - La contribution de sécurité immobilière pour enregistrer officiellement la vente.
Pour calculer les frais de notaire, il convient de calculer le montant de chacun des quatre postes qui les composent et de les additionner. En dehors des frais divers de formalités, le montant des différents postes représente un pourcentage du prix de vente. On part donc toujours du prix de vente du logement pour calculer chacun des postes qui composent les frais de notaire.
Les droits de mutation et les émoluments du notaire sont calculés à partir de grilles tarifaires qui ont évolué au cours du temps. L'ensemble de nos explications de calcul et grilles tarifaires est à jour des tarifs qui s'appliquent en 2022.
La part la plus importante des frais de notaire correspond aux droits de mutation, c'est-à-dire la taxe de publicité foncière et les droits d’enregistrement. Il s'agit d'une taxation qui s'élève à : - 5,80 % (5,80665 % exactement) du prix de vente si le bien que vous achetez est situé dans l'un des quatre-vingt-dix-huit départements qui appliquent ce taux, c'est-à-dire presque tous ; - à 5,09 % (5,09006 % exactement) du prix de vente s'il se situe dans l'un des trois départements qui ont choisi de ne pas appliquer la hausse des droits de mutation : l'Indre (36), le Morbihan (56) et Mayotte (976).
En pratique, vous prenez le prix d'achat de votre logement que vous multipliez par 5,80 % ou 5,09 % selon la localité du bien vendu.
Si le prix de vente intègre le prix de certains meubles que laisse le vendeur (cuisine équipée, etc.), pensez à le préciser au notaire afin qu'il en distingue le prix de celui du bien lui-même, avant d'appliquer les 5,80 ou 5,09 %. Cela permet d’éviter de payer des droits de mutation sur le mobilier. Seule la vente immobilière est soumise aux droits de mutation, mais pas le mobilier vendu avec le logement. C'est donc une option intéressante pour réduire le montant des frais de notaire si la facture globale du mobilier est importante.
Pour l'achat d'un bien immobilier, il faut obligatoirement recourir aux services d'un notaire. Pour le rôle du notaire pour ce type de prestation, celui-ci reçoit des honoraires tarifés, ce qu'on appelle ses émoluments. Leur montant est calculé à l'aide d'un pourcentage dégressif qui s'applique à la valeur du bien en quatre tranches selon un barème. Cette grille tarifaire a été revue à la baisse une première fois de 1,4 % en 2016 puis de nouveau depuis le 1er janvier 2021. Cette fois, les émoluments notariés ont baissé d'environ 1,9 %.
|
Tranches de prix |
Pourcentage à appliquer |
Montant à ajouter* |
|
≤ à 6.500 € |
3,870 % |
0 |
|
De 6.501 à 17.000 € |
1,596 % |
147,81 € |
|
De 17.001 à 60.000 € |
1,064 % |
238,25 € |
|
> à 60.000 € |
0,799 % |
397,25 € |
*Le « montant à ajouter » permet un calcul rapide et simplifié sans avoir besoin de faire un calcul tranche par tranche. / TVA sur émoluments : ajouter 20 % du résultat obtenu ci-dessus.
Les émoluments du notaire s'élèvent à : 200.000 € x 0,799 % (taux de la tranche de prix supérieur à 60.000 €) = 1.598 € auxquels il faut ajouter 397,25 € (montant qui intègre les taux des autres tranches), soit 1.995,25 € au total. On applique alors la TVA à 20 % à ce montant, soit 399 €. Les émoluments du notaire s'élèvent donc au total à 2.394 € TTC.
Pour les ventes de biens immobiliers de faible valeur, le coût des émoluments du notaire est plafonné à 10 % du prix du bien, sans pouvoir être inférieur à 90 €. Ceci afin d'éviter que le coût global du notaire, émoluments et émoluments de formalités compris, dépasse 10 % du prix de vente du bien. Car à côté de sa rémunération qui est calculée selon la grille proportionnelle, le notaire facture des prestations qu’il effectue pour la vente et qui sont également tarifées selon un tableau acte par acte en tant qu’émoluments de formalités ou débours.
Selon le calcul proportionnel avec la grille tarifaire, le notaire aurait pu percevoir 331 € d’émoluments et environ 1.000 € pour les formalités, soit au total 1.331 €, ce qui représente plus de 10 % du prix de vente du bien. Désormais, dans cet exemple, sa rémunération est ramenée à 800 € (auxquels on ajoute la TVA de 20 %), soit au montant maximal de 960 € TTC.
Le notaire accomplit différentes démarches et effectue des formalités pour la transaction qui sont facturées en moyenne pour un total de 1.000 € TTC. C’est pourquoi on parle d’émoluments de formalités. Chacune des formalités ou prestations est facturée selon un barème officiel. En fonction des ventes, le notaire aura besoin de plus ou moins de démarches à effectuer. C’est pourquoi il demande une provision sur ses émoluments et fait le décompte quelques mois après la vente, en fonction du prix facturé pour les différentes démarches qu’il a effectuées.
Les frais divers ou débours : ils sont évalués, quant à eux, à environ 400 € et correspondent au remboursement de sommes que le notaire a dû payer à des tiers pour le compte de son client (frais d'expédition des actes, etc.).
Cette contribution est due à l’Etat pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité foncière, ce que l'on appelle la formalité fusionnée. Elle est fixée au taux proportionnel de 0,10 % du prix du bien, avec un minimum de 15 €. Pour un bien de 200.000 €, elle s’élève donc à 200 € (200.000 € X 0,10 %).
Une fois calculé le montant de chacun des postes qui composent les frais de notaire, vous n'avez plus qu'à les additionner pour savoir combien vous allez devoir régler. Prenons l'exemple de l'achat d'une maison ancienne à 250.000 €.
Pour l'achat d'une maison au prix de 250.000 € dans la Manche, le montant total des frais de notaire s'élève à 19.040 €. L'acheteur doit donc ajouter cette somme au prix de vente de la maison qu'il achète pour calculer son budget total d'achat.
Au total, le budget à prévoir pour acheter cette maison est de 269.040 € (250.000 € + 19.040 €) Voici comment se décomposent les frais de notaire de 19.040 € : - Les droits de mutation : 14.517 € (le calcul est le suivant : 250.000 € X 5,80665 % ) ; - Les émoluments du notaire : 2.874 € (le calcul est le suivant, selon la grille tarifaire ci-dessus : (250.000 X 0,799 %) + 397,25 € = 2.394,75 + TVA à 20 %) ; - Les émoluments de formalités : 1.000 € en moyenne ; - Les frais divers : 400 € en moyenne ; - La contribution de sécurité immobilière : 250 € (le calcul est le suivant : 250.000 € X 0,10 %).
C'est le montant à payer si vous achetez un bien situé dans la quasi-totalité des départements, sauf trois. Car dans trois départements, les droits d'enregistrement sont légèrement moins élevés : si le bien que vous achetez se situe en Indre, dans le Morbihan ou à Mayotte, le montant des frais de notaire pour un bien à 250.000 € s'élève non plus à 19.040 €, mais seulement à 17.249 €, les droits de mutation étant dans ce cas abaissés à 12.725 € au lieu de 14.517 €.
Sachez que pour une transaction de ce montant, le notaire peut vous accorder sur le montant de ses émoluments une remise d'une valeur maximale de 288 € TTC.
Le notaire a la possibilité d'accorder une remise de 20 % au maximum sur sa rémunération pour les ventes de plus de 100.000 €. La ristourne est calculée sur la part de prix du bien au-delà de 100.000 €.
Lorsque le prix de vente du bien dépasse 100.000 €, le notaire peut désormais accorder une remise sur ses émoluments dans la limite de 20 %. Le notaire peut décider librement d’accorder une remise à condition : - Que le prix de vente soit supérieur à 100.000 € ; - Que le taux de la remise soit au maximum de 20 %. Il s'applique à la part de ses émoluments calculée sur le prix au-delà de 100.000 € ; - D’appliquer la remise qu’il a décidée uniformément à l’ensemble de sa clientèle. Toutefois, le notaire peut décider de ne l’appliquer qu’au cours d’une période définie et pour certains types d’actes.
Pour une vente à 300.000 €, le notaire peut accorder une remise sur ses émoluments calculée sur la part de prix comprise au-delà de 100.000 €, soit sur 200.000 € (300.000 – 100.000 €). le calcul de ses émoluments se fait au-delà de 100.000 € donc sur 200.000 € : 200.000 X 0.799 % = 1.598 €. Avec la TVA, cela fait un total de 1.917,60 € TTC. Dans cet exemple, le notaire peut vous accorder une remise maximale de 1.917,60 € x 20 %, soit de 384 € TTC.
A ces frais peuvent s'ajouter des frais de notaire liés au crédit immobilier si vos prêts sont garantis par une hypothèque ou un privilège.
Si vous avez recours à un crédit pour financer votre achat, le contrat de prêt est obligatoirement établi devant notaire si le prêt est garanti par une hypothèque ou un privilège. Dans ce cas, les frais liés au crédit s'ajoutent aux frais de notaire pour l'achat du bien. Pour un crédit garanti par une hypothèque ou un privilège, les émoluments du notaire se calculent selon le barème.
|
Tranches de prix |
Pourcentage à appliquer |
Montant à ajouter* |
|
≤ 6.500 € |
1,290 % |
0 |
|
De 6.501 à 17.000 € |
0,532 % |
49,27 € |
|
De 17.001 à 60.000 € |
0,355 % |
79,36 |
|
> à 60.000 € |
0,266 % |
132,76 € |
*Le montant à ajouter permet un calcul rapide sans avoir besoin de faire un calcul tranche par tranche comme dans cet exemple de calcul du tarif des notaires pour un prêt de 200.000 € : - 200.000 € x 0,266 % = 532 € - 532 + 132,76 = 664,76 € - 664,76 x 20 % = 132,952 €
Montant total du tarif des notaires : 797,71 € TTC.
Par ailleurs, vous devez payer, mais seulement en cas d'hypothèque, la taxe de publicité foncière au taux de 0,715 %. Le privilège coûte donc un peu moins cher que l'hypothèque. Enfin, dans tous les cas, vous devez vous acquitter de la contribution de sécurité immobilière et des frais de formalités, pour un montant de 500 € environ.
Le prêt peut également être garanti par la caution d'une société spécialisée. Dans ce cas, le contrat de prêt n'est pas notarié et les frais de caution sont payés directement à la société caution. Ils n'entrent donc pas strictement dans ce que l'on appelle les frais de notaire.
Si vous avez plusieurs prêts, les frais sont calculés pour chacun d'eux et non pour leur montant total (ils sont donc un peu plus élevés).

Achat en indivision et régime d'indivision
L'indivision est la situation juridique dans laquelle deux ou plusieurs personnes sont propriétaires ensemble d'un même bien. A priori, elle permet un financement, un entretien et une gestion plus faciles.
1- Pourquoi acheter en indivision ?
L’indivision apparaît comme la solution la plus facile pour acheter un bien à plusieurs.
Bien entendu, ce n’est pas la seule (il est possible d’opter pour des formules plus spécifiques comme la SCI par exemple), mais c’est de loin la moins contraignante. Elle s’applique à défaut de choix d’une autre forme d’acquisition.
Chaque acquéreur est propriétaire du bien à hauteur de sa contribution financière lors de l’achat (30/70, 40/60, 50/50, etc.), sans que sa quote-part ne soit matériellement distinguée.
L'achat en indivision présente donc une grande simplicité, du moins au départ, notamment pour les concubins ou les couples pacsés qui souhaitent acquérir leur logement à deux.
2- L'indivision comporte-t-elle des risques ?
Une fois le bien acheté, chacun des propriétaires (appelé indivisaire) a des droits sur la totalité du bien. Les décisions les plus importantes doivent être prises à l’unanimité (sauf exceptions). Ce qui, en cas de désaccord, peut vite entraîner des situations de blocage.
Par ailleurs, chaque indivisaire est tenu de régler les dettes de l’indivision (impôts ou travaux sur le logement par exemple), à proportion de sa quote-part. Autant dire qu’il est fondamental de bien évaluer les risques de mésentente avant l’achat.
Enfin le régime de l’indivision est provisoire. La loi pose comme principe que "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision". Trois solutions s’offrent aux indivisaires : - l’un des indivisaires peut mettre en vente sa quote-part, les autres ne peuvent s’y opposer. Toutefois, ils disposent d'un droit de préemption sur la quote-part cédée. - Les indivisaires peuvent décider à l’unanimité de vendre le bien à un tiers. A défaut d’accord, la vente peut, sous certaines conditions, intervenir à la majorité des deux tiers des droits indivis (C. civ. art. 815-5-1). - L’un d’eux peut à tout moment de demander le partage (C. civ. art. 815).
Cette situation n’est pas sans risque ; Mieux vaut l’anticiper par une convention d’indivision.
3- Indivision : comment éviter les risques ?
La convention d'indivision
Il est possible de corriger cette situation d’insécurité grâce à la signature d'une convention d'indivision.
A peine de nullité, cette convention doit être établie par écrit, lister les biens indivis et préciser les droits de chaque indivisaire. Dès lors qu’elle porte sur un bien immobilier, elle doit en outre être rédigée par un notaire et faire l’objet d’une publication au Service de la publicité foncière.
Elle peut être conclue pour une durée déterminée (cinq ans au maximum). A terme, les indivisaires demeurent libres de la renouveler.
La convention d’indivision a pour but d’organiser la gestion de l’indivision et d’en fixer les règles du jeu. Les indivisaires peuvent aménager la répartition de leurs dépenses, nommer un gérant (choisi ou non parmi eux), arrêter le montant d’une indemnité d’occupation (si l’un d’entre eux occupe seul le bien par exemple), etc...
Lorsque la convention est conclue à durée indéterminée, le partage peut être demandé, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi (volonté de nuire aux indivisaires) ou à contretemps (période économiquement défavorable au partage).
4- Existe-t-il d’autres situations d’indivision ?
L'indivision n'est pas toujours une situation choisie. Elle peut être subie à l’occasion d’un décès par exemple, en attendant la partage des biens d’une succession (indivision successorale) ; ou lors de la dissolution d’une communauté conjugale au moment d’un divorce (indivision post-communautaire).
Mais qu’elle soit constituée de manière volontaire ou involontaire, l’indivision demeure soumise aux mêmes règles. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre notaire pour en connaître les tenants et aboutissants.
Source : Notaires.fr


L'achat d'un bien immobilier en nue-propriété permet de se constituer un patrimoine à moindre coût, d’en préparer la transmission en optimisant la fiscalité, où d'anticiper la baisse de ses revenus à la retraite
1- Différence entre nue-propriété , usufruit et pleine propriété
Définition nue-propriété : Droit d'un propriétaire de disposer d'un bien, sans pouvoir l'utiliser, ni en avoir la jouissance conférée à un usufruitier, ni en tirer un revenu locatif. Le nu-propriétaire peut vendre son droit de propriété, sans vendre la jouissance du bien
Définition usufruit : L'usufruit est le droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les revenus, sans en être propriétaire. L'usufruitier a des droits et obligations. Le droit à l'usufruit est temporaire.
La différence tient aux droits plus ou moins importants sur un bien. La pleine propriété est composée de l'usufruit et de la nue-propriété:
Les attributs du droit de propriété (occuper un bien, le vendre, en percevoir les revenus) peuvent être répartis entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. On parle dans ce cas de démembrement du droit de propriété.
|
Différences entre usufruit, nue-propriété, pleine propriété |
|||
|
Droits sur le bien |
Pleine propriété |
Nue-propriété |
Usufruit |
|
Disposer du bien (le vendre par exemple) |
Oui |
Oui |
Non |
|
Utiliser un bien (l'occuper par exemple) |
Oui |
Non |
Oui |
|
Percevoir des revenus issus de ce bien (des loyers par exemple) |
Oui |
Non |
Oui |
2- Le principe de l'achat en nue-propriété
Vous achetez la nue-propriété d'un bien immobilier (maison, appartement) dont l'usufruit est acquis le plus souvent par un bailleur social (plus rarement une société ou un particulier).
L’usufruitier percevra les fruits (les loyers) et assurera la gestion locative du bien durant toute la durée de l’investissement, en général de 15 à 20 ans.
3- Les avantages d'acheter en nue-propriété -
Un prix attractif : L'achat en nue-propriété vous permet de constituer un patrimoine immobilier à moindre coût, avec une décote sur le prix d'achat de l'ordre de 40 % par rapport au même bien acquis en pleine propriété. -
L'absence de charge pour le nu-propriétaire : L'usufruitier se charge de donner le bien en location et assure les réparations d'entretien de l’immeuble (parties privatives et communes). Attention, les grosses réparations sont à la charge du nu-propriétaire (article 605 et 606 du Code civil). -
La pleine propriété sans frais et sans fiscalité à la sortie : Au terme de la période de démembrement, vous retrouvez la pleine propriété du bien, sans avoir un euro de plus à débourser. -
Défiscaliser ses revenus fonciers : Pendant toute la période du démembrement, l'opération n'a aucune incidence en termes d'impôt sur le revenu dans la mesure où vous n'encaissez pas les loyers du logement donné en location. En cas d’acquisition à crédit, les intérêts d’emprunt sont déductibles des autres revenus fonciers à condition que l’usufruitier soit un bailleur social ou un bailleur imposable à l’impôt sur le revenu. -
Réduire sa base ISF : L'usufruitier doit déclarer le bien dans son patrimoine imposable, à condition qu'il soit assujetti à l'ISF. Il est alors redevable de l'ISF sur la pleine propriété du bien. Pendant toute la période du démembrement, le nu-propriétaire n'a pas a en tenir compte pour évaluer son patrimoine imposable à l'ISF. En revanche, les dettes afférentes à la nue-propriété ne peuvent plus être déduites de l’actif taxable à l’ISF depuis la loi de finances rectificative pour 2013 (article 885 G quater CGI) -
Transmettre à moindre coût fiscal : Si vous souhaitez transmettre le bien à vos héritiers, dans la mesure où seule la nue-propriété leur sera transmise, les droits de donation seront calculés uniquement sur la valeur de cette dernière.
Source : www.notaires.fr

Pour le candidat acquéreur, l'offre d'achat est un moyen de réserver un bien à des conditions qu'il fixe lui-même. Il s'engage à acheter le bien en cas d'acceptation du vendeur. L'acquéreur doit avoir la capacité juridiquede signer un contrat, car l'offre d'achat est destinée à aboutir à la signature d'un acte de vente.
L'offre doit être écrite et contenir les éléments suivants : - Désignation du bien - Date de l'offre - Prix fixé par l'acquéreur - Durée de validité de l'offre de 1 ou 2 semaine(s)
Le délai de réflexion ou de rétractation ne s'applique pas pour une offre d'achat acceptée.
Attention
Le candidat acquéreur qui fait une offre d'achat ne doit verser aucune somme d'argent au vendeur.
Pendant le délai de validité de l'offre, le vendeur a plusieurs possibilités : - Il peut accepter les conditions de l'offre du candidat acquéreur - Il peut refuser l'offre si le prix proposé par le candidat acquéreur est inférieur à celui initialement fixé - Il peut faire une contre-proposition écrite, c'est-à-dire une nouvelle offre qui rend l'offre initiale caduque
Si le vendeur accepte les conditions de l'offre, le candidat acquéreur et le vendeur sont engagés. Une promesse de vente ou, sinon, un acte de vente est alors signé.
Source : Servicepublic.fr

Le permis de construire est une autorisation d'urbanisme délivrée par la mairie de la commune où se situe le projet. Il concerne les constructions nouvelles (telles que la construction d'une maison), même sans fondation, de plus de 20 m² de surface de plancher où d'emprise au sol. Des travaux d'extension et certains changements de destination des locaux sont également soumis à la procédure de demande de permis de construire.
La loi du 23 novembre 2018 dite loi ELAN prévoit que toutes les communes de plus de 3500 habitants devront à partir du 1 janvier 2022 avoir des procédures dématérialisées pour recevoir et instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme et certificat d'urbanisme.
Le permis de construire est une autorisation obligatoire d'urbanisme.
Le permis de construire permet notamment d'édifier toute construction nouvelle qui n’est pas dispensée de formalité ou qui n’est pas soumise à déclaration préalable (telle qu’une maison individuelle, la construction d’une piscine, de certains bâtiments indépendants de la maison, etc.) mais aussi d’entreprendre des travaux d’agrandissement d’une maison pour une surface supérieure à 20 m2 ou encore des travaux portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques.
De nombreuses règles d’urbanisme sont à respecter. Par exemple, une maison destinée à être louée ou vendue doit respecter les règles d’accessibilité. Par contre, si la construction de la maison individuelle a pour but votre usage à titre d’habitation, vous n’avez pas à respecter cette réglementation. N’hésitez pas à consulter un architecte pour connaître la faisabilité d’un projet.
A noter : Le recours à un architecte est obligatoire pour un projet de construction si la superficie du plancher dépasse 150 m2. Le recours à un architecte est également nécessaire pour tous les projets d’agrandissement soumis à permis de construire pour une surface de plancher ou d’emprise au sol de la construction existante de plus de 150 m2.
Exception : A noter que lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU ou par un POS, un permis de construire est nécessaire seulement si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m2 ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de construction au-delà de 150 m2.
La demande de permis de construire doit être effectuée à l’aide : - Du cerfa n°13406*07 pour une maison individuelle, - D’un téléservice.
La demande de permis de construire adressée à la mairie par le propriétaire du terrain doit comprendre certains documents : - Le formulaire cerfa, - La déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, - Le bordereau des pièces jointes, - Le plan de situation, - Le plan de masse, - Le plan de couple du terrain, - La notice, - Le plan des façades et des toitures, - Le document graphique, - Des photos pour situer le terrain dans son environnement proche et lointain.
En France métropolitaine, la demande de permis de construire doit également comporter une attestation de prise en compte de la réglementation thermique.
La mairie délivre un récépissé à la réception de votre demande de permis. En cas de dossier incomplet, la mairie a un mois pour vous réclamer les pièces manquantes.
Le délai d’instruction du dossier de demande de permis pour une maison et ses annexes est de 2 mois. La mairie dispose de 3 mois pour les autres projets.
Le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune ou au nom de l’Etat selon qu’existe ou non un plan local d’urbanisme.
La décision d'acceptation ou de refus de la demande de permis de la mairie prend la forme d’un arrêté. Il est possible de demander à la mairie de revoir sa position dans les 2 mois suivant le refus.
La durée de validité du permis est de 3 ans. Il est périmé si les travaux n’ont pas commencé dans les 3 ans ou si, passé ce délai, les travaux sont interrompus plus d’un an. Ce délai de trois ans peut toutefois faire l’objet d’une prorogation. La durée de validité initiale peut ainsi être prorogée deux fois pour une durée d’un an. La demande de prorogation doit être adressée à la mairie 2 mois avant l’expiration du permis.
Dans de nombreux cas, le silence de l’administration pendant un certain délai permettra l’obtention d’un permis tacite, c’est-à-dire sans que le maire n’ait à délivrer un arrêté.
Cependant, l’absence de réponse peut aussi signifier un refus implicite. C’est le cas pour un projet soumis à l’accord de l’architecte des bâtiments de France lorsqu’il a émis un avis défavorable ou favorable avec des prescriptions.
Le permis de construire est accordé si les travaux du projet de construction sont conformes aux règles d’urbanisme de la mairie. L’affichage du permis de construire sur le terrain est obligatoire. L’affichage doit être visible de la rue pendant toute la durée du chantier et comporter des mentions relatives obligatoires permettant d’apprécier la situation : - Le nom du bénéficiaire du permis (la raison sociale ou dénomination sociale pour une entreprise), - Le nom de l’architecte auteur du projet, - La date de délivrance du permis et son numéro, - La nature du projet et la superficie du terrain, - L’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté, - Les mentions légales des voies de recours.
Selon la situation du terrain (lotissement, etc.), d’autres éléments peuvent être à indiquer. Également, dans les huit jours de sa délivrance expresse ou tacite, un extrait du permis est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L’absence d’affichage ne rend pas l’autorisation illégale, mais permet un recours contentieux pendant la durée des travaux et jusqu’à 6 mois après leur achèvement.
Les tiers peuvent consulter le dossier en mairie et le contester à l’aide d’un recours gracieux.
Une fois les travaux autorisés par le permis réalisés sur le terrain d’assiette, le titulaire de ce permis doit déposer une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, l’administration disposant d’un délai de trois mois pour contrôler lesdits travaux (ce délai peut être porté à 5 mois dans certains secteurs ou pour certains immeubles).
Le permis de construire n’étant, sauf exception, pas délivré en fonction de la personne qui le demande mais des caractéristiques du terrain, il peut faire l’objet d’un transfert. En revanche, un permis délivré à un exploitant agricole pour les nécessités de son exploitation, et donc accordé en considération de la personne du bénéficiaire, ne peut être transféré qu'à un autre exploitant.
Les conséquences d’un défaut de permis de construire ou d’une irrégularité sont d’une telle gravité (pouvant aller jusqu’à l’obligation de destruction d’un immeuble), que le rôle du notaire lors de la signature d’un acte est fondamental. En effet, c’est lui seul, sous sa responsabilité, qui aura la charge et l’obligation de vérifier non seulement l’existence du permis de construire mais également sa validité au moins sur le plan formel. Il questionnera le vendeur et lui demandera toutes les pièces qu’il vérifiera pour s’en assurer. A la moindre anomalie, il informera les parties et les invitera à faire les régularisations.
Source : Notaires.fr

Elle permet aux membres d'une même famille d'être propriétaire dans des proportions différentes ou pas, et de gérer ensemble un ou plusieurs biens immobiliers et ce, dans un but non commercial.
La SCI permet d'écarter l'application des règles de l'indivision et d'optimiser fiscalement la transmission de son patrimoine à ses héritiers.
La création d'une SCI est une décision qui ne doit pas être prise à la légère car elle peut présenter des avantages comme des inconvénients selon les situations
Une SCI est une société dans laquelle les membres d’une même famille apportent une quote-part d’un immeuble qu’ils possèdent et c’est alors la société qui en devient le propriétaire, chaque apporteur récupérant en contrepartie des parts sociales correspondant à son apport. L’apport peut également être en numéraire, c’est-à-dire, une somme d’argent. Dans ce cas, c’est la SCI qui achète le bien immobilier avec ces apports La SCI réunit des membres d’une même famille et alliés jusqu’au 4e degré, notamment enfant, parent, petit-enfant, frère/sœur, arrière grand-parent, oncle/tante, neveu/nièce, cousin germain. La SCI familiale, comme toute SCI, est réglementée par les dispositions communes à toutes les sociétés, des articles 1832 et suivants du Code civil, ainsi que par les dispositions communes à toutes les sociétés civiles, fixées par les articles 1845 et suivants du même code. Néanmoins, elle présente quelques caractéristiques spécifiques en raison des liens de parenté ou d’alliance entre les associés. Par exemple, elle échappe à la qualification de bailleur professionnel lorsqu’elle met un bien en location à des tiers ou aux associés de la SCI. Elle demeure un bailleur particulier qui peut conclure un bail d’une durée minimum de 3 ans et non de 6 ans. Cela constitue d’ailleurs la principale règle spécifique. En revanche, elle perd son caractère familial dès l’entrée dans la SCI d’un associé qui n’a pas de lien de famille ou d’alliance avec les autres.
Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d’un même bien, qu’elles l’aient choisi (en cas d’acquisition en commun par des époux séparés de biens, par exemple) ou non (en cas de succession), c’est le régime légal de l’indivision qui s’applique. Dans le cadre d'une indivision, seuls les actes conservatoires peuvent être faits à l'initiative d'un seul coïndivisaire. Pour les actes d'administration, (conclusion des baux ou réalisation de travaux d'amélioration), l'accord du ou des coïndivisaires représentant au moins les deux tiers des droits indivis est nécessaire (art. 815-3, al.1 C. civ.). Les actes de disposition (acquisition, vente d'immeuble, emprunt...) restent soumis à l'accord de tous les indivisaires (art. 815-3, al. 7 C. civ.). Cela peut générer des situations de blocage en raison du veto ou du silence d’un indivisaire. Il faut alors recourir au juge pour passer outre ( art. 815-4 à 815-6 C. civ.).
Dans une société, seules les décisions les plus graves sont en principe soumises à l'unanimité. Bien souvent, les statuts prévoient que la plupart des décisions sont prises à la majorité des associés telle qu’elle est fixée par les statuts, ce qui permet de passer outre le désaccord des minoritaires.
Pour éviter les blocages, les indivisaires peuvent à la majorité des deux tiers donner un mandat général d’administration, ou par convention et à l’unanimité nommer un gérant et lui donner certains pouvoirs. Mais ces pouvoirs sont strictement limités et la convention d’indivision à durée déterminée a une durée maximale de 5 ans (renouvelable). Dans le cadre de la SCI, un ou plusieurs gérants sont désignés et disposent souvent (par les statuts ou un acte annexe) de très larges pouvoirs : il peut en principe accomplir tous les actes de gestion réalisés dans l’intérêt de la société. La SCI permet également de distinguer la propriété des parts et leur gestion. Ainsi, des parents qui souhaitent transmettre des biens à leurs enfants tout en conservant la gestion de leur patrimoine, peuvent le faire par la création d’une SCI. Ils donnent alors les parts et se font désigner gérants. De même, les parents peuvent ne donner que la nue-propriété des parts à leurs enfants, tout en en conservant l’usufruit et donc les revenus produits par les biens. Ils veilleront dans les statuts à organiser la répartition des pouvoirs entre nus- propriétaires et usufruitiers.
De plus, elle garantit la pérennité du patrimoine sur plusieurs générations. La SCI, dotée d'une personnalité distincte de ses membres, est instituée pour une durée pouvant aller jusqu'à 99 ans (C. civ., art. 1835 et 1838). Un associé majoritaire ne peut pas imposer aux autres la dissolution anticipée de la SCI. La dissolution judiciaire peut être demandée mais seulement pour justes motifs (inexécution par un associé de ses obligations par exemple). La SCI exclut la vente forcée du bien. L’indivision est au contraire précaire : la loi prévoit que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision. Le partage peut donc toujours être demandé, au besoin par voie judiciaire (art. 815 C. civ.).
L’indivision n’est pas toujours souhaitée (lors d’une succession par exemple). Et lorsqu’un indivisaire décède, ses parts sont transmises à ses héritiers sans possibilité pour les coindivisaires de s’y opposer. Cela peut générer des conflits notamment en multipliant le nombre d’indivisaires. La SCI permet de choisir les personnes avec qui l’ont s’associe et ce, même en cas de décès ou de retrait de l’un des associés. En principe, la cession de parts sociales d’une SCI à un tiers nécessite l’agrément unanime des autres associés (sauf majorité statutaire différente ou accord des gérants si les statuts l'exigent).
Bon à savoir : sauf dispositions contraires des statuts, les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant ne sont pas soumises à agrément. Elle permet d’optimiser la transmission des parts sociales
Les donations de parts sont soumises aux abattements classiques (exemples : 100.000 par parent et par enfant, ou 31.865 euros pour les petits-enfants, renouvelables tous les 15 ans). Donner des parts de société plutôt que des biens immobiliers permet d’ajuster au mieux la valeur transmise et de ne pas dépasser les abattements. Les parents peuvent aussi se réserver l’usufruit des parts, l’assiette fiscale ne sera constituée que de la valeur de la nue-propriété. Au-décès des usufruitiers, les nus-propriétaires deviennent pleinement propriétaires des parts sans avoir de droits de succession à régler. De plus, si la SCI a souscrit un prêt pour financer l’acquisition d’un bien immobilier, la valeur des parts transmises tient compte de ce passif. Enfin, la valeur des parts peut bénéficier d’une décote. La valeur vénale des parts est en effet toujours inférieure à la valeur vénale de l’immeuble ramenée au nombre de parts. Cette décote joue pour les droits de donation et pour les droits de succession.
Des concubins peuvent y recourir pour sécuriser leur situation en cas de décès. Pour cela, ils peuvent effectuer un démembrement de propriété croisé des parts sociales. Chacun possède l’usufruit des parts de l’autre. Ainsi, au décès du premier d’entre eux, l’usufruit sur les parts du survivant s’éteint. Le survivant est donc pleinement propriétaire de la moitié des parts et conserve l’usufruit (la jouissance) des parts du défunt. Suite à l’extinction de l’usufruit, le survivant ne sera pas soumis aux droits de successions de 60%, ce qui constitue un avantage fiscal indéniable. Les concubins peuvent également constituer une SCI pour acheter leur logement “conjugal” et inclure une clause de tontine. Passer par une SCI évitera de payer les 60% de droits de mutation. Mais attention toutefois à la requalification possible par l’administration fiscale en donation déguisée. Les conseils de votre notaire vous guideront et vous permettront d’éviter les faux pas.
Deux personnes suffisent pour constituer une SCI. La loi ne fixe pas de nombre maximum d’associés ni de condition de nationalité, comme dans certaines autres formes de sociétés. Il est même possible pour un mineur d’être associé dans une SCI car elle n’a pas une vocation commerciale.
L’objet social est le type d’activité que la société exerce. Pour être civile, une société doit avoir un objet civil, et ne pourra pas faire d’actes de commerce à titre principal. Il est limité à la gestion d’un patrimoine immobilier. Par exemple est considérée comme une activité civile, l’acquisition de terrains en vue de leur revente après construction . En revanche, est considérée comme une activité commerciale l’achat d’immeuble en vue de leur revente en l’état.
Sa durée doit être déterminée dans les statuts et ne peut pas excéder 99 ans.
Il s’agit d’un contrat de société qui régit son fonctionnement. Ils doivent impérativement être rédigés par écrit. Leur rédaction est assez libre mais il est important d’y insérer certaines clauses relatives par exemple à l’étendue du mandat du gérant, aux règles de majorités lors des votes en assemblée générale, de limiter parfois le droit de vote aux seuls usufruitiers, de prévoir une réglementation spécifique en cas de vente ou échange de parts, de prévoir des règles de majorité relatives aux agréments en cas d’entrée dans la société ou de sortie… Il est recommandé d’avoir recours à un professionnel du droit. Lorsque les statuts constatent l’apport d’un immeuble et chaque fois qu’il y a matière à publicité foncière, ils devront faire l’objet d’un acte authentique rédigé par un notaire.
Les associés de la SCI répondent indéfiniment aux dettes de la SCI et proportionnellement à leurs parts dans le capital social. En effet, les créanciers de la SCI peuvent se retourner contre les associés , et saisir leurs biens personnels en cas de défaillance de la société mais seulement au prorata de leurs parts. En revanche, il n’y a pas de solidarité des associés, ce qui signifie que les créanciers ne peuvent pas se retourner contre un seul associé pour la totalité de la dette.
Les apports sont constitués des biens (immeuble constituant un apport en nature, somme d’argent constituant un apport en numéraire…) dont les associés transfèrent la propriété ou la jouissance à la société, en contrepartie desquels ils reçoivent des parts sociales. Il peut s’agit aussi de compétences ou d’un travail mis au service de la société (apport en industrie). Chaque associé doit faire un apport, quelle que soit sa forme.
Lorsque la SCI dégage des bénéfices, ils sont redistribués aux associés ou mis en réserve afin de garder des ressources à la société. Si les associés ont opté pour une SCI à l’impôt sur le revenu (IR), ils doivent déclarer les revenus qu’ils aient été distribués ou pas. La SCI peut opter pour l’impôt sur les sociétés. Ce régime sera obligatoire si la SCI loue en meublé ou équipé.
Un gérant est nommé pour traiter les affaires courantes. Le gérant est désigné dans les statuts ou dans un acte annexe fixant l’étendue de ses pouvoirs. Les statuts déterminent quelles sont les décisions qui doivent être prises en assemblée et à quelle majorité (généralement, les plus importantes). Certaines décisions sont obligatoirement soumises à la décision des associés (comptes annuels, modifications statutaires, révocation du gérant…). Il est possible de désigner plusieurs gérants. Le gérant peut également avoir des missions administratives : établissement des comptes annuels, du bilan, etc. Dans une SCI familiale constituée uniquement entre parents et enfants et où les parents sont cogérants, la durée de leur mandat n'est en général pas spécifiée et cesse à leur décès ou à la fin de la durée d’existence de la SCI.
Il conviendra dans un premier temps de vous rapprocher de votre notaire pour faire établir les statuts de votre SCI et ce, afin d’éviter tout écueil, leur rédaction pouvant s’avérer délicate. Il se chargera pour vous de faire toutes les formalités nécessaires (enregistrement des statuts, publicité légale, inscription au Centre de Formalité des Entreprises…). Votre notaire sera également d’une aide professionnelle précieuse lors d’une cession de parts sociales.
Source : Notaires.fr