
Vous souhaitez mettre en vente votre maison ou votre appartement mais vous vous posez de nombreuses questions sur la « bonne » démarche à suivre ?
Vous aimeriez vendre seul mais le recours à une agence immobilière ne serait-il pas au final un atout ?
Comment faire pour évaluer au plus juste votre prix de vente ou que devez-vous mettre place avant de démarrer votre vente ?
La vente de « son bien » est un moment important dont il ne faut négliger aucune question ou aucune étape pour une vente sereine et dans les meilleures conditions.
« Mon Guide immobilier » répond pour vous à ces interrogations et vous dévoile les grandes étapes à respecter dans une vente immobilière.
- Choisir de vendre seul ou avec un intermédiaire
- Estimer la valeur de votre bien
- Récupérer les pièces nécessaires à la vente
- Réaliser les diagnostics obligatoires
- Valorisez votre bien avant la mise en vente
- De la promesse à l’acte
Lorsque vous souhaitez vendre votre bien immobilier, vous avez le choix entre vendre de particulier à particulier en réalisant une vente dite “directe”, ou bien de recourir à un intermédiaire qui se chargera de vendre votre bien.
Il s’agit d’une question et d’une décision importante puisqu’elle implique pour chaque choix, des avantages et des inconvénients qu’il est bon d’avoir à l’esprit.
Si vous décidez de vendre votre bien par vous-même :
Sachez qu’il s’agit d’un projet qui peut être long et fastidieux.
Entre le filtrage des appels ou des mails (alors que vous êtes au travail ou en train de vous occuper de vos enfants), la gestion des visites (avec de nombreux curieux auxquels vous n’oserez pas dire non pensant détenir le bon client), les connaissances techniques ou juridiques exigées, la vente d’un bien se révèle parfois très énergivore ! Cela ne s’improvise donc pas, surtout si c’est la première fois que vous tentez de vendre un bien seul.
Malgré toutes ses contraintes, vous vous dites que vous allez faire l’économie de frais d’agences qui peuvent parfois se révéler réellement exorbitants !
Si nous sommes d’accord avec vous sur le fait que beaucoup d’agences ou réseaux pratiquent des honoraires trop élevés, la présence aujourd’hui sur le marché de professionnels travaillant AU FORFAIT (avec des honoraires fixes et réduits remet sérieusement en cause la question de se passer ou pas des services d’un professionnel.
(Pour en savoir plus sur les avantages d’une agence au FORFAIT, lisez notre article en cliquant sur lien suivant: « honoraires d’agence le service à ne pas négliger – des économies à la clé » )
Un dernier point à prendre en compte : vendre son bien immobilier seul peut dans certain cas vous faire perdre de l’argent si votre négociation n’est pas parfaite.
Si vous désirez faire appel à une agence immobilière :
Vous devez savoir en premier lieu que votre « prix net vendeur » sera augmenté du montant des honoraires d’agences qui sont de l’ordre de 5,5 % en moyenne. En revanche, vous pouvez d’importantes économies en faisant appel à une agence immobilière innovante « au FORFAIT ». (Lien cité ci-dessus)
Cela étant, avoir recours à un intermédiaire se montre très intéressant à plusieurs titres.
L’agence se charge de publier votre annonce sur les différents portails de publication à forte audience (payant pour les particuliers), la valorise, fait visiter votre bien et vous suit dans la préparation du dossier de vente. Le recours à un professionnel de l’immobilier présente le double avantage d’offrir le confort d’une vente sans encombre et sans tracas mais aussi d’éviter certains écueils qui peuvent se montrer destructeurs si vous vendez votre bien vous-même : une annonce mal rédigée avec des photos qui ne mettent pas le bien en valeur, un prix qui se situe hors marché, un prix mal négocié ou encore des atouts de votre bien mal mis en avant.
Élément incontournable de la mise en vente de votre bien, l’estimation constitue l’une des étapes phares de votre projet. Quelle est la valeur de mon d’appartement ? Combien vaut ma maison ? A quel prix dois-je vendre mon bien immobilier ?
A ces questions il convient d’y répondre de manière toute relative.
En effet, si un particulier a tendance à donner à son propre bien une valeur affective, il en est moins sûr de sa valeur réelle.
Explications : de très nombreux critères s’inscrivent dans l’équation qui vise à déterminer la valeur d’un bien immobilier, à commencer par ses atouts : luminosité, situation géographique, exposition, vis-à-vis, agencement, prestations proposées, les travaux potentiels à réaliser etc.
Il est aussi bon de déterminer la consommation en énergie de votre logement, élément qui peut freiner la vente ou conduire lors des négociations à la baisse de la valeur de votre bien si ce dernier est trop friand d’énergie. Il sera donc opportun de réaliser les diagnostics immobiliers de manière concomitante à l’estimation de votre bien immobilier. En effet, il sera difficile de donner une estimation immobilière définitive d’un appartement sans connaître par exemple le métrage au sens loi carrez !
A l’inverse, si vous savez que des infrastructures sont amenées à être créées dans un avenir proche à proximité de votre bien (un arrêt de métro à 500 mètres du bien par exemple), alors l’estimation pourra être révisée à la hausse. Si vous n’êtes certains de rien et que vous souhaitez éviter la déconvenue qui pourrait résulter d’une non-vente ou de négociations à répétition avec des particuliers, faites estimer votre bien par un professionnel qui saura déterminer la juste valeur de ce dernier. Il conviendra de définir le prix net vendeur et le prix HAI, avec une réelle stratégie de vente.
L’estimation d’un bien nécessite non seulement des connaissances pointues en matière d’immobilier, mais aussi un œil « neuf » et impartial (différent du propriétaire basé sur l’affection) .
C’est pourquoi il vous est donc conseillé de réaliser votre estimation par un professionnel.
« Mon guide immobilier » vous propose une 1ere estimation GRATUITE avec un outil d'estimation immobilière tenant compte de critères précis et déterminant pouvant influer sur le prix au m². Munissez-vous des informations suivantes sur le bien : adresse, surface, nombre de pièces et nombre de chambres, année de construction puis : Cliquez sur le lien suivant : J’estime mon bien avec Mon Guide Immobilier
Il convient de se munir d’un certain nombre de documents obligatoires pour mettre en vente son bien. Ils sont un prérequis à la vente et sans eux, aucune transaction ne peut s’effectuer. Voici la liste de documents que vous devez donc être en mesure de fournir :
- Le titre de propriété (remis lors de l’achat du bien immobilier)
- Les trois derniers procès-verbaux des réunions de copropriétaires (s’il s’agit d’un logement soumis au régime de la copropriété)
- Un règlement de la copropriété ou du lotissement
- Un certificat de non-hypothèque
- Le Dossier du Diagnostic Technique (ou DDT) (performance énergétique du bien, amiante, exposition au plomb, installation électricité, installation gaz, termites, risques naturels, miniers & technologiques, etc.) …
En cas de perte de votre acte de propriété, il est possible d’en obtenir une copie payante auprès de votre notaire ou du service de publicité foncière.
Tout vendeur d’un bien immobilier doit respecter cette obligation d’information.
Il doit fournir au potentiel acquéreur un certain nombre de diagnostics techniques dès l’annonce de mise en vente (Pour le diagnostic de performance énergétique) ou avant de pouvoir signer une promesse de vente. (pour d’autres diagnostics)
La liste obligatoire dépend du type de bien. Vous devez donc prendre contact avec un professionnel certifié pour avoir un devis exact et précis pour votre bien.
Pour connaitre les différents diagnostics en vigueur , reportez-vous à notre article en cliquant sur le lien suivant : « Les diagnostics immobiliers »
Bon à savoir : un professionnel certifié par un organisme accrédité doit réaliser les diagnostics, sans quoi ils ne sont pas valides. En cas d’erreur, le diagnostiqueur peut être juridiquement tenu responsable.
Vendre son bien ne se résume pas à une simple transaction ou passer une petite annonce, il est important de « mettre en valeur » votre bien.
En effet, il faut que le potentiel acquéreur puisse se projeter dans le bien qu’il visite. Et pour cela il faut que vous mettiez en scène votre appartement ou votre maison et que vous ne négligiezrien, qu’il s’agisse de l’intérieur comme de l’extérieur.
Quelques conseils :
- En finir avec l’encombrement : Il s’agit de se séparer uniquement de mobiliers superflus dont vous pouvez largement vous passer. Cela permet d’améliorer la perception de l’espace.
- Repositionnez éventuellement vos meubles (canapés et chaises) pour former des groupes espaces confortables de sorte que le flux de circulation dans une pièce soit évident. Cela rendra l’espace plus convivial.
- Montrer un bien achevé : Les projets inachevés peuvent effrayer les acheteurs potentiels, alors finissez-les. Les plinthes manquantes, un seuil de porte absent, un mur non peint encore en placo….. ont tendance à être un drapeau rouge pour l’éventuel acheteur.
De plus, il vous coûtera moins cher de le réparer plutôt que les acheteurs négocient sur le prix de vente affiché.
- Nettoyer votre bien de fond en comble. Cela peut sembler couler de source, mais ô combien il est repoussant pour un visiteur de tomber sur un logement poussiéreux et mal rangé. Alors, ne ruiner pas vos chances de réussite avant même que la visite n’ait lieu et rendez votre bien propre !
- A cela peut s’ajouter la dépersonnalisation du logement, le rafraîchissement des murs et du plafond ou encore réalisation de menus travaux si besoin est. Notez cependant qu’il est déconseillé d’engager plus de 2 à 3 % du montant de votre bien pour réaliser vos travaux, il s’agit simplement de rénover votre logement pour le rendre attirant aux yeux des visiteurs.
Lorsque vous aurez un acquéreur, vous pourrez signer avec lui une « promesse de vente » permettant de formaliser l’intention d’achat du bien immobilier par ce dernier.
Le délai entre la signature de la promesse de vente et la vente effective (Acte authentique) est généralement de 3 à 4 mois. En effet, différentes formalités administratives doivent être effectuées pendant ce temps-là.
Tant que l’acte authentique n’est pas signé chez le notaire, la vente n’est pas définitivement scellée.
Cette période est le bon moment pour faire vos cartons et préparer votre déménagement. Si vous n’avez pas encore trouvé votre nouveau logement, n’hésitez pas à chercher un endroit où stocker vos affaires.
Faites votre 1ère estimation qui vous permettra de vous positionner rapidement face à une concurrence parfois rude du marché et d’éviter toute déception.
Cliquez sur le lien suivant : J’estime mon bien avec Mon Guide Immobilier

Acte de vente d'un logement existant
Dès que toutes les conditions pour la réalisation de la vente sont réunies, un acte de vente définitif est rédigé et signé chez un notaire. Le transfert de propriété est immédiat.
1- Contenu de l’acte
L'acte de vente doit mentionner les informations suivantes :
- Coordonnées du vendeur et de l'acheteur
- Adresse du bien
- Origine du bien (date du précédent acte de vente, nom du précédent propriétaire, acte notarié...)
- Descriptif détaillé du bien, de ses équipements et annexes
- Existence d'une hypothèque et/ou d'une servitude
- Prix de vente
- Modes de paiement (avec ou sans l'aide d'un prêt immobilier)
- Montant des honoraires de la personne chargée de la vente et à qui en incombe le paiement
- Date de disponibilité du bien
- Conditions suspensives lorsqu'il en exist
- Informations relatives à la copropriété
- Informations relatives aux conditions d'exercice du droit de réflexion quand il n'y a pas eu de promesse de vente
L'absence d'information sur le droit de réflexion est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut
excéder 3000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale
- L'acte de vente doit obligatoirement être accompagné du dossier de diagnostics techniques immobiliers.
2- Délai de réflexion
Si le contrat n'est pas précédé d'une promesse de vente, l'acheteur dispose d'un délai de réflexion de 10 jours avant de signer l'acte de vente.
Le projet d'acte de vente est remis à l'acquéreur par lettre recommandée ou en main propre. Le délai de réflexion commence le lendemain de la 1re présentation de la lettre recommandée ou de sa remise en main propre.
En aucun cas, l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de 10 jours.
Si le dernier jour du délai de réflexion est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'au 1erjour ouvrable
Attention
Aucune somme ne peut être réclamée durant le délai de réflexion.
3- Signature de l'acte
L'acte authentiqueest obligatoirement établi par un notaire.
L'acte doit être signé par le vendeur et l'acquéreur. Quand l'un d'entre eux ne peut être présent, il peut se faire représenter en confiant à un tiers une procuration
Le notaire garde le seul original de l'acte, appelé la minute. Il enregistre l'acte de vente au fichier immobilier, situé au service de publicité foncière dont dépend le bien, et au cadastre. Cet enregistrement rend l'acte de vente opposable aux tiers
Le jour de la signature du contrat de vente, le notaire remet une attestation de propriété immobilière à l'acheteur.
L'acte de vente peut être signé sur support électronique, on parle d'un acte authentique électronique (AAE). Dans ce cas, le notaire prépare l'acte sur un logiciel de rédaction. Il joint l'ensemble des pièces annexes qu'il scanne. L'acte est lu sur écran par l'ensemble des parties et le notaire recueille électroniquement les signatures.
L'acheteur reçoit une attestation de propriété. À sa demande, il peut également obtenir la copie de l'acte par voie électronique.
L'AAE est envoyé automatiquement dans un minutier central (MICEN) établi et contrôlé par le Conseil supérieur du notariat. L'acte, ses annexes et les signatures de toutes les parties sont conservés dans un fichier.
La remise des clés à l'acquéreur se fait, en principe, à l'issue de la séance de signatures.
4- Notification de l'acte de vente
Le notaire conserve la minute. Après l'enregistrement auprès du service de publicité foncière, il remet la copie de l'acte de vente à l'acheteur, en main propre, par lettre recommandée avec avis de réception ou par commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire).
Cette copie revêtue des cachets de l'administration fiscale constitue le titre de propriété.
5- Règlement du prix de vente
Le jour de la signature de l'acte, l'acquéreur paye le prix indiqué dans le contrat, déduction faite du montant de la somme versée lors de la signature du compromis de vente.
En général, l'acheteur paye les frais de notaire.
Source : Service-Public.fr

Acte de vente d'un logement existant
Dès que toutes les conditions pour la réalisation de la vente sont réunies, un acte de vente définitif est rédigé et signé chez un notaire. Le transfert de propriété est immédiat.
1- Contenu de l’acte
L'acte de vente doit mentionner les informations suivantes :
- Coordonnées du vendeur et de l'acheteur
- Adresse du bien
- Origine du bien (date du précédent acte de vente, nom du précédent propriétaire, acte notarié...)
- Descriptif détaillé du bien, de ses équipements et annexes
- Existence d'une hypothèque et/ou d'une servitude
- Prix de vente
- Modes de paiement (avec ou sans l'aide d'un prêt immobilier)
- Montant des honoraires de la personne chargée de la vente et à qui en incombe le paiement
- Date de disponibilité du bien
- Conditions suspensives lorsqu'il en existe
- Informations relatives à la copropriété
- Informations relatives aux conditions d'exercice du droit de réflexion quand il n'y a pas eu de promesse de vente
L'absence d'information sur le droit de réflexion est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale
- L'acte de vente doit obligatoirement être accompagné du dossier de diagnostics techniques immobiliers.
2- Délai de réflexion
Si le contrat n'est pas précédé d'une promesse de vente, l'acheteur dispose d'un délai de réflexion de 10 jours avant de signer l'acte de vente.
Le projet d'acte de vente est remis à l'acquéreur par lettre recommandée ou en main propre. Le délai de réflexion commence le lendemain de la 1re présentation de la lettre recommandée ou de sa remise en main propre.
En aucun cas, l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de 10 jours.
Si le dernier jour du délai de réflexion est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'au 1erjour ouvrable
Attention
Aucune somme ne peut être réclamée durant le délai de réflexion.
3- Signature de l'acte
L'acte authentiqueest obligatoirement établi par un notaire.
L'acte doit être signé par le vendeur et l'acquéreur. Quand l'un d'entre eux ne peut être présent, il peut se faire représenter en confiant à un tiers une procuration
Le notaire garde le seul original de l'acte, appelé la minute. Il enregistre l'acte de vente au fichier immobilier, situé au service de publicité foncière dont dépend le bien, et au cadastre. Cet enregistrement rend l'acte de vente opposable aux tiers
Le jour de la signature du contrat de vente, le notaire remet une attestation de propriété immobilière à l'acheteur.
L'acte de vente peut être signé sur support électronique, on parle d'un acte authentique électronique (AAE). Dans ce cas, le notaire prépare l'acte sur un logiciel de rédaction. Il joint l'ensemble des pièces annexes qu'il scanne. L'acte est lu sur écran par l'ensemble des parties et le notaire recueille électroniquement les signatures.
L'acheteur reçoit une attestation de propriété. À sa demande, il peut également obtenir la copie de l'acte par voie électronique.
L'AAE est envoyé automatiquement dans un minutier central (MICEN) établi et contrôlé par le Conseil supérieur du notariat. L'acte, ses annexes et les signatures de toutes les parties sont conservés dans un fichier.
La remise des clés à l'acquéreur se fait, en principe, à l'issue de la séance de signatures.
4- Notification de l'acte de vente
Le notaire conserve la minute. Après l'enregistrement auprès du service de publicité foncière, il remet la copie de l'acte de vente à l'acheteur, en main propre, par lettre recommandée avec avis de réception ou par commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire).
Cette copie revêtue des cachets de l'administration fiscale constitue le titre de propriété.
5- Règlement du prix de vente
Le jour de la signature de l'acte, l'acquéreur paye le prix indiqué dans le contrat, déduction faite du montant de la somme versée lors de la signature du compromis de vente.
En général, l'acheteur paye les frais de notaire.
Source : Service-Public.fr

L'agent immobilier agit en tant qu’intermédiaire entre deux ou plusieurs parties pour la réalisation d'un achat, d'une vente ou d'une location d'immeuble, de fonds de commerce ou de parts de société.
Le consommateur doit être vigilant dans son choix de l'agent immobilier et dans sa prise de décision.
1- Les conditions d'exercice de l'activité
Les activités de l'agent immobilier sont régies par la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite "loi Hoguet" et son décret d'application n°72-678 du 20 juillet 1972.
L'activité d’agent immobilier peut être exercée soit à titre individuel, soit sans le cadre d'une structure sociétaire, voire même par le biais d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901. En revanche, elle ne peut être exercée dans le cadre du statut d'auto-entrepreneur.
L'exercice de la profession d'agent immobilier requiert l'exécution de deux formalités administratives particulières :
- L’agent immobilier doit être titulaire d'une carte professionnelle, soumise à des conditions d'aptitude professionnelle et de moralité, délivrée par le Président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale (CCI) pour 3 ans ;
- Il doit également disposer d’une garantie financière auprès d’une banque ou d’une organisation professionnelle (une exception est prévue pour les agences qui se sont engagées sur l’honneur à ne recevoir d’autres sommes que celles de leur rémunération) ;
- Et avoir souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle (RCP).
Les négociateurs immobiliers (salariés ou agents commerciaux) habilités à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte du titulaire de la carte professionnelle doivent justifier de leur qualité et de l’étendue de leurs pouvoirs au moyen d’une attestation. Cette attestation est délivrée par le titulaire de carte et doit être visée par le président de la CCI compétente. Depuis la promulgation de la loi du 24 mars 2014, les négociateurs immobiliers doivent en outre justifier de leur compétence professionnelle.
Par ailleurs, une déclaration préalable d'activité doit être souscrite auprès de la CCI pour chaque établissement secondaire par la personne qui en assume la direction.
Enfin, l’agent immobilier doit détenir un mandat écrit l'autorisant à négocier ou à s'engager pour le compte du propriétaire ou du bailleur. Ce mandat doit donc être détenu préalablement à tout acte d’entremise ou de négociation
2- Le devoir de conseil de l'agent immobilier
L'agent immobilier est tenu d’un devoir de conseil.
Il doit s’assurer de la régularité de la transaction et ainsi transmettre toutes les informations techniques nécessaires aux parties.
L'intermédiaire professionnel, négociateur et rédacteur de l'acte, est tenu de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention.
L'agent immobilier est responsable des mentions qui figurent dans l'acte qu'il fait signer. En matière de vente par exemple, il vérifie que le client est bien propriétaire du bien immobilier à vendre ou qu'il a la capacité de le vendre. Il vérifie le titre de propriété du vendeur, la surface du bien, l'existence de servitudes, la réalité des diagnostics immobiliers obligatoires qui incombent au propriétaire du bien (amiante, termites, bilan énergétique, etc.).
Dans le cas de vices cachés, sa responsabilité n'est engagée que s'il avait connaissance de l'information ou si l'examen des lieux avait montré la présence de ces vices.
Dans le cadre d'une vente immobilière, un agent immobilier doit remplir plusieurs obligations. Il doit avoir un mandat écrit du vendeur. Il est tenu d'informer les consommateurs sur son statut d'agent immobilier, sur ses tarifs et sur les biens vendus. Enfin, il a un devoir de conseil auprès de ses clients
1- MANDAT
Avant de mettre en vente un bien immobilier, l'agent immobilier doit disposer d'un mandat écrit, signé et en cours de validité. Le mandat de vente comporte notamment les mentions suivantes :
- Objet et durée du mandat (généralement 3 mois)
- Désignation du ou des propriétaires en cas d'indivision
- Coordonnées de l'agent et numéro de sa carte professionnelle
- Honoraires (frais d'agence), ainsi que la mention de qui en aura la charge
- Conditions de maniement des fonds et de reddition des comptes
- Moyens mis en œuvre par l'agent pour réaliser la vente - Numéro d'enregistrement du mandat dans le registre des mandats de l'agence
Il existe plusieurs types de mandat :
- Le mandat simple permet au propriétaire de confier la vente à plusieurs agences et de vendre lui-même son bien.
- Le mandat semi-exclusif est signé avec une seule agence et le propriétaire peut vendre son bien lui-même.
- Le mandat exclusif est signé avec une agence, seule à pouvoir vendre le bien.
2- PUBLICITE SUR LE STATUT D’AGENT IMMOBILIER
Dans tous les lieux où il reçoit sa clientèle, l'agent immobilier doit afficher les éléments suivants, en évidence :
- Numéro de sa carte professionnelle
- Montant de la garantie financière
- Adresse du garant
S'il perçoit des fonds lors de transactions immobilières, l'affiche indique les informations suivantes :
- Banque et numéro du compte où doivent être effectués les versements et les remises
- Modes obligatoires de versement.
Il est aussi précisé que l'agent immobilier doit délivrer un reçu dont un double est conservé dans un carnet de reçus.
3- AFFICHAGE BAREME DES PRESTATIONS
L'agent immobilier est tenu d'afficher les prix de ses prestations toutes taxes comprises (TTC).
Le barème de ses honoraires est affiché de façon lisible et visible à l'entrée des établissements recevant de la clientèle. Quand l'établissement dispose d'une vitrine, il doit être parfaitement visible depuis l'extérieur. Les prix sont affichés dans le même format et au même emplacement que celui normalement réservé aux annonces immobilières.
Le barème doit être accessible sur le site internet du professionnel. Les prix sont également donnés sur les autres sites ou font l'objet d'un renvoi vers l'information.
Lorsque les honoraires proportionnels varient selon les tranches de prix de vente du bien, l'agent immobilier doit préciser de manière très apparente et intelligible si celles-ci sont cumulatives entre elles.
L'affiche doit également préciser pour chacune des prestations à qui en incombe le paiement.
Les honoraires affichés doivent être effectivement pratiqués à l'issue des transactions réalisées par l'intermédiaire du professionnel.
4- ANNONCE IMMOBILIERE
Le professionnel doit fournir les informations suivantes quand il rédige une annonce :
- Prix de vente du bien vendu
- Montant des honoraires toutes taxes comprises (TTC) exprimé en pourcentage
- Paiement des honoraires par l'acquéreur ou par le vendeur
Si les honoraires sont à la charge de l'acquéreur, le prix de vente est exprimé honoraires inclus et exclus. Les prix honoraires inclus doit apparaître en caractères plus importants. Le montant TTC des honoraires à la charge de l'acquéreur est précédé de la mention Honoraires et est exprimé en pourcentage de la valeur du bien hors honoraires.
Si les honoraires sont à la charge exclusive du vendeur, seul le prix de vente hors honoraires doit être mentionné.
Lorsque les honoraires proportionnels varient selon les tranches de prix de vente du bien, l'agent immobilier doit préciser de manière très apparente et intelligible si celles-ci sont cumulatives entre elles.
Les annonces immobilières affichent également le diagnostic de performance énergétique (DPE), qui permet d'estimer la consommation énergétique d'un logement et son taux d'émission de gaz à effet de serre.
Ces informations doivent être facilement accessibles quel que soit le support utilisé par le professionnel pour la publicité (vitrines, site internet...).
Les annonces concernant une vente en copropriété doivent indiquer les points suivants :
- Bien vendu soumis au statut de la copropriété
- Nombre de lots de copropriété dans l'immeuble
- Montant moyen annuel des charges payées par le vendeur
- Procédure en cours en raison des difficultés rencontrées par la copropriété (mesures préventives, plan de sauvegarde...)
CONSEIL
L'agent immobilier est tenu à un devoir de conseil. Il s'assure de la régularité de la transaction et transmet aux parties toutes les informations techniques nécessaires. Pour ce faire, il vérifie notamment les points suivants :
- Titre de propriété du vendeur (en cas d'indivision tous les propriétaires doivent accepter la vente du bien)
- Statuts et compte-rendu de l'assemblée générale qui autorise la vente, pour une société civile immobilière (SCI)
- Caractéristiques du bien fournies par le vendeur (surface, existence d'éventuelles servitudes, diagnostics immobiliers obligatoires...) - - Solvabilité de l'acquéreur en lui demandant, par exemple, son apport personnel

Vous avez dans l’idée de vendre votre bien et vous avez réalisé une estimation avec plusieurs agences !
Mais vous vous demandez si vous devez leur confier la vente ?
D’après une étude d’OpinionWay (2018), 38% des particuliers essayant de vendre seuls ne parviendront pas à concrétiser la vente.
Pour la vente, les agences immobilières sont 2,5 fois plus efficaces que les particuliers vendeurs (Etude Meilleurs Agents 2012).
Alors oui, en passant par un agent immobilier, vous augmenterez fortement vos chances mais vous profiterez aussi d’autres avantages tels que :
1- S’assurer une estimation d’un expert
Vous avez peut-être déjà fait une estimation en ligne mais les fourchettes de prix que l’on vous donne sont tellement larges qu’il vous sera difficile encore de trouver « le juste prix ».
Pour vous assurer de fixer le bon prix, l’aide d’un agent immobilier est indispensable.
À votre avis, pourquoi ?
Par définition, l’agent immobilier :
- connaît le marché immobilier
- prend en compte les prix réels des dernières transactions
- maîtrise son secteur géographique
- appréhende les attentes des acheteurs
L’agent immobilier vous garantit de positionner votre bien sur des fourchettes de prix réalistes. Il a toute l’expertise pour connaître le bon prix de votre logement au bon moment.
Sachez que plus votre bien sera vu avec un prix exorbitant sur le marché, plus les acheteurs chercheront à négocier le prix à la baisse…
Une bonne nouvelle : Une majorité d’agences estiment gratuitement votre bien immobilier.
En fonction de son analyse, vous pourrez juger de son professionnalisme et de sa réactivité dès le premier rendez-vous.
IMPORTANT :
- L’estimation doit contenir un rapport détaillé de votre bien. Cela vous indiquera que l’agent immobilier est rigoureux et tient à être transparent avec ses clients.
Ne jamais tenir compte d’une estimation qui vous donne seulement un prix de vente . Vous aurez affaire à un pseudo-professionnel qui vous annoncera la plus part du temps un prix de vente « fort » dans le seul but de vous faire rêver et de pouvoir « renter un mandat » coute que coute.
N’oubliez pas que « les conseilleurs ne sont pas les payeurs ».
Un bon agent immobilier n’aura pas peur de vous dire le bon prix au risque de vous décevoir.
- Faites appel à un mandataire « local » : Qui peut mieux connaitre un marché local qu’une personne qui habite ou travaille habituellement le secteur ou vous habiter !
Bannissez les professionnels qui ne sont pas du secteur qui viennent juste chercher un « mandat » (parce qu’ils ne peuvent pas en rentrer ailleurs). Que connait-on des prix du marché quand on vient une fois par an sur un secteur ?
2- Maximiser ses chances de vendre
Au-delà de l’estimation de votre bien, vous allez profiter avec un agent immobilier d’un vivier d’acheteurs grâce à son fichier client , son réseau local et professionnel. Il a également à sa disposition un certain nombre de moyens pour médiatiser votre vente :
- publier les photos de votre bien sûr sur des sites spécialisés (non accessibles au particulier) ou sur son propre site internet.
- distribuer des flyers avec des photos de votre bien immobilier
- acheter des encarts publicitaires dans des magazines locaux et gratuits
Autre atout du professionnel, il peut vous proposer un certain nombre de services pour mettre en valeur votre bien immobilier. Pour l’annonce immobilière, il vous produira des photographies ou vidéo de qualité. Et pour la rédaction de l’annonce, il décrira votre bien immobilier avec des expressions qui parlent aux acheteurs. Certains agents immobiliers proposent même de filmer votre bien à 360°pour offrir aux prospects, tranquillement installés dans leur canapé une visite virtuelle.
Attention, certains peuvent vous proposer du home-staging réels ou virtuels pour relooker votre bien pour essayer de le rendre plus attractif. EVITEZ LE HOME STAGING car si le bien parait bien attrayant et peut amener des visites, les clients sont à la visite fortement déçus de voir un bien qui ne correspond à ce qu’ils espéraient. Par expérience, une visite doit toujours surprendre agréablement un client et non le décevoir dès son arrivée.
3- Un accompagnement complet et sur-mesure
- L’agent immobilier vous aide dans le choix des clients
La préoccupation première d’un vendeur est de trouver des acheteurs.
Or quand arrivera le moment de la sélection, le choix pourrait s’avérer difficile. Le professionnel saura vous apporter toute l’aide nécessaire pour distinguer les « bons profils » avec de réelles motivations d’achat (qui va donc aller au bout du projet) ?
- L’agent immobilier vous évite des moments désagréables.
En effet, il aura la distance nécessaire quand les visiteurs feront des remarques désobligeantes sur votre logement…Mieux vaut vous éviter ces moments désagréables qui vous rendraient la vente plus pénible.
- L’agent immobilier sélectionne les dossiers les plus solides pour s’assurer qu’il n’y a aucun risque de défaut de financement. Il vérifie la solvabilité des acheteurs : leurs revenus, les apports personnels et les crédits possibles.
- Son métier est de travailler pour vous ; de vous consacrer tout son emploi du temps. De votre côté, en tant que particulier vendeur, il faut avoir un emploi du temps flexible. (vous ne pourrez pas prendre des congés ou des RTT pour répondre à toutes les demandes.) pour organiser les visites de votre bien. Et si en plus, vous devez gérer des personnes qui viennent juste voir votre bien en touriste, vous n’allez pas vraiment apprécier. L’agent immobilier va faire barrage à toutes les demandes les plus ubuesques.
La réactivité à répondre et prendre en charge le client est capitale. Sinon le client appelle sur d’autres annonces et ira visiter en premier lieu d’autres biens à la place du votre. Pouvez vous en tant que particulier être toujours disponible (quand vous êtes à votre travail , en réunion ou en train de vous occuper de vos enfants ?)
- L’agent immobilier est formé pour gérer une négociation :
Il est rompu aux techniques de ventes immobilières et motivés par ses honoraires ? Contrairement à vous, l’agent aura tout le recul nécessaire pour négocier sur la base d’arguments factuels. Son objectif étant de vendre, il saura déceler lorsque la négociation est arrivée à sa limite.
- L’agent immobilier vous assiste sur toutes les démarches administratives et techniques pour votre vente : fournir à l’acheteur tous les justificatifs comme les informations sur le syndic, les travaux de copropriété, les impôts fonciers …vérifier les 10 diagnostics immobiliers obligatoires et contacter le bon professionnel pour les exécuter et mesurer précisément la surface habitable de la loi Carrez
Confier la vente de votre bien vous assure de gagner du temps, de l’efficacité, de la tranquillité d’esprit et surtout une sécurité. Un agent immobilier est là pour mettre tout en œuvre afin que votre transaction se passe bien et que vous vendiez au meilleur prix.

Vous envisagez de vendre votre bien immobilier ?
Mais vous ne savez pas s’il vaut mieux vendre seul ou passer par un intermédiaire ? Vous avez de bonnes raisons de vous poser la question, car si l’entreprise de la vente en direct est tentante, elle peut s’avérer plus complexe que prévu.
D’après une étude d’OpinionWay (2018), 38% des particuliers essayant de vendre seuls ne parviendront pas à concrétiser la vente. Autre donnée univoque : les agences immobilières sont 2,5 fois plus efficaces que les particuliers vendeurs (Étude Meilleurs Agents 2012).
En confiant la vente de votre bien à un professionnel, vous augmentez vos chances de conclure la transaction, mais vous bénéficiez aussi d’autres avantages
1- Vous bénéficiez de l’estimation fine d’un expert de l’immobilier !
Pour vous assurer de fixer le bon prix, l’aide d’un agent immobilier est indispensable. En effet, le professionnel :
- Connaît le marché immobilier,
- Prend en compte les prix réels des dernières transactions,
- Maîtrise son secteur géographique,
- Appréhende les attentes des acheteurs.
Il vous offre la garantie de positionner votre bien sur des fourchettes de prix réalistes. Il détient toute l’expertise et l’expérience nécessaires pour connaître le juste prix de votre logement à un moment donné.
Mettre en vente au prix juste est un élément clé pour maximiser les chances de vendre rapidement. Sachez que plus votre bien affichera un prix exorbitant sur le marché, plus les potentiels acquéreurs chercheront à négocier ce prix à la baisse… Bonne nouvelle, la plupart des agences estiment gratuitement votre bien immobilier. En fonction de leur analyse, vous pourrez juger de leur professionnalisme et de leur réactivité, dès le premier rendez-vous.
Pour s’assurer d’avoir un mandat de vente, la plupart des professionnels vous proposent un rapport détaillé sur l’estimation de votre bien. Cet élément vous indique que l’agent immobilier est rigoureux et tient à être transparent avec ses clients.
2- Vous bénéficiez d’un réseau professionnel tentaculaire et des canaux de communication dédiés
Au-delà de l’estimation du bien, vous allez profiter avec un professionnel d’un vivier d’acheteurs grâce à son fichier « clients », son réseau local et professionnel.
Autre atout du professionnel : il peut vous proposer un certain nombre de services pour mettre en valeur votre bien immobilier. Pour rendre votre annonce immobilière plus attractive, il produira des photographies ou des vidéos de qualité. La rédaction de l’annonce sera soignée avec des mots et expressions qui parlent aux potentiels acheteurs. Certains agents immobiliers proposent même une visite virtuelle à 360° de votre bien pour offrir aux clients une visite tranquillement installés dans leur canapé.
3- Vous bénéficiez d’un accompagnement complet et sur-mesure
Votre première préoccupation est de trouver des acheteurs. Et quand vient le moment de la sélection, le choix peut s’avérer difficile. Comment distinguer les « bons profils » avec de réelles motivations d’achat ?
Quel acquéreur ira au bout de la transaction ? Le professionnel possède l’expertise et le recul nécessaire pour faire le tri parmi les offres d’achats que vous recevez.
De plus, l’agent immobilier sélectionne les dossiers les plus solides pour s’assurer qu’il n’y a aucun risque de défaut de financement. Il vérifie la solvabilité des acheteurs : leurs revenus, les apports personnels et les crédits possibles. Son temps est dédié à votre projet immobilier. Il répond aux sollicitations, organise les visites en fonction des disponibilités des acheteurs, et il sait faire barrage avec courtoisie aux demandes les plus farfelues.
Autant dire que le particulier qui souhaite revêtir l’habit du professionnel doit avoir un emploi du temps flexible, pouvoir prendre des RTT le cas échéant afin de répondre à toutes les demandes et organiser les visites. Il devra aussi faire preuve d’une patience à toute épreuve pour gérer les visites de touristes qui viennent juste prendre le pouls du marché.
Pour gérer la négociation, qui de mieux qu’un agent rompu aux techniques de ventes immobilières et motivé par ses honoraires ?
Contrairement à un particulier, le professionnel aura tout le recul nécessaire pour négocier sur la base d’arguments factuels. Son objectif étant de vendre, il saura déceler lorsque la négociation est arrivée à sa limite.
Enfin, l’agent immobilier va vous assister sur toutes les démarches administratives et techniques pour la mise en vente :
- Fournir à l’acheteur tous les justificatifs comme les informations sur le syndic, les travaux de copropriété, les impôts fonciers et la taxe d’habitation…
- Vérifier les dix diagnostics immobiliers obligatoires et contacter le bon professionnel pour les exécuter,
- Mesurer précisément la surface habitable de la loi Carrez.
4- Vous bénéficiez d’une transaction sécurisée garantie
La signature de l’acte authentique devant le notaire est le point d’orgue d’une vente. Mais cette belle aventure peut rapidement virer « au cauchemar » si une étape juridique essentielle a été oubliée. Pour éviter ce désagrément, confiez cette tâche à un professionnel qui connait sur le bout des doigts toutes les démarches juridiques à effectuer.
Vous bénéficierez alors d’une transaction sécurisée et vous aurez le sommeil plus paisible.
Lors de la vente, le professionnel :
- Prend en charge l’organisation du compromis de vente et fait l’intermédiaire avec les différents notaires
- S’assure de la qualité du dossier financier des acheteurs (autant de paramètres difficiles à contrôler pour un particulier non spécialiste),
- S’assure du respect du délai de rétractation,
- Fait le lien entre vous, l’acquéreur et le notaire.
D’après une étude OpinionWay (2018), vous êtes 53 % à être inquiets concernant la vente de votre bien.
Confier la vente de votre bien vous garantit un gain de temps, une meilleure efficacité et surtout de la tranquillité d’esprit.
Eviter tout stress, ou même une annulation de votre vente et laissez faire le pro, qui mettra tout en œuvre pour que la transaction se passe bien et pour vendre au meilleur prix.
À ce sujet, une étude Meilleurs Agents montre que le prix net vendeur est équivalent entre les ventes en direct et les ventes réalisées par un intermédiaire. Concrètement, cela signifie que les agents immobiliers vous permettent de vendre votre bien plus cher que si vous le faites seul. Il n’y a donc que des avantages : vous ne perdez pas d’argent et vous gagnez du temps.
Qui dit mieux ?
Voir nos autres articles sur le sujet :
Honoraires d’agences- Le service à ne pas négliger- des économies à la clé
L'assainissement a pour objet la collecte, l'évacuation et le traitement des eaux usées : les eaux vannes (eau des WC) et les eaux grises (eau de la cuisine, du lave-linge...). Il peut être collectif ou tout-à- l'égout) ou individuel avec une fosse septique
1- Définition Assainissement Collectif
Votre maison est raccordée au réseau communal, le tout-à-l'égout. L'égout est connecté à un collecteur qui conduit les eaux usées vers la station d'épuration. Elles sont traitées avec les eaux pluviales, ou séparément.
La commune est tenue d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées.
Le choix de la mise en place d'un assainissement collectif dépend de la commune.
Vous avez la possibilité de consulter en mairie le zonage d'assainissement qui délimite les zones d'assainissement collectif et non collectif.
2- Définition Assainissement Non Collectif
Si votre maison n'est pas raccordée au réseau collectif, vous devez vous équiper d'un système d'assainissement autonome, individuel. Vous aurez le choix entre différents dispositifs (fosses toutes eaux et épandage, microstation par exemple).
Attention
Quand un réseau d'assainissement collectif est mis en place dans votre commune, vous avez 2 ans pour raccorder un bâtiment existant.
Le choix de la mise en place d'un assainissement collectif dépend de la commune.
Vous avez la possibilité de consulter en mairie le zonage d'assainissement qui délimite les zones d'assainissement collectif et non collectif.
3- Les missions du service public d’assainissement non collectif (SPANC)
Dans chaque commune ou groupement de communes, il existe un service public d'assainissement.
Un règlement du service public d'assainissement définit les prestations assurées par le service et les obligations de l'exploitant, des usagers et des propriétaires. Il est remis à chaque usager.
Le service assure des missions obligatoires de contrôle et des prestations facultatives d'entretien, de vidange ou de travaux. Il contrôle la conformité des installations et des raccordements. L'usager ne peut pas choisir un autre prestataire pour effectuer les contrôles.
Les missions de contrôle du SPANC consistent à :
- Examiner les projets de conception des installations neuves ou à réhabiliter
- Vérifier l'exécution des travaux
- Contrôler le bon fonctionnement et l 'entretien des installations existantes
La fréquence des visites de contrôle des installations existantes est définie par la commune. Elle est précisée dans le règlement de service et elle ne peut être supérieure à 10 ans.
4- Comment installer un système d’assainissement individuel (autonome)
Les immeubles ou les maisons non raccordés au réseau d'assainissement collectif doivent être branchés sur une installation d'assainissement non collectif.
2 Types d'immeubles sont concernés :
- Immeubles situés en zone d'assainissement non collectif
- Immeubles dispensés de branchement, en zone d'assainissement collectif
Vous pouvez faire vous-même les travaux. Cependant, il est recommandé de se tourner vers une entreprise spécialisée ou vers la commune si elle assure ce service. Elles effectuent l'ensemble des travaux (terrassement, creusage, plomberie, raccordements...).
La commune peut fixer des règles techniques pour l'implantation ou la réhabilitation des installations. Ces règles concernent notamment les études de sols et le choix du type d'installation en fonction de la perméabilité des sols. Les frais supplémentaires sont à la charge du propriétaire.
Avant de commencer les travaux, vous devez présenter votre projet au service public d'assainissement non collectif (SPANC) de votre commune. Il peut vous renseigner sur la marche à suivre et faire des recommandations pour votre projet.
Le SPANC assure les missions suivantes :
- Contrôle de conception de votre future installation en se basant sur l'étude de votre dossier
- Rédige une attestation de conformité à la réglementation que vous joindrez à votre demande de permis de construire
- Contrôle de bonne exécution de l'installation lors d'une visite sur le chantier, avant le remblayage.
Vous pouvez remettre votre terrain en état après le contrôle de bonne exécution du SPANC.
3 Entretien et vidange
Le propriétaire est responsable de l'entretien régulier de son installation. La commune peut créer un service pour assurer cet entretien. Dans ce cas, les propriétaires choisissent de recourir à une entreprise privée ou au service créé par la commune.
La vidange doit être effectuée par une entreprise agréée par le préfet. La périodicité de la vidange de la fosse toutes eaux ou du dispositif à vidanger doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui, en général, ne doit pas dépasser 50 % du volume utile.
Le SPANC vérifie le bon fonctionnement et l'entretien de l'installation au moins tous les 10 ans. La périodicité des contrôles dans votre commune figure dans le règlement du service public d'assainissement.
Les installations non conformes doivent faire l'objet de travaux de mise en conformité dans un délai de 4 ans, en cas de danger sanitaire ou de risque environnemental avéré.
À savoir
En cas de vente, le propriétaire a l'obligation de joindre un rapport de visite du SPANC de moins de 3 ans au dossier de diagnostic technique immobilier. Si l'installation est non conforme, des travaux doivent être réalisés dans l'année suivant la vente.
4 La redevance d’assainissement non collectif
La redevance d'assainissement non collectif correspond à un service rendu à l'usager qui ne paye que ce qui le concerne. La redevance comprend les frais des missions de contrôle du SPANC et les éventuels frais d'entretien de l'installation qui sont tarifés selon la nature de la prestation.
5 Les sanctions en cas de non-respect de vos obligations
Dans le cadre de sa mission de contrôle de l'assainissement, la commune peut vous sanctionner si vous ne respectez pas vos obligations.
La commune peut vous demander de payer une somme au moins équivalente à la redevance d'assainissement. Cette somme peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 400 %.
Vous pouvez être sanctionné, si vous laissez s'écouler ou se répandre, sur la voie publique, des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public. Vous devrez payer une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Si vous ne respectez pas l'obligation de raccorder votre bâtiment au réseau public, la commune peut vous demander de payer une somme au moins équivalente à la redevance d'assainissement. Cette somme peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 400 %.
Vous ne la paierez pas si vous vous raccordez dans un délai de douze mois à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité.
La commune peut, après vous avoir mis en demeure, procéder d'office et à vos frais aux travaux indispensables.
6 Que faire en cas de litige avec le service public d’assainissement
Selon le litige qui vous oppose au service public de l'assainissement de votre commune, vous devrez saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif.
a- Tribunal judiciaire
Le tribunal judiciaire est compétent pour les litiges suivants :
- Facturation
- Recouvrement de la redevance
- Dommages causés à l'occasion de la fourniture du service (vice de conception, l'exécution des travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics)
- Refus d'autorisation de raccordement au réseau public
Dans un premier temps, vous devez adresser une réclamation écrite au service pour rechercher une solution.
Vous pouvez ensuite saisir le médiateur de l'eau pour régler votre litige à l'amiable.
Si la médiation échoue, vous pouvez faire un recours auprès du tribunal.
b- Tribunal administratif
Le tribunal administratif est compétent pour les litiges qui concernent la réglementation ou le contrôle effectué par le service public d'assainissement.
Sources : Service public

Le bornage consiste à fixer définitivement la limite de deux terrains contigus et à marquer cette limite par des repères matériels appelés « bornes ».
Le bornage de terrains n’est pas obligatoire (sauf exceptions). Il est toutefois très fortement recommandé
1- Pourquoi recourir au bornage ?
- Le bornage permet d’éviter tous les conflits de limites propriété, et notamment les empiétements (plantations ou constructions chez le voisin par exemple). - Il ne peut être entrepris que si les fonds concernés constituent des propriétés privées (impossibilité de bornage lorsque le terrain est contigu au domaine public par exemple). - En matière de voirie routière, il s’agira d’une procédure administrative dite d’alignement. - En revanche, les chemins ruraux, relevant du domaine privé, sont susceptibles de bornage.
2- Comment procéder ? a- De manière amiable : Si les deux propriétaires sont d’accord sur la limite séparative de leurs terrains contigus. Cet accord doit faire l’objet d’un procès-verbal de bornage, réalisé par un géomètre expert. La signature de ce document donne valeur contractuelle au bornage, qui se fait à frais communs. Pour rendre le bornage définitif, il est prudent de faire publier le procès-verbal de bornage au fichier immobilier. Ainsi aucune contestation sur les limites du terrain ne sera possible par les propriétaires actuels des terrains concernés mais aussi par les suivants. Le recours à un notaire est nécessaire. b- De manière judiciaire : Si les deux propriétaires n’arrivent pas à se mettre d’accord sur la limite séparative, ou si l’un refuse de procéder à un bornage amiable. La procédure doit être exercée devant le tribunal d’instance du lieu de situation des terrains. Le juge nomme un géomètre-expert qui procède aux opérations de bornage. Le professionnel prépare un projet. Si l’une des parties s’y oppose, le juge tranche.
3- Existe-t-il des situations dans lesquelles le bornage est obligatoire ?
- Par principe, le bornage n’est pas obligatoire, sauf dans deux cas : a- lorsque la demande de bornage est faite par un voisin (article 646 du Code civil) ; b- lorsque le terrain est destinéà la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte (habitation et professionnel) constituant - un lot dans un lotissement soumis à déclaration préalable ou permis d’aménager - un terrain issu d’une division dans une Zone d’Aménagement Concerté.
Source : notaires.fr

Lorsque le vendeur et l'acheteur sont parvenus à un accord sur la vente d'un bien immobilier, ils peuvent signer une promesse de vente avant la signature de l'acte de vente définitif. Ce document n'est pas obligatoire, mais il est recommandé pour exprimer l'accord mutuel du vendeur et de l'acheteur. Il détermine les conditions précises dans lesquelles la vente du logement s'effectuera
La promesse de vente pour l'achat d'un logement existant peut prendre la forme
- Soit d'une promesse unilatérale de vente,
- Soit d'un compromis de vente (également appelé promesse synallagmatique de vente).
1- Définition d’un compromis de vente
Un compromis de vente peut être signé lorsque le vendeur et l'acheteur sont sûrs de vouloir conclure la vente du logement. Cet acte engage définitivement le vendeur et l'acheteur sauf s'il comporte une clause prévoyant, sous certaines conditions, un désistement de l'une ou des 2 parties.
Le compromis peut être réalisé sous 2 formes :
- Acte sous signature privée réalisé directement par le vendeur et l'acheteur ou avec l'appui d'un agent immobilier par exemple
- Acte authentiqueétabli par un notaire (obligatoire lorsque le vendeur est une personne physique et que la durée de validité du compromis dépasse 18 mois)
2- Définition d’une promesse unilatérale de vente
Une promesse unilatérale peut être signée lorsque l'acheteur n'est pas sûr de vouloir conclure la vente. Cet acte lui laisse la liberté de lever l'option ou non (c'est-à-dire d'acheter ou non le logement). Il réserve ainsi le logement pendant un délai clairement précisé. Le vendeur s'engage à ne pas vendre le logement à un autre acheteur.
La promesse unilatérale de vente peut être réalisée sous 2 formes :
- Acte sous signature privéeréalisé directement par le vendeur et l'acheteur ou avec l'appui d'un agent immobilier par exemple
- Acte authentique établi par un notaire (obligatoire lorsque le vendeur est une personne physique et que la durée de validité de la promesse dépasse 18 mois)
À compter de sa signature, une promesse unilatérale sous signature privée doit être enregistrée dans les 10 jours au service de l'enregistrement du vendeur ou de l'acheteur. Cet enregistrement sert à authentifier la promesse de vente.
Le vendeur et/ou l'acheteur peuvent soit déposer la promesse directement au service de l'enregistrement, soit l'envoyer par courrier simple ou recommandé.
3- Contenu d’une promesse ou compromis
La promesse de vente doit mentionner les coordonnées du vendeur et de l'acheteur.
La promesse de vente doit mentionner les informations suivantes :
- Adresse du bien
- Origine du bien (date du précédent acte de vente, nom du précédent propriétaire, acte notarié...)
- Descriptif détaillé du bien, de ses équipements et de ses annexes
- Existence d'une hypothèque et/ou d'une servitude
- La promesse de vente d'un logement en copropriété doit par ailleurs contenir les informations spécifiques à la copropriété.
La promesse de vente doit mentionner les informations suivantes :
- Montant des honoraires du professionnel chargé de la vente (s'il y a intervention d'un professionnel) et à qui en incombe le paiement
- Prix de vente et modalités de paiement (avec ou sans l'aide d'un prêt immobilier)
- Durée de validité de la promesse de vente et date limite de signature de l'acte de vente définitif
- Informations relatives aux conditions d'exercice du droit de rétractation : le manquement à cette obligation d'information est passible d'une amende d'un montant maximum de 15 000 €
- Date de disponibilité du bien
À savoir
Des clauses suspensives peuvent être inscrites dans la promesse de vente. Ainsi la vente ne pourra se réaliser que sous certaines conditions. Par exemple, il peut s'agir de l'obtention d'un certificat d'urbanisme opérationnel ou d'un permis de construire, de l'obtention d'un prêt immobilier ou encore de travaux à réaliser par le vendeur avant la vente.
La promesse de vente doit être accompagnée du dossier de diagnostic technique (DDT).
4- Notification d’une promesse
La promesse de vente peut être remise en main propre ou envoyée à l'acheteur par lettre recommandée avec avis de réception.
Elle doit être réalisée en 2 exemplaires originaux (1 pour le vendeur, 1 pour l'acheteur), excepté dans le cas où un original unique est conservé par un professionnel (notaire, agent immobilier).
5- Sommes à payer
De nombreux mécanismes d'indemnisation ou de contrainte, plus ou moins différenciés, peuvent être prévus dans une promesse de vente. Par exemple, il peut s'agir de l'astreinte (versement d'une indemnité par jour de retard, notamment dans le cas où le vendeur ne délivre pas le logement à la date prévue), ou du séquestre qui est un acompte sur le prix total.
Certains de ces mécanismes sont couramment utilisés et diffèrent suivant la forme de la promesse de vente.
- Dans un compromis de vente
Des clauses inscrites dans le compromis de vente peuvent prévoir le versement de sommes d'argent dès sa signature ou sous un délai déterminé.
Cependant, avant la fin du délai de rétractation, une demande de versement est autorisée si 2 conditions sont remplies. Le compromis doit être conclu par l'intermédiaire d'un professionnel mandaté pour contribuer à la vente (un notaire ou un agent immobilier par exemple). Aussi, le versement doit être consigné chez un professionnel ayant une garantie financière dédiée au remboursement des fonds déposés (recommandé même en l'absence de demande de versement avant la fin du délai de rétractation).
Sinon, le fait d'exiger, de recevoir un versement ou un engagement de versement avant la fin du délai de rétractation est puni d'une amende de 30 000 €.
À noter
Si l'acheteur exerce son droit de rétractation, le professionnel doit lui restituer les sommes versées sous 21 jours à compter du lendemain de la rétractation.
Le montant demandé à l'acheteur se situe en général entre 5 % et 10 % du prix de vente. Il est recommandé de le consigner chez un professionnel ayant une garantie financière dédiée au remboursement des fonds déposés. Il peut s'agir d'un agent immobilier ou d'un notaire. Sauf pour un versement pendant le délai de rétractation, ce n'est pas une obligation, mais cette consignation offre une meilleure garantie de restitution des fonds si nécessaire. À la signature de l'acte définitif, ce montant sera déduit du prix total de la vente quelle que soit la clause du compromis à l'origine du versement.
- Dans une promesse unilatérale de vente
Des clauses inscrites dans une promesse unilatérale de vente peuvent prévoir le versement de sommes d'argent dès sa signature ou sous un délai déterminé.
Cependant, avant la fin du délai de rétractation, une demande de versement est autorisée si 2 conditions sont remplies. La promesse doit être conclue par l'intermédiaire d'un professionnel mandaté pour contribuer à la vente (un notaire ou un agent immobilier par exemple). Aussi, le versement doit être consigné chez un professionnel ayant une garantie financière dédiée au remboursement des fonds déposés (recommandé même en l'absence de demande de versement avant la fin du délai de rétractation).
Sinon le fait d'exiger, de recevoir un versement ou un engagement de versement avant la fin du délai de rétractation est puni d'une amende de 30 000 €.
À noter
Si l'acheteur exerce son droit de rétractation, le professionnel doit lui restituer les sommes versées sous 21 jours à compter du lendemain de la rétractation.
Le montant demandé à l'acheteur se situe en général entre 5 % et 10 % du prix de vente. Il est recommandé de le consigner chez un professionnel ayant une garantie financière dédiée au remboursement des fonds déposés. Il peut s'agir d'un agent immobilier ou d'un notaire. Sauf pour un versement pendant le délai de rétractation, ce n'est pas une obligation, mais cette consignation offre une meilleure garantie de restitution des fonds si nécessaire. À la signature de l'acte définitif, ce montant sera déduit du prix total de la vente quelle que soit la clause de la promesse à l'origine du versement.
6- Rétractation
Le droit de rétractation permet à l'acheteur de réfléchir et renoncer à la vente en respectant un certain délai après la signature de la promesse.
Le vendeur est quant à lui engagé dès la signature de la promesse de vente. S'il conteste la vente, l'acheteur peut en demander l'exécution forcée devant le tribunal c'est-à-dire qu'il peut obliger le vendeur à lui délivrer le logement.
L'acheteur dispose de 10 jours calendaires : Correspond à la totalité des jours du calendrier de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre, y compris les jours fériés ou chômés pour renoncer à la vente.
Ce délai commence le lendemain de la 1re présentation de la lettre recommandée notifiant la promesse de vente ou de sa remise en main propre.
Si le dernier jour du délai de réflexion est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'au 1erjour ouvrable suivant.
L'acheteur doit notifier sa rétractation au vendeur par lettre recommandée avec avis de réception avant l'expiration du délai de 10 jours calendaires
Sources : Services public.fr

Les annonces immobilières de vente comportent des informations obligatoires, quel que soit le support sur lequel elles sont affichées ou publiées (vitrines de l'agence, journaux, site internet...). Des informations complémentaires sont fournies pour la vente d'un bien en copropriété.
I. Cas général
1. L'annonce immobilière donne les caractéristiques principales du bien vendu :
- Type de bien (appartement, loft, maison...)
- Situation géographique
- Superficie et composition
- État du bien (travaux à prévoir, neuf, rénové...)
La description doit être faite avec précision. Dans le cas contraire, l'annonce peut être qualifiée de trompeuse et induire en erreur les consommateurs. C'est un délit puni de sanctions pénales.
À savoir
Avec l'autorisation du vendeur, une photographie accompagne le plus souvent les annonces. Il est recommandé de recueillir l'accord écrit de l'architecte ayant conçu le bâtiment et de faire paraître son nom au bas de la photographie.
2. L'annonce indique les éléments suivants sur le prix de vente :
- Prix de vente
- Montant des honorairestoutes taxes comprises (TTC) exprimé en pourcentage
- Répartition du paiement des honoraires entre l'acquéreur et le vendeur
Si les honoraires sont payés par l'acheteur, le prix de vente est exprimé honoraires inclus et exclus (avec et sans les honoraires). Lorsque les honoraires sont proportionnels, ils varient selon les tranches de prix de vente du bien. L'annonce doit préciser si ces tranches sont cumulatives.
Si les honoraires sont à la charge du vendeur, seul le prix de vente hors honoraires doit être mentionné.
Le barème de prix affiché par le professionnel mentionne les tarifs maximums de ses prestations toutes taxes comprises (TTC). Le consommateur qui le souhaite peut ainsi négocier à la baisse le prix des prestations du professionnel titulaire de la carte professionnelle.
L'annonce précise également le classement énergétique du bien déterminé par le diagnostic de performance énergétique (DPE). Il permet d'estimer la consommation énergétique du logement et son taux d'émission de gaz à effet de serre. Cette obligation concerne tous les bâtiments clos et couverts dotés d'une installation de chauffage ou d'eau chaude. Elle ne concerne pas les bâtiments à construire si l'annonce est faite avant la fin des travaux.
3. L'annonce donne également des renseignements sur l'agence immobilière :
- Numéro SIREN (Système d'identification du répertoire des entreprises)
- Mention RCS (Registre du commerce et des sociétés) de l'agent immobilier
II. Vente d’un bien en copropriété
L'annonce doit être complétée par les éléments suivants :
- Bien vendu soumis au statut de la copropriété
- Nombre de lots de copropriétédans l'immeuble
- Montant moyen annuel des charges payées par le vendeur
- Procédure en cours en raison des difficultés rencontrées par la copropriété (mesures préventives, plan de sauvegarde, ...)
III. Annonces soumis au droit commun
L'agent immobilier diffuse des informations sous la forme d'annonces pour un bien à vendre ou à louer. Il est à ce titre soumis aux dispositions de droit commun, notamment pour ce qui concerne les pratiques commerciales trompeuses (art. L 121-1 du Code de la consommation). Peut notamment relever d'une telle qualification :
- Le fait de proposer à la vente un bien déjà vendu ou loué ;
- La diffusion d'annonces sans détenir préalablement un mandat à cet effet ;
- La présentation de biens comme étant exclusifs alors qu'ils font l'objet d'un mandat simple ;
- L’existence d'une différence entre le prix de vente indiqué sur le mandat et celui indiqué sur l'annonce ;
- Une erreur sur la surface indiquée sur l’annonce.
La même réglementation s'applique aux annonces diffusées par l'agent immobilier sur internet.
Par ailleurs, les publicités relatives à des opérations de vente ou de location diffusées par des mandataires indépendants (négociateurs immobiliers non-salariés) doivent impérativement comporter une mention informant les consommateurs que celles-ci exercent sous le statut d’agent commercial.
Cette obligation d’information est également étendue à tout document d’une transaction immobilière (mandats, etc.). Le non-respect de ces règles est passible de sanctions pénales.
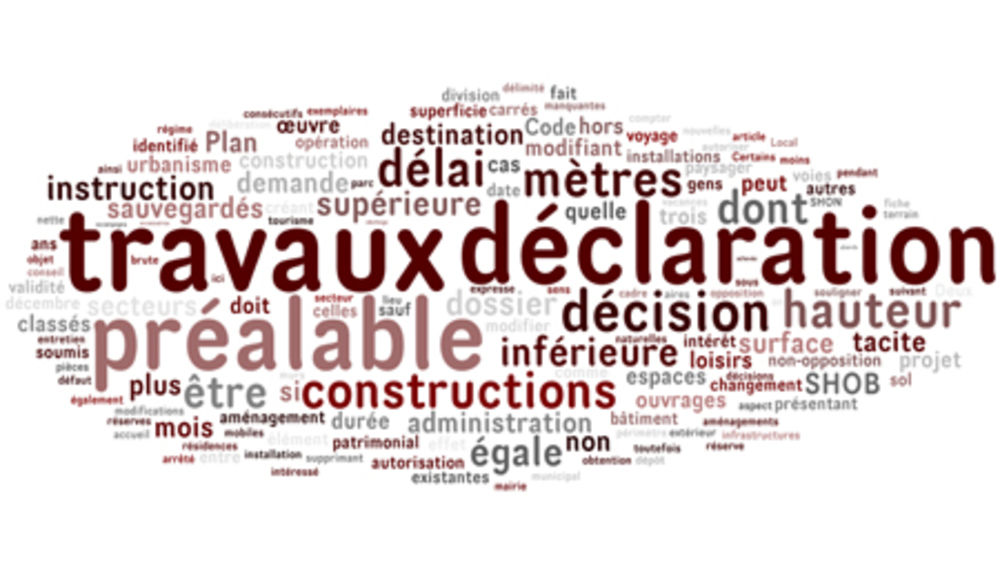
Une déclaration préalable de travaux (DP) est exigée pour des travaux qui ne sont pas soumis à un permis de construire. La DP peut être obligatoire pour l'agrandissement d'un bâtiment existant, pour des travaux modifiant son aspect extérieur ou pour changer sa destination (une grange devenant un hôtel par exemple). Elle est également nécessaire pour certaines constructions nouvelles. La DP permet à la mairie de vérifier que vous respectez les règles d'urbanisme en vigueur.
1- AGRANDISSEMENT : Surélévation, véranda, pièce supplémentaire…
L'agrandissement d'un bâtiment existant est vertical ou horizontal. Cela peut être une surélévation ou la création d'une véranda, par exemple.
Vous pouvez créer jusqu'à 40 m² d'extension avec une déclaration préalable de travaux.
Si l'agrandissement est compris entre 20 m² et 40 m² et qu'il porte la surface totale à plus de 150 m² de surface de plancher : Unité de calcul des surfaces des constructions servant à la délivrance des autorisations d'urbanisme, il faut demander un permis de construire et recourir à un architecte.
Votre projet doit respecter les règles du PLU: PLU : plan local d'urbanisme, même s'il n'est pas soumis à déclaration préalable. Avant de commencer vos travaux, vous devez consulter en mairie le PLU ou le document d'urbanisme en tenant lieu .
Aux abords des monuments historiques, des sites patrimoniaux remarquables ou d'un site protégé classé ou en instance de classement, une DP est exigée quelle que soit la surface de l'agrandissement.
2- MODIFICATION DE L’ASPECT EXTERIEUR D’UN BATIMENT : Portes, fenêtre, toiture ..
Une déclaration préalable (DP) est exigée par la mairie quand vous modifiez l'aspect extérieur d'un bâtiment notamment pour l'un des travaux suivants :
- Créer une ouverture (porte, fenêtre, velux)
- Changer une porte, une fenêtre ou un velux par un autre modèle
- Changer des volets (matériau, forme ou couleur)
- Changer la toiture
À savoir
Si les modifications de façade ou de structures porteuses s'accompagnent d'un changement de destination ( Il existe 5 types de destinations : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d'intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Il y a changement de destination lorsque l'on passe d'une catégorie à une autre.) de votre construction, vous devez déposer un permis de construire.
3- TRANSFORMATION D’UN GARAGE EN PIECE D’HABITATION
Vous devez déposer une déclaration préalable de travaux (DP) si vous transformez un garage de plus de 5 m² de surface close et couverte en une pièce de vie.
La modification de l'aspect extérieur comme la pose d'une fenêtre, par exemple, est également soumise à DP. Vous pouvez déclarer l'ensemble de votre projet avec le même formulaire.
En transformant votre garage, vous supprimez une place de stationnement. Le PLU: PLU : plan local d'urbanisme de votre commune peut comporter des règles concernant la création des aires de stationnement. Dans ce cas, vous devez prévoir d'installer une autre place sur votre terrain. Renseignez-vous auprès du service de l'urbanisme de votre commune.
4- CONSTRUCTION NOUVELLE (Abri jardin, garage ….)
Une nouvelle construction est indépendante du bâtiment d'habitation. Cela peut être un abri de jardin, une pergola, un carport, un garage...
Le projet est soumis à déclaration préalable (DP) quand son emprise au solou sa surface de plancher est supérieure à 5 m² et qu'il répond à un ou plusieurs des critères suivants :
- Emprise au sol inférieure ou égale à 20 m²
- Surface de plancher inférieure ou égale à 20 m²
- Hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 mètres
Votre projet devra respecter les règles du PLU: PLU : plan local d'urbanisme même s'il ne fait pas l'objet d'une autorisation d'urbanisme. Vous devez consulter le PLU ou le document d'urbanisme en tenant lieu, à la mairie.
Aux abords des monuments historiques, des sites patrimoniaux remarquables ou d'un site protégé classé ou en instance de classement, une DP est exigée pour toute construction quelle que soit sa taille.
5- RAVALEMENT DE FACADE
En principe, le ravalement n'est pas soumis à déclaration préalable.
Cependant, vous devez déposer une déclaration préalable si le bâtiment que vous ravalez est situé dans un des secteurs suivants :
- Périmètre d'un site patrimonial remarquable
- Abords des monuments historiques
- Site inscrit
- Site classé ou en instance de classement
- Réserves naturelles
- À l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités
- Immeuble protégé
- Commune ou périmètre de commune où le conseil municipal a décidé de soumettre le ravalement à autorisation d'urbanisme
Avant de commencer vos travaux, renseignez-vous auprès du service de l'urbanisme de votre mairie, pour savoir si vous êtes concerné.
6- PISCINE
- La construction d'une piscine non couverte est soumise à déclaration préalable (DP) quand la superficie de bassin est supérieure à 10 m² et inférieure ou égale à 100 m². Si vous construisez une piscine couverte, la couverture fixe ou mobile doit avoir une hauteur au-dessus du sol inférieur à 1,80 m.
- Une piscine plus petite devra respecter les règles du PLU même si elle n'est pas soumise à DP. Vous devez consulter le PLU: PLU : plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, à la mairie.
Si, pendant plus de 3 mois, vous installez une piscine hors-sol dont la superficie du bassin est supérieure à 10 m², vous devez déposer une déclaration préalable (DP) en mairie.
Si cette piscine est couverte, la hauteur de l'abri doit être inférieure à 1,80 m.
Attention
Si vous habitez dans le périmètre de sites patrimoniaux remarquables aux abords d'un monument historique ou d’un site protégé classé ou en instance de classement, vous devez déposer une DP quelle que soit la superficie du bassin.
7- CLOTURE ET MUR
Une clôture peut être constituée d'une haie végétale, de grillage, de parois ajourées, de tout autre élément permettant de fermer un terrain ou d'une combinaison de plusieurs éléments.
Si la clôture est nécessaire à l'activité agricole ou forestière, elle n'est pas soumise à une déclaration préalable (DP).
Les autres clôtures sont également dispensées de formalité. Cependant, le dépôt d'une DP est obligatoire dans certains secteurs :
- Secteur délimité par le PLU: PLU : plan local d'urbanisme
- Commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les murs à déclaration
- Périmètre d'un site patrimonial remarquable
- Abords des monuments historiques
- Site inscrit, site classé ou en instance de classement
Pour construire un mur, vous devez déposer une déclaration préalable de travaux à la mairie dans les cas suivants :
- Hauteur du mur à construire supérieure à 2 mètres
- Secteur délimité par le PLU: PLU : plan local d'urbanisme
- Périmètre d'un site patrimonial remarquable
- Abords des monuments historiques
- Site inscrit, site classé ou en instance de classement
8- PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SUR LE TOIT
Une déclaration préalable (DP) est exigée par la mairie quand vous installez des panneaux photovoltaïques sur le toit d'un bâtiment quelle que soit la surface de ces panneaux.
À noter
L'installation de panneaux solaires au sol peut nécessiter une autorisation d'urbanisme selon la hauteur de l'installation par rapport au sol et sa puissance crête (c'est-à-dire la puissance maximum délivrée par le panneau).
9- DEPOT DE LA DECLARATION PREALABLE
La déclaration préalable (DP) peut être faite par les personnes suivantes :
- Propriétaire(s) du terrain ou leur mandataire
- Personnes autorisées par le ou les propriétaires à effectuer les travaux
- Co-indivisaire (s) ou leur mandataire
Le dossier de DP comprend le formulaire complété par des pièces à joindre en fonction de la nature de votre projet. Un plan de situation du terrain à l'intérieur de la commune doit être fourni pour tous les projets.
En fonction de la nature de votre projet, des pièces complémentaires peuvent vous être demandées, par exemple :
- Plan de masse si vous créez une construction ou si vous modifiez le volume d'une construction existante
- Plan en coupe du terrain si vous construisez, par exemple, une piscine enterrée qui modifie le profil du terrain
- Plan des façades et des toitures pour la pose d'une fenêtre de toit, ou la création d'une porte, par exemple
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer votre demande par voie dématérialisée selon les modalités définies par la commune compétente pour la recevoir. Votre dossier peut aussi être déposé ou envoyé par courrier RAR: RAR : Recommandé avec avis de réception à la mairie.
La mairie vous délivre un récépissé. Il comporte le numéro d'enregistrement de votre dossier et les informations vous permettant de connaître la date à partir de laquelle les travaux pourront commencer.
Ce récépissé précise que, dans un délai d'1 mois à compter du dépôt du dossier, la mairie peut vous notifier un délai différent pour commencer vos travaux. Elle a également 1 mois pour vous signaler que votre dossier est incomplet.
10- DELAI D’INSTRUCTION
Le délai d'instruction est de 1 mois à partir de la date du dépôt de la déclaration préalable.
Il passe à 2 mois dans un secteur protégé (sites patrimoniaux remarquables, abords des monuments historiques, site classé ou en instance de classement ,réserves naturelles, espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national et cœur des parcs nationaux délimités).
Cependant, dans le mois suivant le dépôt de votre déclaration préalable, l'administration peut, par courrier vous notifier un délai supplémentaire de 1 ou 2 mois.
La mairie peut également vous réclamer des pièces manquantes si votre dossier est incomplet. Vous aurez alors 3 mois pour le compléter. Le délai d'instruction démarrera quand votre dossier sera complet. Si vous ne fournissez pas les pièces manquantes, votre DP sera considérée comme rejetée.
Dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration préalable, un extrait de la DP précisant les caractéristiques essentielles du projet est affiché en mairie. Cet affichage est maintenu pendant toute la durée de l'instruction du dossier
11- DECISION DE L’ADMINISTRATION
Le silence de l'administration vaut décision de non-opposition. L'absence d'opposition à l'issue du délai d'instruction vous permet de réaliser les travaux projetés, tels que mentionnés dans la déclaration.
Sur simple demande de votre part, la mairie doit vous délivrer un certificat de non-opposition. Vous disposez ainsi d'une preuve pour faire valoir vos droits (obtention d'un prêt, souscription d'assurances).
Si la mairie a des réserves, elle prend un arrêté assorti de prescriptions. Il précise les motivations de la décision et indique les voies et délais de recours. Vous devez alors exécuter les travaux en respectant ces règles imposées.
Cette décision vous est adressée par lettre RAR: RAR : Recommandé avec avis de réception.
Si la mairie refuse votre projet, elle prend un arrêté d'opposition. Il doit être motivé et préciser l'intégralité des motifs justifiant la décision d'opposition, notamment les absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires.
Cet arrêté vous est notifié par lettre RAR: RAR : Recommandé avec avis de réception. Dans les 2 mois qui suivent sa réception, vous pouvez adresser à la mairie un recours gracieux pour lui demander de revoir sa position. Elle a 2 mois pour vous répondre. L'absence de réponse signifie que votre demande est rejetée.
La mairie peut suspendre sa décision pendant 2 ans en prenant une décision de sursis à statuer.
L'arrêté de sursis à statuer doit être motivé. Il indique la durée du sursis et le délai dans lequel vous pourrez confirmer votre demande de travaux. Il vous précise également les voies et les délais de recours contre le sursis à statuer.
À savoir
Le propriétaire d'un terrain auquel a été opposé un sursis à statuer peut mettre en demeure la collectivité (ou le service public qui en a pris l'initiative) d'acheter son terrain
12- Affichage de la déclaration préalable
L'affichage de la déclaration préalable sur le terrain est obligatoire dès la notification de l'arrêté ou, si vous ne l'avez pas reçu, dès que le délai d'instruction de votre dossier est expiré.
L'affichage doit rester en place pendant toute la durée du chantier et être visible de l'extérieur. Les renseignements figurant sur votre panneau d'affichage doivent être lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public.
Vos voisins peuvent faire un recours gracieux auprès du maire, à partir du 1er jour d'affichage sur le terrain et pendant 2 mois. En l'absence d'affichage, ils peuvent contester l'autorisation encore 6 mois à partir de l'achèvement des travaux.
13- Durée de validité
La déclaration préalable de travaux a une durée de validité de 3 ans.
Elle est périmée si vous n'avez pas commencé les travaux dans les 3 ans ou si, passé ce délai, vous les interrompez plus d'1 an.
Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision n'est plus valable si ces opérations n'ont pas eu lieu dans les 3 ans.
Cependant, le délai peut être prolongé 2 fois pour 1 an si les règles d'urbanisme et les servitudes administratives n'ont pas changé.
Vous devez en faire la demande 2 mois au moins avant l'expiration du délai de validité initial de votre DP (ou avant l'expiration de votre 1re demande de prolongation). Cette demande de prolongation doit être adressée sur papier libre, en 2 exemplaires, par lettre RAR ou déposée en mairie. La prolongation est accordée si la mairie ne vous adresse aucune décision dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande en mairie.
Source : Service public

Le vendeur a une obligation générale d’information envers l’acheteur concernant tous les éléments qui pourraient déterminer son consentement. Parmi ces informations, figurent celles relatives à la situation sanitaire et environnementale du bien. C’est la raison d’être des différents diagnostics techniques obligatoires lors d’une vente immobilière. Ces diagnostics visent de nombreux aspects de la situation du bien : la présence d’amiante, de plomb, de termites, la performance énergétique etc. Ces diagnostics sont rassemblés dans un document unique appelé Dossier de diagnostic technique (DDT)
Diagnostics immobiliers : Dossier de diagnostic technique ou DDT - 11 documents
Le dossier de diagnostic technique (DDT), prévu par L’ordonnance du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction, réunit dans un seul document les états ou constats que le vendeur doit obligatoirement présenter en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, et ce quelle que soit sa destination (habitation, bureaux, commerces). Ce dossier doit obligatoirement être annexé par le vendeur à toute promesse de vente et à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente (Code de la construction et de l’habitation, art. L 271-4 à L271-6 et R 271-1 à D271-5). Des sanctions sont prévues en cas d’absence de l‘un des documents. Cette absence doit être constatée au moment de l’acte authentique. Le dossier de diagnostic technique comprend jusqu’à 11 documents énumérés à l’article L271-4 du Code de la construction et de l’habitation. Il ne comprendra pas nécessairement tous les documents. Par exemple, le diagnostic termite ne sera pas requis si l’immeuble n’est pas situé dans une zone infestée par les termites délimitée par arrêté préfectoral. Les frais d‘établissement du diagnostic technique sont normalement à la charge du vendeur car il relève de son obligation d’information. Les parties peuvent cependant prévoir de les imputer à l’acquéreur.
Vous êtes le vendeur : - N'hésitez pas à interroger votre notaire sur vos obligations exactes. La loi en effet vous impose de fournir ces documents sous peine d’être responsable des conséquences de ce défaut d'information. Vous ne pouvez donc en être dispensé.
Vous êtes l'acheteur : - Vous devez vous informer afin de ne pas vous tromper sur les caractéristiques du bien que vous envisagez d'acheter. Ces diagnostics permettent à l'acheteur d'avoir une idée plus précise sur son investissement, ses qualités et ses défauts. - Il n'est pas impossible que dans l'avenir, d'autres contrôles soient ajoutés au dossier, dans le but constant d’une meilleure information et protection du consommateur.
1/ Le diagnostic PLOMB
Ce diagnostic est prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique. - Nature du document : constat de risque d'exposition au plomb (CREP). Il doit être accompagné d'une notice d'information résumant les effets du plomb sur la santé (saturnisme) et les précautions à prendre en présence de revêtements contenant du plomb. - Immeubles concernés : immeubles d'habitation ou partie(s) d'immeuble affectés à l'habitation dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1949. - Durée de validité du document : - diagnostic positif : il doit avoir été établi moins d’un an avant la signature de la promesse de vente (art. D 271-5 CCH). Toutefois, si l’état produit lors de la promesse n’est plus valide au moment de l’acte authentique, il devra être remplacé par un nouveau document (art. L 271-5 al 2 CCH).- Illimitée si le diagnostic est négatif. - Sanctions prévues : en cas d'absence de diagnostic, le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. La clause d’exonération de vices cachés sera donc inefficace quant à la présence de plomb.
2/ Le diagnostic AMIANTE
Ce document est prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la santé publique. - Nature du document : “état” ou “constat” mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante. - Immeubles concernés : tous les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. - Durée de validité du document : si aucune trace d'amiante n'est détectée, la durée de validité est illimitée.
Attention : si le diagnostic a été réalisé avant le 1er avril 2013, il doit être renouvelé en cas de vente du logement, même en l'absence d'amiante. - Sanctions prévues : le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. Toute clause d’exonération de vices cachés sera donc inefficace quant à la présence d’amiante.
3/ Le diagnostic TERMITES
Ce document est prévu à l'article L. 126-24 du Code de la santé publique. - Nature du document : état relatif à la présence de termites. - Immeubles concernés : tous les immeubles bâtis situés dans les zones contaminées, délimitées par arrêtés préfectoraux).
Pour consulter la carte des départements couverts par un arrêté préfectoral délimitant les zones infestées par les termites - Durée de validité du document : 6 mois maximum. A refaire en cas de nouvel arrêté municipal déclarant une zone nouvelle d'infestation (art. D 271-5 CCH). Et si l’état produit lors de la promesse n’est plus valide au moment de l’acte authentique, il devra être remplacé par un nouveau document (art. L 271-5 al 2 CCH). - Sanctions prévues : en l’absence d’annexion d’un état de moins de 6 mois à l’acte authentique, le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. Toute clause d’exonération de vices cachés sera donc inefficace quant à la présence de termites.
4/ L'état de l'installation intérieur de GAZ
Ce diagnostic est prévu à l'article L. 134-9 du Code de la construction et de l’habitation. - Nature du document : état de l'installation intérieure de gaz. Tient lieu d’état le certificat de conformité visé par un organisme agréé établi à l’occasion de travaux de l’installation de l’installation de gaz (art. R 126-41 CCH). - Immeubles concernés : immeuble d'habitation ou partie(s) d'immeuble affectés à l'habitation, dont l'installation de gaz a été réalisée depuis plus de 15 ans. - Durée de validité du document : l’état (ou le certificat de conformité) doit avoir été réalisé moins de 3 ans avant son annexion à la promesse ou de l’acte (art. D 271-5 CCH). Et si l’état produit lors de la promesse n’est plus valide au moment de l’acte authentique, il devra être remplacé par un nouveau document (art. L 271-5 al 2 CCH). - Sanctions prévues : en l’absence d’état de moins de 3 ans annexé à l’acte authentique de vente, le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. Toute clause d’exonération de vices cachés concernant l’installation de gaz sera donc inefficace.
5/ L’état des risques naturels et technologiques (état des risques et pollutions -ERP)
Ce diagnostic est prévu à L. 125-5 du Code de l'environnement. - Nature du document : état risques et pollutions (aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon, et sols pollués). Immeubles concernés : tout type d'immeubles situés dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, dans une zone à potentiel radon ou dans une zone de sismicité définie par décret, - Durée de validité du document : un état de moins de 6 mois doit être annexé à la promesse de vente et à défaut d’avant-contrat à l’acte authentique. Et si l’état produit lors de la promesse n’est plus valide au moment de l’acte authentique, il devra être remplacé par un nouveau document (L 271-5 al 2 CCH). - Sanctions prévues : à défaut d’état en cours de validité annexé à l’acte authentique de vente, l’acquéreur peut poursuivre la résolution de la vente ou demander au juge du tribunal judiciaire une diminution du prix.
6/ Le diagnostic de performance énergétique (DPE) et audit énergétique
Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l'audit énergétique sont prévus aux articles L126-26 à L126-33-1 et R126-15 à R126-20 du Code de la construction et de l’habitation. Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un document qui sert principalement à estimer la consommation d'énergie et les taux d'émission de gaz à effet de serre du logement (art. L 126-28 Code de la construction et de l’habitation). Le DPE a fait l’objet d’une réforme importante issue de la loi « Climat et Résilience » publiée le 24 août 2021. Le texte rend notamment obligatoire, au 1er janvier 2022, la réalisation d’un audit énergétique lors de la vente d’une maison ou d’un immeuble en monopropriété considéré comme une passoire énergétique, c’est-à-dire dont le diagnostic de performance énergétique (DPE) est de classe F ou G. L’audit sera obligatoire au 1er janvier 2025 pour les logements de classe E et au 1er janvier 2034 pour les logements de classe D (article L 126-28-1 du CCH).
Le DPE doit être annexé à la promesse de vente ou à défaut à l’acte authentique de vente. - Nature du document : le DPE est un document qui comporte la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée, et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance et du montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic. - Immeubles concernés (art. R 126-15 CCH) : les immeubles concernés par le DPE sont les bâtiments clos et couverts situés en France métropolitaine et dotés d'une installation de chauffage ou d'eau chaude. Par exception, les immeubles listés à l’article R R126-15 du CCH ne donnent pas lieu à diagnostic (par exemple un bâtiment destiné à être habité moins de 4 mois par an). - Durée de validité du document : la durée de validité du diagnostic de performance énergétique est fixée à dix ans.
Attention : lorsque les diagnostics de performance énergétique ont été réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 1er juillet 2021, leur durée de validité est fixée dans les limites suivantes :
a) Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valides jusqu'au 31 décembre 2022 ;
b) Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu'au 31 décembre 2024. - Sanctions : les informations relatives à la performance énergétique (exemple : classement E) sont opposables au vendeur depuis le 1er juillet 2021. Le DPE a donc désormais une valeur contractuelle : en cas d’erreur, l'acquéreur peut saisir le tribunal pour demander des dommages-intérêts. Seules les recommandations (exemple : isolation des combles) conservent une valeur purement informative ; Pour plus d’information, voir notre article sur le diagnostic de performance énergétique.
7/ Le diagnostic ELECTRICITE
Ce diagnostic est prévu à l’article L. 134-7 et R 126-35 et R 126-36 du Code de la construction et de l’habitation. - Nature du document : état de l'installation intérieure électrique. - Immeubles concernés : immeubles d'habitation ou partie(s) d'immeuble affectés à l'habitation dont l'installation a été réalisée depuis plus de 15 ans. - Durée de validité du document : l’état doit avoir été établi moins de 3 ans avant la date de la promesse (art. D 271-5 CCH) aussi bien en ce qui concerne l'état de l'installation intérieure et que l'attestation de conformité en cas de travaux de rénovation. - Sanctions prévues : en l’absence d’état de moins de 3 ans annexé à l’acte authentique, le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
8/ Le diagnostic ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Ce document est prévu à l’article à l'article L. 1331-11-1 du Code de la santé publique. - Nature du document : document issu du contrôle de l'installation individuelle d'assainissement. - Immeubles concernés : tous les immeubles bâtis non raccordés au réseau public. - Durée de validité du document : 3 ans. - Sanctions prévues (art. L 271-4 CCH) : en l’absence de document datant de moins de 3 ans annexé à l’acte authentique de vente, le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. En cas de non-conformité de l’installation lors de la signature de l’acte authentique, l'acquéreur a pour obligation de mettre en conformité dans un délai d’un an après la signature.
9/ Le diagnostic MERULE - Nature du document : information sur la présence d'un risque de mérule. - Immeubles concernés : tous les immeubles bâtis situés dans les zones contaminées et délimitées par arrêté préfectoral (article L 131-3 du CCH). - Durée de validité du document : pas de durée fixée. - Sanctions prévues : aucune sanction n’est prévue par les textes en l’absence d’information.
10/ Le diagnostic BRUIT ou "état des nuisances sonores aériennes"
Le diagnostic Bruit est un document qui permet de faire connaître au futur acquéreur l'existence de nuisances sonores aériennes. Il est prévu à l’article L 112-11 du Code de l’urbanisme. Il est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. - Nature du document : état des nuisances sonores aériennes. - Zones concernées : ce diagnostic doit être établi lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu à l'article L. 112-6 du Code de l'urbanisme. - Immeubles concernés : Les immeubles ou parties d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou les immeubles non bâtis constructibles qui font l’objet d’une vente. Lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit d, un document comportant l'indication claire et précise de cette zone, l'adresse du service d'information en ligne permettant de consulter le plan d'exposition au bruit ainsi que la mention de la possibilité de consulter le plan d'exposition au bruit à la mairie de la commune où est sis l’immeuble doit être intégré au dossier de diagnostic technique. - Sanctions prévues : si l’état des nuisances n’a qu’une valeur indicative, son absence permet à l’acquéreur de poursuivre la résolution du contrat ou de demander au juge une diminution du prix.
11/ Les appareils de CHAUFFAGE à BOIS
Nouveauté : partant du constat que les cheminées à foyer ouvert sont à l'origine d'importantes émissions de dioxyde de carbone non compensées par la plantation de nouvelles forêts et d'une pollution aux particules fines, la loi Climat et résilience du 22 août 2021 (art. 158) a créé un onzième diagnostic à inclure au DDT (art. L271-4, I, 11° du CCH). Lorsque le bien est situé dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du Code de l'environnement, le vendeur doit joindre au dossier de diagnostic technique (DDT) un certificat attestant la conformité de l'appareil de chauffage au bois aux règles d'installation et d'émission fixées par le préfet du département.
DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES
a- Le certificat de mesurage LOI CARREZ
La loi n°96-1107 du 18 décembre 1996, dite loi Carrez, visait à protéger les acquéreurs de lots de copropriété, en encadrant le calcul des surfaces des parties privatives dévolues à l’acquéreur lors de l’achat d’un lot de copropriété. L’article L271-4 du CCH ne le mentionne pas parmi les 11 documents à joindre au DDT mais en pratique le métrage carrez est joint au dossier de diagnostic technique. - Nature du document : certificat attestant de la surface du lot de copropriété vendu. - Immeubles concernés : tous les lots de copropriété à usage d'habitation, professionnel ou commercial (exceptés les caves, garages, emplacement de stationnement et d'une manière générale, les lots ou fraction de lots inférieurs à 8 m2). - Durée de validité du document : permanente - Sanctions prévues : action en nullité de la vente en l'absence de mention. Si la superficie réelle est inférieure de plus de 5 % à celle exprimée dans l'acte de vente, l'acquéreur peut, dans un délai d'un an à compter de la date de l'acte authentique, demander au juge une diminution de prix au prorata du nombre de mètres carrés manquants.
b- Le diagnostic technique de l'immeuble en copropriété
c- L'étude géotechnique
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles consécutif à des épisodes de sécheresse suivis de périodes de pluie provoque de nombreux dégâts matériels, particulièrement sur les maisons individuelles. Mise en place par la loi ELAN du 23 novembre 2018, l'étude géotechnique des sols ne fait pas partie de la liste des documents figurant dans le dossier de diagnostic technique puisque ce dernier concerne la vente d'un immeuble bâti. Toutefois, cette étude géotechnique doit rester annexée au titre de propriété du terrain et suivre les mutations successives de celui-ci, notamment en cas de vente du terrain après construction. Elle est prévue par les articles L. 132-5 et L. 132-8 du CCH et R 132-3 du CCH. - Nature du document : étude géotechnique préalable. Elle doit permettre à l'acquéreur de connaître la véritable qualité du terrain destiné à la construction et, aux professionnels, compte tenu de la nature du sol, de proposer soit des fondations adaptées et non surdimensionnées, soit de demander une étude du sol plus approfondie. - Immeuble concerné : en cas de vente d’un terrain non bâti constructible situé : - Dans une zone permettant la réalisation de maisons individuelles, - Et dans une zone de sols argileux (zone où l’exposition au risque de mouvement de terrain est qualifiée de moyenne ou forte, (voir la carte des zones : www.georisques.gouv.fr ; rubriques « Retrait/gonflement des argiles »), - Cette étude de sol "préalable" doit être fournie par le vendeur et annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. L’obligation est effective depuis le 1er octobre 2020.
A noter : une autre étude géotechnique, dite « de conception », prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment peut être requise dans le cadre de la réalisation de travaux de construction - Durée de validité du document : 30 ans si aucun remaniement du sol n'a été effectué. - Sanctions prévues : la loi n’a pas prévu de sanction spécifique en cas d’absence d’étude géotechnique. Ainsi, c’est le droit commun qui s’applique et la responsabilité du vendeur pourrait être engagée.
Source : Notaires.fr

Le vendeur a une obligation générale d’information envers l’acheteur concernant tous les éléments qui pourraient déterminer son consentement. Parmi ces informations, figurent celles relatives à la situation sanitaire et environnementale du bien. C’est la raison d’être des différents diagnostics techniques obligatoires lors d’une vente immobilière. Ces diagnostics visent de nombreux aspects de la situation du bien : la présence d’amiante, de plomb, de termites, la performance énergétique etc. Ces diagnostics sont rassemblés dans un document unique appelé Dossier de diagnostic technique (DDT)
Diagnostics immobiliers : Dossier de diagnostic technique ou DDT - 11 documents
Le dossier de diagnostic technique (DDT), prévu par L’ordonnance du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction, réunit dans un seul document les états ou constats que le vendeur doit obligatoirement présenter en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, et ce quelle que soit sa destination (habitation, bureaux, commerces). Ce dossier doit obligatoirement être annexé par le vendeur à toute promesse de vente et à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente (Code de la construction et de l’habitation, art. L 271-4 à L271-6 et R 271-1 à D271-5). Des sanctions sont prévues en cas d’absence de l‘un des documents. Cette absence doit être constatée au moment de l’acte authentique. Le dossier de diagnostic technique comprend jusqu’à 11 documents énumérés à l’article L271-4 du Code de la construction et de l’habitation. Il ne comprendra pas nécessairement tous les documents. Par exemple, le diagnostic termite ne sera pas requis si l’immeuble n’est pas situé dans une zone infestée par les termites délimitée par arrêté préfectoral. Les frais d‘établissement du diagnostic technique sont normalement à la charge du vendeur car il relève de son obligation d’information. Les parties peuvent cependant prévoir de les imputer à l’acquéreur.
Vous êtes le vendeur :
- N'hésitez pas à interroger votre notaire sur vos obligations exactes. La loi en effet vous impose de fournir ces documents sous peine d’être responsable des conséquences de ce défaut d'information. Vous ne pouvez donc en être dispensé.
Vous êtes l'acheteur :
- Vous devez vous informer afin de ne pas vous tromper sur les caractéristiques du bien que vous envisagez d'acheter. Ces diagnostics permettent à l'acheteur d'avoir une idée plus précise sur son investissement, ses qualités et ses défauts.
- Il n'est pas impossible que dans l'avenir, d'autres contrôles soient ajoutés au dossier, dans le but constant d’une meilleure information et protection du consommateur.
1/ Le diagnostic PLOMB
Ce diagnostic est prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique.
- Nature du document : constat de risque d'exposition au plomb (CREP). Il doit être accompagné d'une notice d'information résumant les effets du plomb sur la santé (saturnisme) et les précautions à prendre en présence de revêtements contenant du plomb.
- Immeubles concernés : immeubles d'habitation ou partie(s) d'immeuble affectés à l'habitation dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1949.
- Durée de validité du document :
- diagnostic positif : il doit avoir été établi moins d’un an avant la signature de la promesse de vente (art. D 271-5 CCH). Toutefois, si l’état produit lors de la promesse n’est plus valide au moment de l’acte authentique, il devra être remplacé par un nouveau document (art. L 271-5 al 2 CCH).
- Illimitée si le diagnostic est négatif.
- Sanctions prévues : en cas d'absence de diagnostic, le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. La clause d’exonération de vices cachés sera donc inefficace quant à la présence de plomb.
2/ Le diagnostic AMIANTE
Ce document est prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la santé publique.
- Nature du document : “état” ou “constat” mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante.
- Immeubles concernés : tous les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
- Durée de validité du document : si aucune trace d'amiante n'est détectée, la durée de validité est illimitée.
Attention : si le diagnostic a été réalisé avant le 1er avril 2013, il doit être renouvelé en cas de vente du logement, même en l'absence d'amiante.
- Sanctions prévues : le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. Toute clause d’exonération de vices cachés sera donc inefficace quant à la présence d’amiante.
3/ Le diagnostic TERMITES
Ce document est prévu à l'article L. 126-24 du Code de la santé publique.
- Nature du document : état relatif à la présence de termites.
- Immeubles concernés : tous les immeubles bâtis situés dans les zones contaminées, délimitées par arrêtés préfectoraux).
Pour consulter la carte des départements couverts par un arrêté préfectoral délimitant les zones infestées par les termites
- Durée de validité du document : 6 mois maximum. A refaire en cas de nouvel arrêté municipal déclarant une zone nouvelle d'infestation (art. D 271-5 CCH). Et si l’état produit lors de la promesse n’est plus valide au moment de l’acte authentique, il devra être remplacé par un nouveau document (art. L 271-5 al 2 CCH).
- Sanctions prévues : en l’absence d’annexion d’un état de moins de 6 mois à l’acte authentique, le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. Toute clause d’exonération de vices cachés sera donc inefficace quant à la présence de termites.
4/ L'état de l'installation intérieur de GAZ
Ce diagnostic est prévu à l'article L. 134-9 du Code de la construction et de l’habitation.
- Nature du document : état de l'installation intérieure de gaz. Tient lieu d’état le certificat de conformité visé par un organisme agréé établi à l’occasion de travaux de l’installation de l’installation de gaz (art. R 126-41 CCH).
- Immeubles concernés : immeuble d'habitation ou partie(s) d'immeuble affectés à l'habitation, dont l'installation de gaz a été réalisée depuis plus de 15 ans.
- Durée de validité du document : l’état ( ou le certificat de conformité) doit avoir été réalisé moins de 3 ans avant son annexion à la promesse ou de l’acte (art. D 271-5 CCH). Et si l’état produit lors de la promesse n’est plus valide au moment de l’acte authentique, il devra être remplacé par un nouveau document (art. L 271-5 al 2 CCH).
- Sanctions prévues : en l’absence d’état de moins de 3 ans annexé à l’acte authentique de vente, le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. Toute clause d’exonération de vices cachés concernant l’installation de gaz sera donc inefficace.
5/ L’état des risques naturels et technologiques (état des risques et pollutions -ERP)
Ce diagnostic est prévu à L. 125-5 du Code de l'environnement.
- Nature du document : état risques et pollutions (aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon, et sols pollués). Immeubles concernés : tout type d'immeubles situés dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, dans une zone à potentiel radon ou dans une zone de sismicité définie par décret,
- Durée de validité du document : un état de moins de 6 mois doit être annexé à la promesse de vente et à défaut d’avant-contrat à l’acte authentique. Et si l’état produit lors de la promesse n’est plus valide au moment de l’acte authentique, il devra être remplacé par un nouveau document (L 271-5 al 2 CCH).
- Sanctions prévues : à défaut d’état en cours de validité annexé à l’acte authentique de vente, l’acquéreur peut poursuivre la résolution de la vente ou demander au juge du tribunal judiciaire une diminution du prix.
6/ Le diagnostic de performance énergétique (DPE) et audit énergétique
Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l'audit énergétique sont prévus aux articles L126-26 à L126-33-1 et R126-15 à R126-20 du Code de la construction et de l’habitation. Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un document qui sert principalement à estimer la consommation d'énergie et les taux d'émission de gaz à effet de serre du logement (art. L 126-28 Code de la construction et de l’habitation). Le DPE a fait l’objet d’une réforme importante issue de la loi « Climat et Résilience » publiée le 24 août 2021. Le texte rend notamment obligatoire, au 1er janvier 2022, la réalisation d’un audit énergétique lors de la vente d’une maison ou d’un immeuble en monopropriété considéré comme une passoire énergétique, c’est-à-dire dont le diagnostic de performance énergétique (DPE) est de classe F ou G. L’audit sera obligatoire au 1er janvier 2025 pour les logements de classe E et au 1er janvier 2034 pour les logements de classe D (article L 126-28-1 du CCH).
Le DPE doit être annexé à la promesse de vente ou à défaut à l’acte authentique de vente.
- Nature du document : le DPE est un document qui comporte la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée, et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance et du montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic.
- Immeubles concernés (art. R 126-15 CCH) : les immeubles concernés par le DPE sont les bâtiments clos et couverts situés en France métropolitaine et dotés d'une installation de chauffage ou d'eau chaude. Par exception, les immeubles listés à l’article R R126-15 du CCH ne donnent pas lieu à diagnostic (par exemple un bâtiment destiné à être habité moins de 4 mois par an).
- Durée de validité du document : la durée de validité du diagnostic de performance énergétique est fixée à dix ans.
Attention : lorsque les diagnostics de performance énergétique ont été réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 1er juillet 2021, leur durée de validité est fixée dans les limites suivantes :
a) Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valides jusqu'au 31 décembre 2022 ;
b) Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu'au 31 décembre 2024.
- Sanctions : les informations relatives à la performance énergétique (exemple : classement E) sont opposables au vendeur depuis le 1er juillet 2021. Le DPE a donc désormais une valeur contractuelle : en cas d’erreur, l'acquéreur peut saisir le tribunal pour demander des dommages-intérêts. Seules les recommandations (exemple : isolation des combles) conservent une valeur purement informative ; Pour plus d’information, voir notre article sur le diagnostic de performance énergétique.
7/ Le diagnostic ELECTRICITE
Ce diagnostic est prévu à l’article L. 134-7 et R 126-35 et R 126-36 du Code de la construction et de l’habitation.
- Nature du document : état de l'installation intérieure électrique.
- Immeubles concernés : immeubles d'habitation ou partie(s) d'immeuble affectés à l'habitation dont l'installation a été réalisée depuis plus de 15 ans.
- Durée de validité du document : l’état doit avoir été établi moins de 3 ans avant la date de la promesse (art. D 271-5 CCH) aussi bien en ce qui concerne l'état de l'installation intérieure et que l'attestation de conformité en cas de travaux de rénovation.
- Sanctions prévues : en l’absence d’état de moins de 3 ans annexé à l’acte authentique, le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
8/ Le diagnostic ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Ce document est prévu à l’article à l'article L. 1331-11-1 du Code de la santé publique.
- Nature du document : document issu du contrôle de l'installation individuelle d'assainissement.
- Immeubles concernés : tous les immeubles bâtis non raccordés au réseau public.
- Durée de validité du document : 3 ans.
- Sanctions prévues (art. L 271-4 CCH) : en l’absence de document datant de moins de 3 ans annexé à l’acte authentique de vente, le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. En cas de non-conformité de l’installation lors de la signature de l’acte authentique, l'acquéreur a pour obligation de mettre en conformité dans un délai d’un an après la signature.
9/ Le diagnostic MERULE
- Nature du document : information sur la présence d'un risque de mérule.
- Immeubles concernés : tous les immeubles bâtis situés dans les zones contaminées et délimitées par arrêté préfectoral (article L 131-3 du CCH).
- Durée de validité du document : pas de durée fixée.
- Sanctions prévues : aucune sanction n’est prévue par les textes en l’absence d’information.
10/ Le diagnostic BRUIT ou "état des nuisances sonores aériennes"
Le diagnostic Bruit est un document qui permet de faire connaître au futur acquéreur l'existence de nuisances sonores aériennes. Il est prévu à l’article L 112-11 du Code de l’urbanisme. Il est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.
- Nature du document : état des nuisances sonores aériennes.
- Zones concernées : ce diagnostic doit être établi lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu à l'article L. 112-6 du Code de l'urbanisme.
- Immeubles concernés : Les immeubles ou parties d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou les immeubles non bâtis constructibles qui font l’objet d’une vente. Lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit d, un document comportant l'indication claire et précise de cette zone, l'adresse du service d'information en ligne permettant de consulter le plan d'exposition au bruit ainsi que la mention de la possibilité de consulter le plan d'exposition au bruit à la mairie de la commune où est sis l’immeuble doit être intégré au dossier de diagnostic technique.
- Sanctions prévues : si l’état des nuisances n’a qu’une valeur indicative, son absence permet à l’acquéreur de poursuivre la résolution du contrat ou de demander au juge une diminution du prix.
11/ Les appareils de CHAUFFAGE à BOIS
Nouveauté : partant du constat que les cheminées à foyer ouvert sont à l'origine d'importantes émissions de dioxyde de carbone non compensées par la plantation de nouvelles forêts et d'une pollution aux particules fines, la loi Climat et résilience du 22 août 2021 (art. 158) a créé un onzième diagnostic à inclure au DDT (art. L271-4, I, 11° du CCH). Lorsque le bien est situé dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du Code de l'environnement, le vendeur doit joindre au dossier de diagnostic technique (DDT) un certificat attestant la conformité de l'appareil de chauffage au bois aux règles d'installation et d'émission fixées par le préfet du département.
DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES
a- Le certificat de mesurage LOI CARREZ
La loi n°96-1107 du 18 décembre 1996, dite loi Carrez, visait à protéger les acquéreurs de lots de copropriété, en encadrant le calcul des surfaces des parties privatives dévolues à l’acquéreur lors de l’achat d’un lot de copropriété. L’article L271-4 du CCH ne le mentionne pas parmi les 11 documents à joindre au DDT mais en pratique le métrage carrez est joint au dossier de diagnostic technique.
- Nature du document : certificat attestant de la surface du lot de copropriété vendu.
- Immeubles concernés : tous les lots de copropriété à usage d'habitation, professionnel ou commercial (exceptés les caves, garages, emplacement de stationnement et d'une manière générale, les lots ou fraction de lots inférieurs à 8 m2).
- Durée de validité du document : permanente
- Sanctions prévues : action en nullité de la vente en l'absence de mention. Si la superficie réelle est inférieure de plus de 5 % à celle exprimée dans l'acte de vente, l'acquéreur peut, dans un délai d'un an à compter de la date de l'acte authentique, demander au juge une diminution de prix au prorata du nombre de mètres carrés manquants.
b- Le diagnostic technique de l'immeuble en copropriété
c- L'étude géotechnique
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles consécutif à des épisodes de sécheresse suivis de périodes de pluie provoque de nombreux dégâts matériels, particulièrement sur les maisons individuelles. Mise en place par la loi ELAN du 23 novembre 2018, l'étude géotechnique des sols ne fait pas partie de la liste des documents figurant dans le dossier de diagnostic technique puisque ce dernier concerne la vente d'un immeuble bâti. Toutefois, cette étude géotechnique doit rester annexée au titre de propriété du terrain et suivre les mutations successives de celui-ci, notamment en cas de vente du terrain après construction. Elle est prévue par les articles L. 132-5 et L. 132-8 du CCH et R 132-3 du CCH.
- Nature du document : étude géotechnique préalable. Elle doit permettre à l'acquéreur de connaître la véritable qualité du terrain destiné à la construction et, aux professionnels, compte tenu de la nature du sol, de proposer soit des fondations adaptées et non surdimensionnées, soit de demander une étude du sol plus approfondie.
- Immeuble concerné : en cas de vente d’un terrain non bâti constructible situé :
- Dans une zone permettant la réalisation de maisons individuelles,
- Et dans une zone de sols argileux (zone où l’exposition au risque de mouvement de terrain est qualifiée de moyenne ou forte, (voir la carte des zones : www.georisques.gouv.fr ; rubriques « Retrait/gonflement des argiles »),
- Cette étude de sol "préalable" doit être fournie par le vendeur et annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. L’obligation est effective depuis le 1er octobre 2020.
A noter : une autre étude géotechnique, dite « de conception », prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment peut être requise dans le cadre de la réalisation de travaux de construction
- Durée de validité du document : 30 ans si aucun remaniement du sol n'a été effectué.
- Sanctions prévues : la loi n’a pas prévu de sanction spécifique en cas d’absence d’étude géotechnique. Ainsi, c’est le droit commun qui s’applique et la responsabilité du vendeur pourrait être engagée.
Source : Notaires.fr

Vous avez envie de vendre votre bien immobilier ?
Pour vous aider, voici les 10 critères qui vont impacter son prix… Prenez des notes !
1- Évaluer l'attractivité de votre adresse
Plusieurs éléments peuvent faire varier le prix de votre bien immobilier, notamment la vie de quartier qui est souvent primordiale pour les acheteurs :
Transports en commun, commerces de proximité, écoles et centres sportifs peuvent être déterminants pour faciliter la vente.
Ces commodités peuvent faire varier de 5 à 15 % le prix d’un bien…Donc, si vous habitez dans un petit bourg charmant mais loin des animations, soyez raisonnable sur le prix !
2- Connaître les projets urbains de votre commune
Les futurs aménagements peuvent justifier une plus-value sur le prix comme la création d’une ligne ferroviaire, métro, bus et tramway. Et il faut prendre aussi en compte les pistes cyclables, les constructions d’espaces verts ou de nouveaux établissements scolaires qui vont automatiquement jouer sur votre estimation. Alors pour connaître tous les projets de votre ville, il suffit de lire le Plan Local d’Urbanisme qui recense tous les projets.
Renseignez-vous auprès de votre mairie.
3- Évaluer le potentiel économique de votre ville
Plus une ville va favoriser l’implantation d’entreprises, plus la demande immobilière va être à la hausse et par conséquent les prix des biens aussi !
En revanche si la commune a un taux de chômage élevé, veillez à ne pas être trop gourmand…
4- S’informer de l’état de votre immeuble ou de votre maison
Si le ravalement date, si les fissures sont apparentes ou une odeur d’humidité est persistante, ce n’est pas une bonne nouvelle !
Car les acheteurs auront tendance à fuir les biens immobiliers pour lesquels d’importants travaux sont à prévoir.
Pour éviter toute surprise, faites faire un devis par un entrepreneur où contacter votre syndic de copropriété pour estimer le coût éventuel des travaux pour les futurs acquéreurs.
Et revoyez le prix de votre bien en conséquence.
5- Lister les caractéristiques de votre bien
Il est important de préciser tous les atouts et les défauts de votre bien immobilier : sa situation (étage, rez-de-chaussée, côté rue), sa superficie, son agencement, ses espaces attenants (parking, cave, véranda, jardin, terrasse, balcon, local poussette), les espaces partagés (cour, jardin) et son orientation
(Ensoleillement, vis-à-vis, vue).
Et évidemment les travaux à prévoir.
N’oubliez pas que chaque détail est important. Il doit être pris en compte dans l’estimation.
6- Prendre en compte les charges et les frais annexes
Les prix des charges peuvent varier du simple au triple même si les biens immobiliers ont la même superficie et qu’ils se situent dans la même rue !
En ville, avoir un gardien d’immeuble, une piscine privée, des espaces verts ou encore des parkings souterrains, peuvent augmenter le budget quotidien pour le futur acheteur.
Des charges ou frais élevés viendront donc malheureusement impacter le prix de vente à la baisse
7- Tenir compte des performances énergétiques
Depuis son arrivée en 2011, le diagnostic de Performance Energétique (DPE) a démontré qu’un bon classement énergétique valorise un logement. Dans certains secteurs, si votre bien immobilier possède la note “A”, les variations du prix du mètre carré peuvent aller jusqu’à 27% de plus sur le prix estimé.
A contrario, un logement mal classé (à partir de E) se vendra beaucoup moins cher qu’un logement similaire bien classé.
8- Ne pas se focaliser sur le prix d’achat de votre bien immobilier
Vous avez mis un certain prix quand vous avez acheté mais ce prix n’est pas forcément une référence.
En effet, si vous avez effectué des travaux de rénovation ou si vous avez subi des dégradations, le prix du mètre carré peut changer du tout au tout.(à la hausse ou à l baisse)
De même, qu’en fonction des fluctuations du marché, le coût de l’immobilier peut aussi varier.
Alors prenez tous ces éléments en compte.
9- Oublier le côté affectif dans le prix de vente
Vous avez vécu une partie de votre vie dans votre maison et le « coté affectif » pourrait vous influencer lorsque vous allez fixer votre prix.
En effet, pour c’est sans aucun doute « la plus belle ».
Mais vos futurs acquéreurs achètent un bien immobilier et pas vos souvenirs ! Les acheteurs verront uniquement le prix élevé et non vos enfants qui y ont grandi. Donc soyez objectif !
10- Ne pas surestimer votre prix
Et oui, il ne faut pas être gourmand car les futurs acheteurs s’informent des prix du marché immobilier.
Un prix trop élevé n’attire pas les acquéreurs et vous prenez le risque que votre bien immobilier reste longtemps en vente…Alors, fixer le bon prix permet de vendre son bien en temps et en heure pour vos futurs projets.
Ne surestimer pas votre bien ! veillez à une estimation juste.
Vous pouvez commencer l’aventure de la vente de votre bien faisant votre estimation en ligne, c’est 100% gratuit !
Mais les moyennes ou les fourchettes de prix en vigueur sont à prendre avec retenue car un site ne peut pas pendre en compte tous les critères cités (ci-dessus) qui pourraient impacter le prix de votre bien.
Seul un professionnel est en mesure d’avoir un œil objectif tenant compte de tous ces critères
Voir nos autres articles sur le sujet :
Estimation : Pourquoi ne pas surévaluer le prix de votre bien ?
Vous avez pris la décision de vendre votre bien immobilier et vous souhaitez que la transaction se fasse avec le plus offrant et dans les meilleures conditions possibles.
Pour mettre toutes les chances de votre côté, il sera donc indispensable de mettre votre bien au bon prix de vente.
En effet, en cas de surestimation de votre prix de vente, les acheteurs seront plus frileux et tenteront de négocier le prix à la baisse.
Pour éviter d’être dans cette situation, découvrez 4 raisons pour lesquelles, il est important de mettre en vente au bon prix.
1- Attirer les acheteurs
Mettre en vente au bon prix permet d’attirer beaucoup plus d’acheteurs.
Face au contexte économique et à la perte de pouvoir d’achat, les acheteurs vont être de plus en plus vigilants sur le prix affiché du bien immobilier qu’ils convoitent. Dans ces conditions, ils recherchent d’autant plus la bonne affaire. L’achat d’un logement n’est pas un acte anodin, il engage une ou plusieurs personnes pour de nombreuses années et sur des gros montants. Ainsi, les acheteurs n’hésitent pas à s’informer de l’évolution des prix du marché.
Mais les futurs acquéreurs ne s’arrêtent pas seulement à l’estimation du prix du bien, ils analysent aussi les biens en vente dans votre quartier.
Comment s’y prennent-ils ?
Ils regardent tout simplement les annonces des agences et comparent le prix de votre bien avec d’autres similaires. Il est fort probable que vous ne soyez pas seul à vendre dans le quartier ou es environs proches et cette concurrence va automatiquement avoir une influence sur la perception des acheteurs quant à votre prix de vente. En fonction de ces différentes recherches, ils vont déterminer un budget d’achat qu’ils vont utiliser en filtre sur les portails d’annonces disponibles. Si votre bien est plus cher que le marché immobilier, il n’apparaîtra pas dans leurs recherches.
D’autre part, face à ce contexte, quand vous allez mettre votre bien en vente, il est important que vous ayez une bonne analyse des prix immobiliers de votre région et de votre quartier pour séduire les acheteurs. L’estimation précise de votre bien est plus que jamais essentielle dans le processus de vente. Le prix est d’ailleurs l’un des premiers critères rédhibitoires lors d’une visite pour près de 58% des acheteurs, selon une étude Meilleurs Agents. A contrario, cette même étude montre qu’un prix attractif motivera la visite d’un bien pour 45% d’entre eux.
Pour estimer votre bien au prix le plus juste, il est aussi préférable de passer par un professionnel de l’immobilier.
Lire notre article : Pourquoi passer par un professionnel au lieu de vendre par soi-même ?
2- Réduire le délai de vente
Mettre en vente au bon prix permet de réduire le délai de vente.
Il y a des moments de vie qui nous obligent parfois à devoir vendre vite : un heureux événement, une promotion, une succession. Pour y parvenir avec efficacité, il vous faudra dès le départ, fixer le prix juste. Comme le montre une récente étude Meilleurs Agents, un bien surévalué de plus de 20% affichera un délai de vente de 65 jours en moyenne. Et un bien surévalué à 10 % se vendra en 52 jours environ, tandis qu’un bien vendu au juste prix trouvera preneur dans un délai maximal de 40 jours. Par ailleurs, il est connu qu’un bien sur le marché depuis six mois ou plus devient de plus en plus difficile à vendre, sauf à accepter d’en diminuer sérieusement le prix.
Vous avez donc tout à gagner à proposer votre bien au bon prix dès sa mise sur le marché. Le délai de vente varie selon le dynamisme de la région, de la ville ou du quartier, des spécificités du bien immobilier mis en vente et de la période de l’année.
3- Limiter la négociation
Mettre en vente au bon prix permet de limiter une négociation de prix.
Un bien surestimé ne reçoit que très peu d’offres au prix. Par ailleurs, plus un bien reste longtemps en vente sur les portails d’annonces, plus il sera vu longtemps par les acheteurs et plus il perdra de son attractivité. Les acquéreurs auront compris à ce moment-là qu’ils peuvent le négocier.
Si vous avez dépassé les 3 mois, vous êtes sûr que vous aurez des offres en dessous de 10 à 15% du prix de vente de votre bien.
Un autre élément est à prendre en considération ; Si vous allez mettre sans problème en avant les atouts de votre bien, il ne faut pas pour autant dissimuler les défauts de votre habitation (comme le côté rue, un vis-à-vis prononcé ou des travaux à prévoir).
En effet, les acheteurs listeront automatiquement tous les moins ou défauts de votre bien pour justifier une offre à la baisse.
Vous l’avez compris : plus le délai sera long, plus il vous sera difficile de défendre la valeur de votre bien. Il faut garder à l’esprit qu’il sera plus compliqué pour un acheteur de négocier quand le prix correspond à la réalité du marché.
La bonne approche est de commencer par une première estimation en ligne (comme sur notre site) et de l’affiner avec un agent immobilier grâce à une estimation physique détaillée.
4- Être sûr de vendre
Fixer un prix en adéquation avec le marché local, c’est aussi être sûr de vendre.
Généralement un prix surestimé de 10 % et plus ne générera aucun appel.
S’il est surévalué de 5 %, les appels et visites seront garantis, mais aucune offre ne sera faite.
Pour information, dans certaines zones, il y a plus de vendeurs que d’acheteurs et cela va évidemment avoir un impact sur le prix, le délai de vente mais surtout la probabilité de vendre. Moins il y a d’acheteurs, plus cela augmente la période de vente.
Ainsi, si votre bien reste trop longtemps sur les sites d’annonces immobilières, les futurs acquéreurs seront méfiants et penseront que votre logement cache quelque chose.
Alors, pour vous donner toutes les chances de vendre dans les meilleures conditions, il est important d’estimer au juste prix pour attirer les bons acheteurs au bon moment.
Lire notre article : Pourquoi passer par un professionnel au lieu de vendre par soi-même ?

Vous envisagez de vendre votre bien immobilier ?
Mais vous ne savez pas s’il vaut mieux vendre seul ou passer par un intermédiaire ? Vous avez de bonnes raisons de vous poser la question, car si l’entreprise de la vente en direct est tentante, elle peut s’avérer plus complexe que prévu.
D’après une étude d’OpinionWay (2018), 38% des particuliers essayant de vendre seuls ne parviendront pas à concrétiser la vente. Autre donnée univoque : les agences immobilières sont 2,5 fois plus efficaces que les particuliers vendeurs (Étude Meilleurs Agents 2012).
En confiant la vente de votre bien à un professionnel, vous augmentez vos chances de conclure la transaction, mais vous bénéficiez aussi d’autres avantages
1- Vous bénéficiez de l’estimation fine d’un expert de l’immobilier !
Pour vous assurer de fixer le bon prix, l’aide d’un agent immobilier est indispensable. En effet, le professionnel :
- Connaît le marché immobilier,
- Prend en compte les prix réels des dernières transactions,
- Maîtrise son secteur géographique,
- Appréhende les attentes des acheteurs.
Il vous offre la garantie de positionner votre bien sur des fourchettes de prix réalistes. Il détient toute l’expertise et l’expérience nécessaires pour connaître le juste prix de votre logement à un moment donné.
Mettre en vente au prix juste est un élément clé pour maximiser les chances de vendre rapidement. Sachez que plus votre bien affichera un prix exorbitant sur le marché, plus les potentiels acquéreurs chercheront à négocier ce prix à la baisse… Bonne nouvelle, la plupart des agences estiment gratuitement votre bien immobilier. En fonction de leur analyse, vous pourrez juger de leur professionnalisme et de leur réactivité, dès le premier rendez-vous.
Pour s’assurer d’avoir un mandat de vente, la plupart des professionnels vous proposent un rapport détaillé sur l’estimation de votre bien. Cet élément vous indique que l’agent immobilier est rigoureux et tient à être transparent avec ses clients.
2- Vous bénéficiez d’un réseau professionnel tentaculaire et des canaux de communication dédiés
Au-delà de l’estimation du bien, vous allez profiter avec un professionnel d’un vivier d’acheteurs grâce à son fichier « clients », son réseau local et professionnel.
Autre atout du professionnel : il peut vous proposer un certain nombre de services pour mettre en valeur votre bien immobilier. Pour rendre votre annonce immobilière plus attractive, il produira des photographies ou des vidéos de qualité. La rédaction de l’annonce sera soignée avec des mots et expressions qui parlent aux potentiels acheteurs. Certains agents immobiliers proposent même une visite virtuelle à 360° de votre bien pour offrir aux clients une visite tranquillement installés dans leur canapé.
3- Vous bénéficiez d’un accompagnement complet et sur-mesure
Votre première préoccupation est de trouver des acheteurs. Et quand vient le moment de la sélection, le choix peut s’avérer difficile. Comment distinguer les « bons profils » avec de réelles motivations d’achat ?
Quel acquéreur ira au bout de la transaction ? Le professionnel possède l’expertise et le recul nécessaire pour faire le tri parmi les offres d’achats que vous recevez.
De plus, l’agent immobilier sélectionne les dossiers les plus solides pour s’assurer qu’il n’y a aucun risque de défaut de financement. Il vérifie la solvabilité des acheteurs : leurs revenus, les apports personnels et les crédits possibles. Son temps est dédié à votre projet immobilier. Il répond aux sollicitations, organise les visites en fonction des disponibilités des acheteurs, et il sait faire barrage avec courtoisie aux demandes les plus farfelues.
Autant dire que le particulier qui souhaite revêtir l’habit du professionnel doit avoir un emploi du temps flexible, pouvoir prendre des RTT le cas échéant afin de répondre à toutes les demandes et organiser les visites. Il devra aussi faire preuve d’une patience à toute épreuve pour gérer les visites de touristes qui viennent juste prendre le pouls du marché.
Pour gérer la négociation, qui de mieux qu’un agent rompu aux techniques de ventes immobilières et motivé par ses honoraires ?
Contrairement à un particulier, le professionnel aura tout le recul nécessaire pour négocier sur la base d’arguments factuels. Son objectif étant de vendre, il saura déceler lorsque la négociation est arrivée à sa limite.
Enfin, l’agent immobilier va vous assister sur toutes les démarches administratives et techniques pour la mise en vente :
- Fournir à l’acheteur tous les justificatifs comme les informations sur le syndic, les travaux de copropriété, les impôts fonciers et la taxe d’habitation…
- Vérifier les dix diagnostics immobiliers obligatoires et contacter le bon professionnel pour les exécuter,
- Mesurer précisément la surface habitable de la loi Carrez.
4- Vous bénéficiez d’une transaction sécurisée garantie
La signature de l’acte authentique devant le notaire est le point d’orgue d’une vente. Mais cette belle aventure peut rapidement virer « au cauchemar » si une étape juridique essentielle a été oubliée. Pour éviter ce désagrément, confiez cette tâche à un professionnel qui connait sur le bout des doigts toutes les démarches juridiques à effectuer.
Vous bénéficierez alors d’une transaction sécurisée et vous aurez le sommeil plus paisible.
Lors de la vente, le professionnel :
- Prend en charge l’organisation du compromis de vente et fait l’intermédiaire avec les différents notaires
- S’assure de la qualité du dossier financier des acheteurs (autant de paramètres difficiles à contrôler pour un particulier non spécialiste),
- S’assure du respect du délai de rétractation,
- Fait le lien entre vous, l’acquéreur et le notaire.
D’après une étude OpinionWay (2018), vous êtes 53 % à être inquiets concernant la vente de votre bien.
Confier la vente de votre bien vous garantit un gain de temps, une meilleure efficacité et surtout de la tranquillité d’esprit.
Eviter tout stress, ou même une annulation de votre vente et laissez faire le pro, qui mettra tout en œuvre pour que la transaction se passe bien et pour vendre au meilleur prix.
À ce sujet, une étude Meilleurs Agents montre que le prix net vendeur est équivalent entre les ventes en direct et les ventes réalisées par un intermédiaire. Concrètement, cela signifie que les agents immobiliers vous permettent de vendre votre bien plus cher que si vous le faites seul. Il n’y a donc que des avantages : vous ne perdez pas d’argent et vous gagnez du temps.
Qui dit mieux ?
Voir nos autres articles sur le sujet :
Honoraires d’agences- services à ne pas négliger- des économies à la clé (Rubrique passez par un pro)
Les frais de notaire sont en réalité composés de plusieurs parties et pour l'essentiel d'un ensemble d'impôts et de taxes collectés par le notaire pour le compte de différentes administrations. Il s'agit donc plutôt de frais d'acquisition, parmi lesquels on trouve les émoluments du notaire. Mais on a pris l'habitude d'appeler frais de notaire la somme versée au notaire au moment de la vente, car c'est lui qui est chargé d'en évaluer le montant et de la percevoir.
Seule une petite part revient au notaire pour sa rémunération, c'est ce qu'on appelle les émoluments du notaire. Le notaire reverse au Trésor public la part de taxe qu'il perçoit pour son compte et ce dernier reverse à son tour ce qui leur revient aux collectivités locales dont la part départementale est la plus importante.
Un des critères principaux qui détermine le montant des frais de notaire est le type d'achat : dans l'ancien ou dans le neuf. Voici comment se calculent les frais de notaire pour l'achat d'un bien ancien, car pour un achat dans le neuf, ils sont différents.
Les frais de notaire pour l'achat d'un bien ancien concernent tous les achats immobiliers de biens existants, récents ou non, y compris les biens construits depuis moins de cinq ans, à l'exclusion, simplement, des logements neufs, tels que les biens achetés en l'état futur d'achèvement.
Les acheteurs d'un bien récent sont donc logés à la même enseigne que ceux qui achètent un bien de plus de cinq ans, contrairement à ce qui se pratiquait jusqu'en 2012. Depuis, un acheteur ne peut plus bénéficier de frais de notaire réduits s'il achète un logement de moins de cinq ans à un vendeur qui l'avait acheté sur plans. Et le vendeur n'a plus à reverser de TVA sur la plus-value réalisée, comme c'était le cas à l'époque, dans cette hypothèse.
Les frais de notaire sont intégralement à la charge de l'acquéreur. Ils sont donc à intégrer dans son plan de financement, car ils représentent l'essentiel des frais à prévoir lors de l'achat d'un logement en plus de son prix. Et le notaire va détailler le plan de financement dès la signature du compromis de vente. Pour éviter les mauvaises surprises, il est donc important de les évaluer dès le départ !
Il n'est cependant pas exclu, très exceptionnellement, que les parties s'entendent pour que le vendeur les prenne en charge. Mais en pratique, cela peut arriver plutôt lors d'achat dans le neuf et reste l'exception.
Ces frais de notaire sont versés en même temps que le prix de vente du bien au moment de la signature de l'acte de vente définitif chez le notaire qui se charge de la rédaction de l'acte de vente. Ils sont réglés avec le prix de vente par virement bancaire et le notaire reverse ensuite au trésor public la part d'impôt perçue pour son compte.
Il existe de nombreuses possibilités sur Internet pour effectuer une simulation des frais de notaire. Il est possible d'anticiper ses frais de notaire depuis le site de la Chambre des notaires de Paris, par exemple.
Les frais d'acquisition d'un bien immobilier sont composés de plusieurs parties dont le montant se calcule indépendamment les unes des autres. Pour un logement ancien, on estime que le montant total de ces différentes parties représente environ 8 % du prix de vente. Toutefois, ce taux n'est pas fixe mais uniquement indicatif. Il représente presque 8 % pour un bien vendu 200.000 €. Mais plus le prix d'achat est élevé, plus cette proportion diminue, pour atteindre environ 7 % pour un bien de 700.000 €. A l'inverse, pour un bien de 100.000 €, ils dépassent 8,5 %.
Ils se décomposent en quatre postes : - Les droits de mutation, c'est-à-dire l'impôt sur la mutation ; - Les émoluments du notaire, c'est-à-dire sa rémunération pour la vente ; - Les formalités et frais divers ou débours engagés par le notaire pour la vente ; - La contribution de sécurité immobilière pour enregistrer officiellement la vente.
Pour calculer les frais de notaire, il convient de calculer le montant de chacun des quatre postes qui les composent et de les additionner. En dehors des frais divers de formalités, le montant des différents postes représente un pourcentage du prix de vente. On part donc toujours du prix de vente du logement pour calculer chacun des postes qui composent les frais de notaire.
Les droits de mutation et les émoluments du notaire sont calculés à partir de grilles tarifaires qui ont évolué au cours du temps. L'ensemble de nos explications de calcul et grilles tarifaires est à jour des tarifs qui s'appliquent en 2022.
La part la plus importante des frais de notaire correspond aux droits de mutation, c'est-à-dire la taxe de publicité foncière et les droits d’enregistrement. Il s'agit d'une taxation qui s'élève à : - 5,80 % (5,80665 % exactement) du prix de vente si le bien que vous achetez est situé dans l'un des quatre-vingt-dix-huit départements qui appliquent ce taux, c'est-à-dire presque tous ; - à 5,09 % (5,09006 % exactement) du prix de vente s'il se situe dans l'un des trois départements qui ont choisi de ne pas appliquer la hausse des droits de mutation : l'Indre (36), le Morbihan (56) et Mayotte (976).
En pratique, vous prenez le prix d'achat de votre logement que vous multipliez par 5,80 % ou 5,09 % selon la localité du bien vendu.
Si le prix de vente intègre le prix de certains meubles que laisse le vendeur (cuisine équipée, etc.), pensez à le préciser au notaire afin qu'il en distingue le prix de celui du bien lui-même, avant d'appliquer les 5,80 ou 5,09 %. Cela permet d’éviter de payer des droits de mutation sur le mobilier. Seule la vente immobilière est soumise aux droits de mutation, mais pas le mobilier vendu avec le logement. C'est donc une option intéressante pour réduire le montant des frais de notaire si la facture globale du mobilier est importante.
Pour l'achat d'un bien immobilier, il faut obligatoirement recourir aux services d'un notaire. Pour le rôle du notaire pour ce type de prestation, celui-ci reçoit des honoraires tarifés, ce qu'on appelle ses émoluments. Leur montant est calculé à l'aide d'un pourcentage dégressif qui s'applique à la valeur du bien en quatre tranches selon un barème. Cette grille tarifaire a été revue à la baisse une première fois de 1,4 % en 2016 puis de nouveau depuis le 1er janvier 2021. Cette fois, les émoluments notariés ont baissé d'environ 1,9 %.
|
Tranches de prix |
Pourcentage à appliquer |
Montant à ajouter* |
|
≤ à 6.500 € |
3,870 % |
0 |
|
De 6.501 à 17.000 € |
1,596 % |
147,81 € |
|
De 17.001 à 60.000 € |
1,064 % |
238,25 € |
|
> à 60.000 € |
0,799 % |
397,25 € |
*Le « montant à ajouter » permet un calcul rapide et simplifié sans avoir besoin de faire un calcul tranche par tranche. / TVA sur émoluments : ajouter 20 % du résultat obtenu ci-dessus.
Les émoluments du notaire s'élèvent à : 200.000 € x 0,799 % (taux de la tranche de prix supérieur à 60.000 €) = 1.598 € auxquels il faut ajouter 397,25 € (montant qui intègre les taux des autres tranches), soit 1.995,25 € au total. On applique alors la TVA à 20 % à ce montant, soit 399 €. Les émoluments du notaire s'élèvent donc au total à 2.394 € TTC.
Pour les ventes de biens immobiliers de faible valeur, le coût des émoluments du notaire est plafonné à 10 % du prix du bien, sans pouvoir être inférieur à 90 €. Ceci afin d'éviter que le coût global du notaire, émoluments et émoluments de formalités compris, dépasse 10 % du prix de vente du bien. Car à côté de sa rémunération qui est calculée selon la grille proportionnelle, le notaire facture des prestations qu’il effectue pour la vente et qui sont également tarifées selon un tableau acte par acte en tant qu’émoluments de formalités ou débours.
Selon le calcul proportionnel avec la grille tarifaire, le notaire aurait pu percevoir 331 € d’émoluments et environ 1.000 € pour les formalités, soit au total 1.331 €, ce qui représente plus de 10 % du prix de vente du bien. Désormais, dans cet exemple, sa rémunération est ramenée à 800 € (auxquels on ajoute la TVA de 20 %), soit au montant maximal de 960 € TTC.
Le notaire accomplit différentes démarches et effectue des formalités pour la transaction qui sont facturées en moyenne pour un total de 1.000 € TTC. C’est pourquoi on parle d’émoluments de formalités. Chacune des formalités ou prestations est facturée selon un barème officiel. En fonction des ventes, le notaire aura besoin de plus ou moins de démarches à effectuer. C’est pourquoi il demande une provision sur ses émoluments et fait le décompte quelques mois après la vente, en fonction du prix facturé pour les différentes démarches qu’il a effectuées.
Les frais divers ou débours : ils sont évalués, quant à eux, à environ 400 € et correspondent au remboursement de sommes que le notaire a dû payer à des tiers pour le compte de son client (frais d'expédition des actes, etc.).
Cette contribution est due à l’Etat pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité foncière, ce que l'on appelle la formalité fusionnée. Elle est fixée au taux proportionnel de 0,10 % du prix du bien, avec un minimum de 15 €. Pour un bien de 200.000 €, elle s’élève donc à 200 € (200.000 € X 0,10 %).
Une fois calculé le montant de chacun des postes qui composent les frais de notaire, vous n'avez plus qu'à les additionner pour savoir combien vous allez devoir régler. Prenons l'exemple de l'achat d'une maison ancienne à 250.000 €.
Pour l'achat d'une maison au prix de 250.000 € dans la Manche, le montant total des frais de notaire s'élève à 19.040 €. L'acheteur doit donc ajouter cette somme au prix de vente de la maison qu'il achète pour calculer son budget total d'achat.
Au total, le budget à prévoir pour acheter cette maison est de 269.040 € (250.000 € + 19.040 €) Voici comment se décomposent les frais de notaire de 19.040 € : - Les droits de mutation : 14.517 € (le calcul est le suivant : 250.000 € X 5,80665 % ) ; - Les émoluments du notaire : 2.874 € (le calcul est le suivant, selon la grille tarifaire ci-dessus : (250.000 X 0,799 %) + 397,25 € = 2.394,75 + TVA à 20 %) ; - Les émoluments de formalités : 1.000 € en moyenne ; - Les frais divers : 400 € en moyenne ; - La contribution de sécurité immobilière : 250 € (le calcul est le suivant : 250.000 € X 0,10 %).
C'est le montant à payer si vous achetez un bien situé dans la quasi-totalité des départements, sauf trois. Car dans trois départements, les droits d'enregistrement sont légèrement moins élevés : si le bien que vous achetez se situe en Indre, dans le Morbihan ou à Mayotte, le montant des frais de notaire pour un bien à 250.000 € s'élève non plus à 19.040 €, mais seulement à 17.249 €, les droits de mutation étant dans ce cas abaissés à 12.725 € au lieu de 14.517 €.
Sachez que pour une transaction de ce montant, le notaire peut vous accorder sur le montant de ses émoluments une remise d'une valeur maximale de 288 € TTC.
Le notaire a la possibilité d'accorder une remise de 20 % au maximum sur sa rémunération pour les ventes de plus de 100.000 €. La ristourne est calculée sur la part de prix du bien au-delà de 100.000 €.
Lorsque le prix de vente du bien dépasse 100.000 €, le notaire peut désormais accorder une remise sur ses émoluments dans la limite de 20 %. Le notaire peut décider librement d’accorder une remise à condition : - Que le prix de vente soit supérieur à 100.000 € ; - Que le taux de la remise soit au maximum de 20 %. Il s'applique à la part de ses émoluments calculée sur le prix au-delà de 100.000 € ; - D’appliquer la remise qu’il a décidée uniformément à l’ensemble de sa clientèle. Toutefois, le notaire peut décider de ne l’appliquer qu’au cours d’une période définie et pour certains types d’actes.
Pour une vente à 300.000 €, le notaire peut accorder une remise sur ses émoluments calculée sur la part de prix comprise au-delà de 100.000 €, soit sur 200.000 € (300.000 – 100.000 €). le calcul de ses émoluments se fait au-delà de 100.000 € donc sur 200.000 € : 200.000 X 0.799 % = 1.598 €. Avec la TVA, cela fait un total de 1.917,60 € TTC. Dans cet exemple, le notaire peut vous accorder une remise maximale de 1.917,60 € x 20 %, soit de 384 € TTC.
A ces frais peuvent s'ajouter des frais de notaire liés au crédit immobilier si vos prêts sont garantis par une hypothèque ou un privilège.
Si vous avez recours à un crédit pour financer votre achat, le contrat de prêt est obligatoirement établi devant notaire si le prêt est garanti par une hypothèque ou un privilège. Dans ce cas, les frais liés au crédit s'ajoutent aux frais de notaire pour l'achat du bien. Pour un crédit garanti par une hypothèque ou un privilège, les émoluments du notaire se calculent selon le barème.
|
Tranches de prix |
Pourcentage à appliquer |
Montant à ajouter* |
|
≤ 6.500 € |
1,290 % |
0 |
|
De 6.501 à 17.000 € |
0,532 % |
49,27 € |
|
De 17.001 à 60.000 € |
0,355 % |
79,36 |
|
> à 60.000 € |
0,266 % |
132,76 € |
*Le montant à ajouter permet un calcul rapide sans avoir besoin de faire un calcul tranche par tranche comme dans cet exemple de calcul du tarif des notaires pour un prêt de 200.000 € : - 200.000 € x 0,266 % = 532 € - 532 + 132,76 = 664,76 € - 664,76 x 20 % = 132,952 €
Montant total du tarif des notaires : 797,71 € TTC.
Par ailleurs, vous devez payer, mais seulement en cas d'hypothèque, la taxe de publicité foncière au taux de 0,715 %. Le privilège coûte donc un peu moins cher que l'hypothèque. Enfin, dans tous les cas, vous devez vous acquitter de la contribution de sécurité immobilière et des frais de formalités, pour un montant de 500 € environ.
Le prêt peut également être garanti par la caution d'une société spécialisée. Dans ce cas, le contrat de prêt n'est pas notarié et les frais de caution sont payés directement à la société caution. Ils n'entrent donc pas strictement dans ce que l'on appelle les frais de notaire.
Si vous avez plusieurs prêts, les frais sont calculés pour chacun d'eux et non pour leur montant total (ils sont donc un peu plus élevés).

Lorsque des propriétaires choisissent une agence ou se font démarcher, beaucoup se soucient peu des honoraires :
- Certains pensent A TORT que toutes les agences se ressemblent et qu’elles pratiquent donc toutes les mêmes honoraires. Ils se disent alors « A quoi bon alors s’en soucier ? »
- D’autres diront que çà ne les regardent pas et que les honoraires sont l’affaire de l’agence.
En réalité, un propriétaire ne doit JAMAIS SOUS ESTIMER la question des honoraires :
LE PRIX sera toujours l’élément DETERMINANT dans une vente et les honoraires qui sont toujours inclus dans le prix de vente influenceront forcément la réussite ou pas de la vente.
Alors un propriétaire qui maitrise les honoraires d’agence maitrise dans un même temps son prix de vente
(Car plus les honoraires sont importants, plus le prix de vente sera élevé et moins un vendeur aura d’acheteurs)
Un propriétaire se doit donc d’étudier avec précision les honoraires d’agence au même titre que les autres services de cette agence afin de pouvoir choisir celle qui l’accompagnera au mieux dans sa vente car quoi qu’on en dise, un achat se termine toujours sur le plan financier.
Et aujourd’hui, un propriétaire peut tout à fait faire appel à un professionnel « SANS SE RUINER » !
Vous verrez que l’avenir est au «FORFAIT»; Concept encore malheureusement trop méconnu !
Pour vous aider à y voir plus clair, détaillons ensemble le système de rémunération des agences !
Il existe uniquement 2 méthodes pour un professionnel de calculer ses honoraires et vous verrez que si l’une ne profite qu'au professionnel , l’autre est à l'avantage du vendeur et de l'acquéreur.
1- Les honoraires « AU POURCENTAGE »
Cela consiste à appliquer un % sur le prix de vente du propriétaire.
Exemples de grille d’honoraires :
Prix de vente de 10.000 € à 100.000 € = 10 % : soit en exemple 10.000 € d’honoraires pour un bien à 100.000 €
Prix de vente de 100.000 € à 150.000 € = 8 % : soit en exemple 12.000 € d’honoraires pour un bien à 150.000 €
Prix de vente de 150.000 € à 200.000 € = 7 % : soit en exemple 14.000 € d’honoraires pour un bien à 200.000 €
Prix de vente de 200.000 € à 300.000 € = 6 % : soit en exemple 18.000 € d’honoraires pour un bien à 300.000 €
Prix de vente de 300.000 € à 1 à500.000 € = 5 % : soit en exemple 20.000 € d’honoraires pour un bien à 400.000 €
Explication :
Même si le taux d’honoraires baisse (quand le prix du bien augmente), le montant des honoraires augmente et la facture s’alourdit.
Les honoraires s’ajoutent ensuite au prix du propriétaire : un bien à 300.000 € avec 18.000 € d’honoraires (6%) sera vendu et proposé en publicité à 318.000€
2- Les honoraires « AU FORFAIT »
Il s’agit d’un MONTANT d’honoraires FIXE et REDUIT qui n’est plus indexé sur le prix de vente.
Exemple de FORFAIT :
Un forfait à 7.500 € pour vendre une maison.
Explication :
Montant qui ne change pas quel que soit le prix de vente de la maison.
Une maison de 200000 € sera vendue 207500 €
Une maison de 300000 € sera vendue 307500 €
Une maison de 500000 € sera vendue 507500 €
3- Comparaison entre les honoraires au « AU FORFAIT » et au « POURCENTAGE»
Dans une agence au « pourcentage » :
Une villa à 300.000 € avec 18.000 € (honoraires) sera vendue 318.000 €
Dans une agence au « FORFAIT » :
Une villa à 300.000 € avec 7.500 € (honoraires) sera vendue 307.500 €
Le FORFAIT génère une ECONOMIE de 10.500 € sur les honoraires.
Dans une agence au « pourcentage » :
Une villa à 400.000 € avec 20.000 € (honoraires) sera vendue 420.000 €
Dans une agence au « FORFAIT » :
Une villa à 400.000 € avec 7.500 € (honoraires) sera vendue 407.500 €
Le FORFAIT génère une ECONOMIE de 12.500 € sur les honoraires.
1- Les honoraires AU POURCENTAGE : Ce système de % n’a que des inconvénients :
- Le vendeur est pénalisé dans sa recherche d’acquéreurs car les honoraires augmentent considérablement le prix de vente. (Plus le prix est élevé, moins le propriétaire aura d’acquéreurs.)
- L’ acquéreur de son côté perd énormément de pouvoir d’achat et doit se résigner à acheter moins cher ou plus petit.
- L’acquéreur qui souhaite passer par un professionnel pour se sécuriser hésitera à faire appel à ces agences.
Les honoraires au « pourcentage » sont le mode de calcul le plus répandu chez les professionnels.
Il est utilisé par 99 % des agences ou professionnels que ce soit :
- Les agences « traditionnelles » comme Orpi, Laforet, Nestenn , Century 21, Guy hoquet, Arthurimmo.com, Era immobilier, L’adresse, Plaza immobilier
- Les réseaux de mandataires comme Capi France, BSK immobilier, Safti, IAD, Optimhome, propriété privée, Maxihome…
Ce système avantage exclusivement le professionnel à faire toujours plus de profit au détriment de l'intérêt du vendeur et de l’acheteur qui est de recueillir le plus d’acquéreurs possible et de payer un service à sa juste valeur.
2- Les honoraires « AU FORFAIT » : Ce système de FORFAIT n’a au contraire que des avantages :
- Le FORFAIT permet au propriétaire de rester dans les prix du « marché » même en incluant des honoraires. (Le prix de vente n’est pas gonflé artificiellement en devenant « prohibitif ».)
- Le propriétaire peut donc bénéficier de tous les services d’un professionnel « à moindre coût »
- Le propriétaire aura moins de négociation sur son bien puisque l’acquéreur disposera de plus de pouvoir d’achat.
- L’acquéreur paie un service à sa juste valeur et ne se sent pas abusé
- L’acquéreur connait le coût du service (qui ne changent pas) et peut ainsi se concentrer sur le bien et son prix
- L’acquéreur fait d’énormes économies et augmente son pouvoir d’achat:
- Il peut ainsi acheter plus grand
- Il peut faire des travaux si nécessaire
- Il peut payer une partie de frais de notaire
- Il peut aussi diminuer son emprunt
Ce système de « FORFAIT » est à la fois transparent (aucune surprise sur les honoraires à payer quel que soit le bien présenté), et équitable ou chacun y trouvera son compte (avoir un service professionnel à un cout très modéré).
Le FORFAIT est malheureusement encore très peu répandu .
Nous avons recensé uniquement 3 agences immobilières dans la France pratiquant ce concept de FORFAIT :
Département de l’Essonne : L’agence au forfait unique www.agenceforfaitunique.fr
Département de la Haute Garonne : L’AFFICHE IMMOBILIERE www.lafficheimmobiliere.fr
Paris : UNE MAISON BLEUE www.unemaisonbleue.com
Notre conseil : SI VOUS TROUVEZ DANS VOTRE SECTEUR UNE AGENCE « AU FORFAIT » , n’hésitez pas à recourir à ses services car on demande à un professionnel d’apporter une différence et une plus-value dans son travail et l’agence au « FORFAIT » SE DEMARQUE VRAIMENT DE SES CONCURRENTS.
Une chose est certaine : seules les agences pratiquant un FORFAIT permettent aujourd’hui de faire des économies dès la signature d’un mandat et SANS AVOIR A NEGOCIER. (Et comme on dit : Ce qui est acquis n’est plus à prendre !!)
Mais pour les propriétaires qui seraient tentés de vouloir négocier les honoraires d’une agence à la prise de mandat, ils peuvent toujours essayer mais c’est une très mauvaise idée !
Pourquoi et quelles sont les situations que vous pouvez rencontrer ?
1- L’agent immobilier vous « promet » de baisser ses honoraires au moment de la négociation : NE JAMAIS ACCEPTER
En effet, il ne tiendra que très rarement sa parole pour la simple raison que le jour où vous aurez enfin un bon client, il vous trouvera tous les arguments pour défendre au maximum sa commission (On a mis du temps, j’ai beaucoup investi , ma direction ne veut plus…) ; Il vous fera même une sorte de « chantage au client » puisque l’acquéreur ne pouvant passer que par lui et par peur de passer à côté de votre vente, vous serez obligé de capituler et de prendre la baisse du prix à votre charge
2- L’agent immobilier vous accorde une « baisse d’honoraires » à la prise de mandat : Vous vous direz alors que vous avez fait une bonne affaire et que vous avez remporté une manche face à l’agent immobilier.
ERREUR ! vous ne serez malheureusement pas traité de la même manière et sur un pied d’égalité face aux autres propriétaires de l’agence. En effet, un agent immobilier proposera toujours en 1ere visite des clients , le bien sur lequel il aura les honoraires « les plus élevés ». Quant à vous qui les avez négociés, votre bien sera présenté et visité en dernier lieu.
La négociation des honoraires est par conséquent une très mauvaise chose si vous voulez que l’agent immobilier présente votre bien en toute impartialité et égalité vis-à-vis des autres propriétaires.

Achat en indivision et régime d'indivision
L'indivision est la situation juridique dans laquelle deux ou plusieurs personnes sont propriétaires ensemble d'un même bien. A priori, elle permet un financement, un entretien et une gestion plus faciles.
1- Pourquoi acheter en indivision ?
L’indivision apparaît comme la solution la plus facile pour acheter un bien à plusieurs.
Bien entendu, ce n’est pas la seule (il est possible d’opter pour des formules plus spécifiques comme la SCI par exemple), mais c’est de loin la moins contraignante. Elle s’applique à défaut de choix d’une autre forme d’acquisition.
Chaque acquéreur est propriétaire du bien à hauteur de sa contribution financière lors de l’achat (30/70, 40/60, 50/50, etc.), sans que sa quote-part ne soit matériellement distinguée.
L'achat en indivision présente donc une grande simplicité, du moins au départ, notamment pour les concubins ou les couples pacsés qui souhaitent acquérir leur logement à deux.
2- L'indivision comporte-t-elle des risques ?
Une fois le bien acheté, chacun des propriétaires (appelé indivisaire) a des droits sur la totalité du bien. Les décisions les plus importantes doivent être prises à l’unanimité (sauf exceptions). Ce qui, en cas de désaccord, peut vite entraîner des situations de blocage.
Par ailleurs, chaque indivisaire est tenu de régler les dettes de l’indivision (impôts ou travaux sur le logement par exemple), à proportion de sa quote-part. Autant dire qu’il est fondamental de bien évaluer les risques de mésentente avant l’achat.
Enfin le régime de l’indivision est provisoire. La loi pose comme principe que "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision". Trois solutions s’offrent aux indivisaires : - l’un des indivisaires peut mettre en vente sa quote-part, les autres ne peuvent s’y opposer. Toutefois, ils disposent d'un droit de préemption sur la quote-part cédée. - Les indivisaires peuvent décider à l’unanimité de vendre le bien à un tiers. A défaut d’accord, la vente peut, sous certaines conditions, intervenir à la majorité des deux tiers des droits indivis (C. civ. art. 815-5-1). - L’un d’eux peut à tout moment de demander le partage (C. civ. art. 815).
Cette situation n’est pas sans risque ; Mieux vaut l’anticiper par une convention d’indivision.
3- Indivision : comment éviter les risques ?
La convention d'indivision
Il est possible de corriger cette situation d’insécurité grâce à la signature d'une convention d'indivision.
A peine de nullité, cette convention doit être établie par écrit, lister les biens indivis et préciser les droits de chaque indivisaire. Dès lors qu’elle porte sur un bien immobilier, elle doit en outre être rédigée par un notaire et faire l’objet d’une publication au Service de la publicité foncière.
Elle peut être conclue pour une durée déterminée (cinq ans au maximum). A terme, les indivisaires demeurent libres de la renouveler.
La convention d’indivision a pour but d’organiser la gestion de l’indivision et d’en fixer les règles du jeu. Les indivisaires peuvent aménager la répartition de leurs dépenses, nommer un gérant (choisi ou non parmi eux), arrêter le montant d’une indemnité d’occupation (si l’un d’entre eux occupe seul le bien par exemple), etc...
Lorsque la convention est conclue à durée indéterminée, le partage peut être demandé, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi (volonté de nuire aux indivisaires) ou à contretemps (période économiquement défavorable au partage).
4- Existe-t-il d’autres situations d’indivision ?
L'indivision n'est pas toujours une situation choisie. Elle peut être subie à l’occasion d’un décès par exemple, en attendant la partage des biens d’une succession (indivision successorale) ; ou lors de la dissolution d’une communauté conjugale au moment d’un divorce (indivision post-communautaire).
Mais qu’elle soit constituée de manière volontaire ou involontaire, l’indivision demeure soumise aux mêmes règles. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre notaire pour en connaître les tenants et aboutissants.
Source : Notaires.fr

ATTENTION Ne concerne que les baux signés à compter du 15 juillet 2022 et non meublé
Le bail (ou contrat de location) recense les droits et les obligations du propriétaire et du locataire. Si le logement loué sert de résidence principale au locataire, le bail conclu doit respecter les règles (mentions et informations obligatoires) relatives aux locations à usage d'habitation principale.
Le bail doit être fait par écrit en autant d'exemplaires qu'il y a de parties (propriétaire, locataire, caution).
Il peut prendre la forme d'un acte sous signature privée (Acte rédigé et signé par des particuliers, sans la présence d'un notaire (par exemple, un contrat) ou d'un acte authentique (Document établi par un officier public compétent, tels qu'un notaire, un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire), un officier d'état civil, rédigé selon les formalités exigées par la loi et dont le contenu peut avoir la même valeur qu'une décision judiciaire.)
Il doit être conforme au modèle de bail réglementaire.
Le bail doit préciser les informations suivantes :
- Nom et domicile du propriétaire
- Si le logement n'est pas géré directement par le propriétaire, nom et siège social du gestionnaire
- Noms du ou des locataires
- Date de prise d'effet et durée du bail
Le bail doit préciser les informations suivantes :
- Consistance du logement et sa destination (usage d'habitation, usage professionnel ou usage mixte)
- Description du logement (maison ou appartement, nombre de pièces) et de ses équipements à usage privatif et commun
- Nature et montant des travaux effectués dans le logement depuis le dernier bail (ou le dernier renouvellement)
- Surface habitable du logement. Si elle n'est pas mentionnée ou si elle est erronée, le locataire peut intenter une action en diminution de loyer.
Si le bail ne mentionne pas la surface habitable du logement loué, le locataire peut mettre en demeure le propriétaire de le faire dans un délai d'un mois suivant la date du bail.
Le propriétaire dispose à son tour d'un mois pour apporter cette précision.
Si le propriétaire refuse, ou s'il ne répond pas dans ce délai, le locataire peut saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir une diminution de loyer. Le locataire doit saisir le juge dans un délai de 3 mois à partir de la mise en demeure du propriétaire. Le juge à saisir est celui du tribunal dont dépend le logement loué.
Si le bail mentionne une surface supérieure de plus de 5 % à la surface réelle du logement loué, le locataire peut demander au propriétaire une diminution de loyer proportionnelle à l'écart constaté.
Le locataire doit envoyer une demande au propriétaire par courrier recommandé avec avis de réception.
Le propriétaire doit répondre dans les 2 mois qui suivent la réception de ce courrier.
Si aucun accord n'est trouvé ou en l'absence de réponse du propriétaire, le locataire peut saisir le juge des contentieux de la protection pour qu'il fixe la réduction de loyer à appliquer. Le locataire doit saisir le juge dans les 4 mois qui suivent l'envoi de sa demande au propriétaire. Le juge à saisir est celui du tribunal dont dépend le logement loué.
La diminution de loyer acceptée par le propriétaire ou décidée par le juge s'applique : - si la demande a été faite dans les 6 mois qui suivent la signature du bail, à partir de la date de signature du bail, - si la demande a été faite plus de 6 mois après la signature du bail, à partir de la date de la demande.
Certaines informations relatives au loyer doivent être insérées dans le bail :
- Montant du loyer et ses modalités de paiement (date et fréquence qui est généralement mensuelle), ainsi que ses règles de révision éventuelle
- Montant du dernier loyer appliqué au précédent locataire (s'il a quitté le logement depuis moins de 18 mois)
- Modalités de paiement des charges
- Montant du dépôt de garantie s'il est prévu
- Montant des dépenses théoriques de chauffage (et l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation)
Si le propriétaire fait appel à un professionnel pour la mise en location du logement, le bail doit mentionner les informations suivantes :
- Règles relatives au partage des frais (reproduction de l'article 5 I de la loi de 1989)
- Montants des plafonds de facturation applicables au locataire
Le locataire et le propriétaire peuvent convenir d'inclure d'autres clauses dans le bail. Mais elles ne doivent pas figurer parmi la liste des clauses interdites. Si une telle clause figure dans le bail, elle ne doit pas être appliquée. Il s'agit notamment des clauses :
- imposant comme mode de paiement du loyer le prélèvement automatique
- ou interdisant au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui
- ou prévoyant des frais de délivrance ou d'envoi de quittance.
Un dossier de diagnostic technique doit être annexé au bail. Le dossier comprend les documents suivants :
- Diagnostic de performance énergétique (DPE)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) si le logement date d'avant janvier 1949
- État des risques et pollutions si le logement est situé dans une zone à risque (inondations, séismes, avalanches, ...)
- État de l'installation intérieure de l'électricité si l'installation a plus de 15 ans
- État de l'installation intérieure du gaz si l'installation a plus de 15 ans ou si le dernier certificat de conformité a plus de 15 ans
- Si le logement est situé dans une zone de bruit définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, un document comportant l'indication claire et précise de la zone de bruit dans laquelle se trouve le logement.
À savoir
Le dossier de diagnostic technique est transmis au locataire par courrier électronique, sauf si le locataire ou le propriétaire s'y oppose.
En remplacement de l'état de l'installation intérieure de l'électricité, le bailleur peut fournir :
- un état de l'installation intérieure de l'électricité réalisé depuis moins de 6 ans dans le cadre de la vente du logement
- ou une attestation de conformité relative à la mise en conformité ou à la mise en sécurité de l'installation électrique délivrée depuis moins de 6 ans par un organisme agréé. Si l'attestation ne peut pas être fournie, la déclaration de l'organisme agréé.
En remplacement de l'état de l'installation intérieure de gaz, le bailleur peut fournir :
- un état de l'installation intérieure du gaz réalisé depuis moins de 6 ans dans le cadre de la vente du logement
- ou un état de l'installation intérieure de gaz réalisée depuis moins de 6 ans par un professionnel certifié par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (Cofrac).
À savoir
Le diagnostic amiante n'a pas à être annexé au contrat de location, mais doit être tenu à la disposition du locataire qui en fait la demande.
D'autres documents doivent également être annexés au bail :
- Notice informative
- État des lieux d'entrée établi lors de la remise des clés et l'état des lieux de sortie réalisé lors de la restitution des clés
- Attestation d'assurance contre les risques locatifs que le locataire doit obligatoirement souscrire
- Énumération des équipements d'accès aux technologies de l'information et de la communication (câble, TNT, fibre...)
- Copie de la convention Anah si le logement loué est conventionné
- Copie de la grille de vétusté si le locataire et le propriétaire ont convenu d'en appliquer une
- Si le logement est situé dans un immeuble en copropriété, un extrait du règlement de copropriété. L'extrait porte sur la destination de l'immeuble la jouissance des parties privatives et communes. Il porte également sur la quote-part: Fraction de la part des parties communes rattachée à un lot (appartement, local commercial, parking, cave...) selon, entre autres, la situation et la superficie de ce lot afférente au logement loué dans chacune des catégories de charges.
Si le logement est situé dans une zone d'habitat indigne, sa mise en location (le renouvellement et la reconduction du bail n'y sont pas soumis) peut nécessiter :
- d'obtenir en mairie une autorisation préalable à annexer au contrat de bail
- ou de déposer en mairie une déclaration contre récépissé, dont une copie doit être remise au locataire.
Le bail doit être conclu pour une durée minimum de :
- 3 ans lorsque le propriétaire est un particulier,
- 6 ans quand le propriétaire est une personne morale (par exemple une société, une association).
Par exception, la durée peut être inférieure à 3 ans (ou 6 ans), mais d'au minimum 1 an, si le propriétaire prévoit de reprendre son logement pour des raisons familiales ou professionnelles. Exemple : retraite qui oblige le propriétaire à reprendre son logement.
Le motif de reprise qui justifie cette durée plus courte doit impérativement figurer dans le bail.
Le propriétaire doit confirmer au locataire, au minimum 2 mois avant la fin du bail, que l'événement est réalisé et qu'il reprendra le logement à la date prévue. Le propriétaire doit envoyer cette confirmation par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'a pas été confirmé, le bail doit se poursuivre jusqu'au délai de 3 ans.
À la fin du bail, et en l'absence de préavis (congé) donné par le propriétaire ou le locataire, le bail est :
- soit renouvelé sur proposition du propriétaire
Source : service public

1- Caractéristiques du mandat
Dans la mesure où il intervient pour le compte d'autrui, l'agent immobilier agit en qualité de mandataire de ses clients. Il ne peut alors valablement exercer son activité d'entremise que s'il dispose à cet effet d'un mandat écrit, signé et en cours de validité.
Le mandat donné à un agent immobilier doit impérativement comporter :
- La durée du mandat (il est limité dans le temps à trois mois en général)
- La rémunération de l'agent, ainsi que la mention de qui en aura la charge (mandant ou cocontractant)
- L'étendue de la mission
- Les conditions de maniement des fonds et de reddition des comptes
- Le numéro d'inscription au registre des mandants.
2- Le mandat peut être simple ou exclusif.
- LE MANDAT « SIMPLE » permet à un propriétaire de confier la vente de son bien à plusieurs professionnels en même temps et d'effectuer aussi lui-même la recherche d'un éventuel acheteur.
En faisant jouer la concurrence entre professionnels, le propriétaire s’assure que l’agent immobilier donnera le meilleur de lui-même dans sa recherche de solutions pour vendre le bien.
Le propriétaire veillera en revanche à ne confier son bien à un nombre limité d’agences (max 3) sinon les acquéreurs pourraient penser que le bien est difficile à vendre.
Le propriétaire veillera aussi à choisir des professionnels offrant des « services différents » (Prendre des gens qui font la même chose n’apporte rien.)
Un service différent sera notamment de privilégier une agence qui a des honoraires réduits comme une agence au « FORFAIT » qui permettra de toucher plus d’acheteurs avec les économies réalisées. (En exemple : www.lafficheimmobiliere.fr )
Ce mandat est de loin le plus répandu et celui qu’il faut privilégier
ATTENTION : Certaines agences n'hésitent pas à mettre dans leur mandat simple des clauses abusives" qui dénaturent la vraie portée du mandat simple et pénalisent ainsi les propriétaires en ne permettant pas de faire jouer la concurrence sur les honoraires. (Lire notre article sur les clauses "abusives" dans la rubrique "passer par un pro")
- LE MANDAT « EXCLUSIF » quant à lui est confié à un seul agent immobilier.
La clause d'exclusivité doit être mentionnée en caractères très apparents.
Passé un délai de trois mois, le mandat exclusif peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties sous réserve du respect d'un préavis de 15 jours minimum. Une clause pénale (prévoyant des dommages et intérêts) peut également y être stipulée si le propriétaire ne respecte pas ses engagements, mais elle ne pourra pas être supérieure à au montant des honoraires initialement prévus.
Le mandat exclusif est à éviter pour un propriétaire.
Il permet juste à une agence d'être sûr de pouvoir toucher sa commission puisqu'elle est la seule à vendre le bien . C'est uniquement du "protectionnisme d'honoraires".
il ne permet pas de faire jouer la concurrence et oblige l'acheteur à payer "le prix fort" si l'agence prend des honoraires élevés (Lire notre article "Exclusivité - le piège à éviter" dans la rubrique "passer par un pro")
- LE MANDAT « SEMI-EXCLUSIF » est une variante du mandat exclusif.
Il permet de confier un bien à une seule agence et au propriétaire en même temps.
Ce mandat est à éviter comme le mandat exclusif.
Les inconvénients sont majeurs : Même si le propriétaire peut vendre son bien, les agences insèrent une clause obligeant le propriétaire à renvoyer obligatoirement tous ses clients vers l’agence. Le propriétaire en ressort « perdant »
3- Cas particulier des contrats conclus hors établissement
Les dispositions du Code de la consommation en matière de contrats conclus hors établissement s'appliquent aux professionnels de l'immobilier. C'est le cas lorsque l'agent immobilier fait souscrire à un consommateur un contrat d'intermédiation immobilière (signature d'un mandat de vente) en dehors de son agence (lieu de travail du consommateur, etc.).
Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles (c'est-à-dire location non saisonnière ou touristique) ne bénéficient en revanche pas de ces dispositions protectrices (article L. 221-2 12°). Les obligations du professionnel portent sur :
- La délivrance des informations précontractuelles listées à l'article L. 221-5 du Code de la consommation et notamment sur l'existence d'un droit de rétractation (formulaire type).
- Le fait de laisser au consommateur un délai de réflexion de 14 jours lui permettant d'exercer sa faculté de renonciation. Il ne peut en aucun cas y renoncer mais peut toutefois demander que la prestation de service proposée par l'agent immobilier commence immédiatement.

Ne vous faites pas piéger !
DITES NON A L’EXCLUSIVITE !!!
Si faire appel à un agent immobilier est aujourd’hui nécessaire pour vendre un bien, le mandat «simple» reste la meilleure solution pour un propriétaire et son acheteur.
Mais tous les agents immobiliers essaieront un jour de faire signer un contrat d’exclusivité !!!!
A ce titre, leur discours est parfaitement bien rodé et bon nombre de propriétaires se laisseront malheureusement ENCORE «prendre au piège».
Derrière de jolis arguments, l’exclusivité n’a pour seul objectif que de permettre à une agence d’être la SEULE A POUVOIR TOUCHER « les honoraires ».
L’agent immobilier n’agit donc que dans son seul intérêt et non celui du propriétaire.
L’exclusivité n’est en réalité que protectionnisme d’honoraires !
Nous allons ci-dessous vous montrer les pièges et vous donner tous les arguments avancés par un agent immobilier en vous indiquant pour chacun d’eux, ce que ce dernier ne vous pas dit.
1 - Le propriétaire ne peut plus vendre son bien par lui-même !
Obligé de ne passer que par l’ agence, un propriétaire se prive de l’opportunité de trouver lui-même un acquéreur (Avec son relationnel, le bouche à oreille, ses connaissances……On dit que le hasard fait bien le choses, et à ce titre, un propriétaire pourrait fort bien croiser son futur acheteur au coin de la rue ou chez son petit commerçant de quartier …)
De plus, est-il normal de priver un propriétaire de son droit le plus fondamental : celui de la propriété ?
2 – Le propriétaire oblige son acquéreur à acheter obligatoirement avec une seule agence !
Tout le monde a des préférences ou des affinités avec certains professionnels et pas d’autres !
Chacun de nous avons d’ailleurs l’habitude d’aller toujours dans les mêmes magasins ou chez les mêmes commerçants.
En ne passant que par une seule agence, un propriétaire perdrait donc tous les clients qui ne voudraient pas passer par celle dernière.
3 - Le propriétaire oblige son acquéreur à payer le prix fort et une commission exorbitante !
L’immobilier est un secteur très concurrentiel et certaines agences pratiquent aujourd’hui des honoraires bas. C’est le cas des agences au « FORFAIT » qui pratiquent jusqu’à 70% de réduction sur des honoraires « classiques ».
L’exclusivité ne permet donc pas de faire jouer la concurrence et prive un acquéreur de faire de substantielles économies avec une autre agence.
Vous-même, ne vous arrive –t- il pas de comparer les enseignes avant de faire un achat important et de ne pas vous arrêter à un seul prix ?
Les acquéreurs réagissent comme tout acheteur !! ILS VEULENT AVANT TOUT FAIRE DES ECONOMIES SUR LE SERVICE ce que ne permet pas le mandat exclusif.
1 - Nous nous investissons davantage quand le bien nous est confié en exclusivité ! FAUX !
Quand une agence est « seule en course » et qu’elle est assurée de toucher sa commission, pensez-vous réellement qu’elle ait besoin de se surpasser ?
(On n’imaginerait pas une personne participant seule à une course se donner à fond alors même qu’elle est sure d’arriver la première !!)
Par ailleurs, si vous prenez le temps de comparer les agences, vous remarquerez que les agences qui doivent justifier de l’exclusivité vous diront que certaines prestations sont en « en option » et ne figurent que dans leur mandat exclusif alors que d’autres professionnels vont vous proposer les mêmes prestations dans leur mandat simple.
2 - Il ne faut pas mettre votre bien dans plusieurs agences à des prix différents au risque de le voir se déprécier ! FAUX !
Premièrement, si un bien se déprécie aux yeux des clients, c’est uniquement parce qu’il reste trop longtemps à la vente du fait d’un prix de vente mal évalué et trop élevé.(et la faute souvent à des honoraires trop chers !!)
Un bien ne se déprécie pas du fait d’être dans plusieurs agences. Pour exemple : si vous décidez un jour de changer de télé et que le modèle de votre choix est moins cher dans une autre enseigne, pensez vous que la télé sera « dépréciée » à vos yeux ou de moins bonne qualité dans le magasin le moins cher. (Non, vous serez bien heureux de l’avoir trouvé ailleurs et moins chère.)
Et un bien immobilier n’échappe pas à la règle !
Par ailleurs, tous les clients savent que quand un bien est présenté dans plusieurs agences, la différence de prix vient forcément du montant des honoraires.
3 - Avec la signature d’un seul mandat, vous allez bénéficier d’un réseau de plusieurs agences (SIA / FFIP / AMEPI) pour vendre votre bien. FAUX !
Chaque agence affiliée à ce genre de « réseau » (SIA / FFIP / AMEPI) tient le même discours à chaque propriétaire uniquement dans le but de rentrer « ses propres exclusivités » mais sans proposer pour autant les biens des autres membres.
2 raisons à cela :
- Par principe, un agent immobilier n’aime pas partager et encore moins ses honoraires. C’est pourtant ce qu’il devrait faire si un confrère vendait à sa place le bien qu’il avait rentré.
Il devrait partager ses honoraires. C’est pourquoi, dans son discours , un agent immobilier fait miroiter au propriétaire qu’une multitude d’agences seront présentes pour lui trouver un acquéreur alors que dans les faits, chaque agence proposera seule ses exclusivités pour s’assurer de toucher les honoraires en entier. (On pourrait appeler cela un miroir aux alouettes.)
- La 2ème raison est que pour vendre, il faut connaitre parfaitement le bien pour l’avoir vu et visité; pensez-vous alors que toutes les agences « de ce réseau » vont pouvoir proposer un bien qu’elles n’ont jamais vu ?
Cela prouve que le beau discours de ceux qui vous vantent ces réseaux (SIA / FFIP / AMEPI) n’est que mensonge pour vous faire signer une exclusivité
GARDEZ VOTRE LIBERTE – FUIEZ L’EXCLUSIVITE

Ne vous faites pas piéger !
DITES NON A L’EXCLUSIVITE !!!
Si faire appel à un agent immobilier est aujourd’hui nécessaire pour vendre un bien, le mandat «simple» reste la meilleure solution pour un propriétaire et son acheteur.
Mais tous les agents immobiliers essaieront un jour de faire signer un contrat d’exclusivité !!!!
A ce titre, leur discours est parfaitement bien rodé et bon nombre de propriétaires se laisseront malheureusement ENCORE «prendre au piège».
Derrière de jolis arguments, l’exclusivité n’a pour seul objectif que de permettre à une agence d’être la SEULE A POUVOIR TOUCHER « les honoraires ».
L’agent immobilier n’agit donc que dans son seul intérêt et non celui du propriétaire.
L’exclusivité n’est en réalité que protectionnisme d’honoraires !
Nous allons ci-dessous vous montrer les pièges et vous donner tous les arguments avancés par un agent immobilier en vous indiquant pour chacun d’eux, ce que ce dernier ne vous pas dit.
1 - Le propriétaire ne peut plus vendre son bien par lui-même !
Obligé de ne passer que par l’ agence, un propriétaire se prive de l’opportunité de trouver lui-même un acquéreur (Avec son relationnel, le bouche à oreille, ses connaissances……On dit que le hasard fait bien le choses, et à ce titre, un propriétaire pourrait fort bien croiser son futur acheteur au coin de la rue ou chez son petit commerçant de quartier …)
De plus, est-il normal de priver un propriétaire de son droit le plus fondamental : celui de la propriété ?
2 – Le propriétaire oblige son acquéreur à acheter obligatoirement avec une seule agence !
Tout le monde a des préférences ou des affinités avec certains professionnels et pas d’autres !
Chacun de nous avons d’ailleurs l’habitude d’aller toujours dans les mêmes magasins ou chez les mêmes commerçants.
En ne passant que par une seule agence, un propriétaire perdrait donc tous les clients qui ne voudraient pas passer par celle dernière.
3 - Le propriétaire oblige son acquéreur à payer le prix fort et une commission exorbitante !
L’immobilier est un secteur très concurrentiel et certaines agences pratiquent aujourd’hui des honoraires bas. C’est le cas des agences au « FORFAIT » qui pratiquent jusqu’à 70% de réduction sur des honoraires « classiques ».
L’exclusivité ne permet donc pas de faire jouer la concurrence et prive un acquéreur de faire de substantielles économies avec une autre agence.
Vous-même, ne vous arrive –t- il pas de comparer les enseignes avant de faire un achat important et de ne pas vous arrêter à un seul prix ?
Les acquéreurs réagissent comme tout acheteur !! ILS VEULENT AVANT TOUT FAIRE DES ECONOMIES SUR LE SERVICE ce que ne permet pas le mandat exclusif.
1 - Nous nous investissons davantage quand le bien nous est confié en exclusivité ! FAUX !
Quand une agence est « seule en course » et qu’elle est assurée de toucher sa commission, pensez-vous réellement qu’elle ait besoin de se surpasser ?
(On n’imaginerait pas une personne participant seule à une course se donner à fond alors même qu’elle est sure d’arriver la première !!)
Par ailleurs, si vous prenez le temps de comparer les agences, vous remarquerez que les agences qui doivent justifier de l’exclusivité vous diront que certaines prestations sont en « en option » et ne figurent que dans leur mandat exclusif alors que d’autres professionnels vont vous proposer les mêmes prestations dans leur mandat simple.
2 - Il ne faut pas mettre votre bien dans plusieurs agences à des prix différents au risque de le voir se déprécier ! FAUX !
Premièrement, si un bien se déprécie aux yeux des clients, c’est uniquement parce qu’il reste trop longtemps à la vente du fait d’un prix de vente mal évalué et trop élevé.(et la faute souvent à des honoraires trop chers !!)
Un bien ne se déprécie pas du fait d’être dans plusieurs agences. Pour exemple : si vous décidez un jour de changer de télé et que le modèle de votre choix est moins cher dans une autre enseigne, pensez vous que la télé sera « dépréciée » à vos yeux ou de moins bonne qualité dans le magasin le moins cher. (Non, vous serez bien heureux de l’avoir trouvé ailleurs et moins chère.)
Et un bien immobilier n’échappe pas à la règle !
Par ailleurs, tous les clients savent que quand un bien est présenté dans plusieurs agences, la différence de prix vient forcément du montant des honoraires.
3 - Avec la signature d’un seul mandat, vous allez bénéficier d’un réseau de plusieurs agences (SIA / FFIP / AMEPI) pour vendre votre bien. FAUX !
Chaque agence affiliée à ce genre de « réseau » (SIA / FFIP / AMEPI) tient le même discours à chaque propriétaire uniquement dans le but de rentrer « ses propres exclusivités » mais sans proposer pour autant les biens des autres membres.
2 raisons à cela :
- Par principe, un agent immobilier n’aime pas partager et encore moins ses honoraires. C’est pourtant ce qu’il devrait faire si un confrère vendait à sa place le bien qu’il avait rentré.
Il devrait partager ses honoraires. C’est pourquoi, dans son discours , un agent immobilier fait miroiter au propriétaire qu’une multitude d’agences seront présentes pour lui trouver un acquéreur alors que dans les faits, chaque agence proposera seule ses exclusivités pour s’assurer de toucher les honoraires en entier. (On pourrait appeler cela un miroir aux alouettes.)
- La 2ème raison est que pour vendre, il faut connaitre parfaitement le bien pour l’avoir vu et visité; pensez-vous alors que toutes les agences « de ce réseau » vont pouvoir proposer un bien qu’elles n’ont jamais vu ?
Cela prouve que le beau discours de ceux qui vous vantent ces réseaux (SIA / FFIP / AMEPI) n’est que mensonge pour vous faire signer une exclusivité
GARDEZ VOTRE LIBERTE – FUIEZ L’EXCLUSIVITE

Nous sommes convaincus que l’intervention d’un Agent immobilier est aujourd’hui plus que nécessaire afin de rassurer chacune des parties ( acheteur comme vendeur), compte tenu d’un environnement juridique de plus en plus complexe.
Et le mandat « simple » reste à nos yeux le contrat qui garantie au mieux les intérêts d’un propriétaire (voir notre article « Mandat de vente exclusif LE PIÈGE A EVITER » dans notre rubrique « Passez par un pro »)
Toutefois, certains professionnels ont trouvé le moyen de glisser dans leur mandat « simple » des clauses à notre sens « abusives » pour éviter toute concurrence.
En insérant ces clauses dans leur mandat, ces professionnels agissent uniquement dans leur propre intérêt et non dans l’intérêt des vendeurs.
Attention, il ne s’agit pas de faire le procès de tous les agents immobiliers, mais seulement de faire le tri entre les bons et les mauvais professionnels qui abuseraient de la situation.
Nous portons donc à votre connaissance des clauses que des propriétaires ont relevé dans leur mandat afin que vous puissiez les repérer avant toute signature de mandat de vente.
Rappelons avant tout les règles issues du mandat « simple » :
- Vous pouvez confier votre bien à n’importe quel professionnel (ce qui signifie : autant d'agences que vous souhaitez).
- Vous pouvez faire jouer la concurrence et prendre une agence qui pratique des honoraires réduits voire « forfaitaires » de façon à afficher un prix « en publicité » plus bas pour obtenir plus de clients.
- Vous pouvez vendre votre bien par vous-même.
En résumé, avec un mandat « simple » vous devez avoir LA LIBERTE de faire ce que vous voulez
Il ne peut donc y avoir dans votre mandat « simple » le type de clause suivante (que vous pouvez trouver dans le paragraphe « obligations du mandant » de chaque mandat)
1- Clause prévoyant : « Une obligation d’afficher le bien en vente à condition de prix égale ou supérieur. » et « une obligation de limiter le nombre d’intermédiaires professionnels »
L’objectif d’un vendeur est de trouver un acheteur par n’importe quel moyen et notamment en trouvant une agence moins chère « en honoraires » ce qui lui permettra d’avoir plus de clients puisque son bien sera « affiché en publicité » moins cher.
C’est ce qu’on appelle tout simplement « faire jouer la concurrence »
Le vendeur aura donc tout intérêt de prendre « un mandat simple » qui lui assurera ce genre de service et une liberté dans la vente de son bien.
Or, lorsqu’une une agence vous oblige à prendre uniquement d’autres agences qui afficheraient le bien en vente au même prix qu’elle (sans être supérieur), cette agence empêche toute concurrence de se faire et surtout vous prive des chances de trouver plus de clients.
Que ce soit en plafonnant le prix de vente (en publicité) ou en limitant le nombre d’agences , il s’agit d’une atteinte au «principe de la libre concurrence».
Ce type de clause restrictive de liberté s’apparente donc à une clause de mandat « exclusif » qui n’a rien à faire dans un mandat simple.
Les conseillers arrivent à persuader des propriétaires parce qu’ils ne lisent pas toutes clauses et surtout celles-ci. Soyez donc vigilant dans la lecture de vos mandats.
NOTRE CONSEIL : Refusez de signer ce type de mandat, ou si déjà fait, demandez à le convertir en mandat simple (sans ces clauses) !
A LIRE SUR LE MEME THEME LES ARTICLES SUIVANTS :
- Honoraires d’agence (Le service à ne pas négliger-DES ECONOMIES A LA CLE) Rubrique « Passer par un pro »
- Mandat de vente « exclusif » (LE PIEGE A EVITER)
Nous sommes convaincus que l’intervention d’un Agent immobilier est aujourd’hui plus que nécessaire afin de rassurer chacune des parties ( acheteur comme vendeur), compte tenu d’un environnement juridique de plus en plus complexe.
Et le mandat « simple » reste à nos yeux le contrat qui garantie au mieux les intérêts d’un propriétaire (voir notre article « Mandat de vente exclusif LE PIÈGE A EVITER » dans notre rubrique « Passez par un pro »)
Toutefois, certains professionnels ont trouvé le moyen de glisser dans leur mandat « simple » des clauses à notre sens « abusives » pour éviter toute concurrence.
En insérant ces clauses dans leur mandat, ces professionnels agissent uniquement dans leur propre intérêt et non dans l’intérêt des vendeurs.
Attention, il ne s’agit pas de faire le procès de tous les agents immobiliers, mais seulement de faire le tri entre les bons et les mauvais professionnels qui abuseraient de la situation.
Nous portons donc à votre connaissance des clauses que des propriétaires ont relevé dans leur mandat afin que vous puissiez les repérer avant toute signature de mandat de vente.
Rappelons avant tout les règles issues du mandat « simple » :
- Vous pouvez confier votre bien à n’importe quel professionnel (ce qui signifie : autant d'agences que vous souhaitez).
- Vous pouvez faire jouer la concurrence et prendre une agence qui pratique des honoraires réduits voire « forfaitaires » de façon à afficher un prix « en publicité » plus bas pour obtenir plus de clients.
- Vous pouvez vendre votre bien par vous-même.
En résumé, avec un mandat « simple » vous devez avoir LA LIBERTE de faire ce que vous voulez
Il ne peut donc y avoir dans votre mandat « simple » le type de clause suivante (que vous pouvez trouver dans le paragraphe « obligations du mandant » de chaque mandat)
1- Clause prévoyant : « Une obligation d’afficher le bien en vente à condition de prix égale ou supérieur. » et « une obligation de limiter le nombre d’intermédiaires professionnels »
L’objectif d’un vendeur est de trouver un acheteur par n’importe quel moyen et notamment en trouvant une agence moins chère « en honoraires » ce qui lui permettra d’avoir plus de clients puisque son bien sera « affiché en publicité » moins cher.
C’est ce qu’on appelle tout simplement « faire jouer la concurrence »
Le vendeur aura donc tout intérêt de prendre « un mandat simple » qui lui assurera ce genre de service et une liberté dans la vente de son bien.
Or, lorsqu’une une agence vous oblige à prendre uniquement d’autres agences qui afficheraient le bien en vente au même prix qu’elle (sans être supérieur), cette agence empêche toute concurrence de se faire et surtout vous prive des chances de trouver plus de clients.
Que ce soit en plafonnant le prix de vente (en publicité) ou en limitant le nombre d’agences , il s’agit d’une atteinte au «principe de la libre concurrence».
Ce type de clause restrictive de liberté s’apparente donc à une clause de mandat « exclusif » qui n’a rien à faire dans un mandat simple.
Les conseillers arrivent à persuader des propriétaires parce qu’ils ne lisent pas toutes clauses et surtout celles-ci. Soyez donc vigilant dans la lecture de vos mandats.
NOTRE CONSEIL : Refusez de signer ce type de mandat, ou si déjà fait, demandez à le convertir en mandat simple (sans ces clauses) !
A LIRE SUR LE MEME THEME LES ARTICLES SUIVANTS :
- Honoraires d’agence (Le service à ne pas négliger-DES ECONOMIES A LA CLE) Rubrique « Passer par un pro »
- Mandat de vente « exclusif » (LE PIEGE A EVITER)
1- Qu'est-ce que la mitoyenneté ?
La mitoyenneté est régie par les articles 653 à 673 du Code civil.
Un mur mitoyen, c'est un mur qui est commun entre les deux voisins, ils en sont copropriétaires. On parle de copropriété forcée parce que cet état d'indivision est en principe perpétuel.
Lorsque deux propriétaires voisins décident de construire à frais communs une clôture assise sur la limite séparative de leurs terrains, elle est mitoyenne. La mise en place de cette clôture, mitoyenne dès l'origine, résulte d'un accord amiable.
On peut aussi acquérir amiablement la mitoyenneté d'une clôture déjà réalisée sur son terrain. L'acquisition de la mitoyenneté constitue un transfert de propriété et nécessite un document d'arpentage ainsi qu'un acte notarié, rédigé par votre notaire. Elle a en effet pour conséquence de déplacer la ligne divisoire des propriétés car la moitié de la bande sur laquelle repose le mur appartient désormais privativement à chacun des voisins. L'acquéreur doit payer la moitié du coût du mur et la moitié de la valeur du sol sur lequel il est bâti.
Le régime de la mitoyenneté ne s'applique pas aux murs appartenant au domaine public. Seul un mur dépendant du domaine privé de la collectivité ou de l'état pourrait être mitoyen.
2- Comment la mitoyenneté est-elle ou n'est-elle pas établie ?
La hiérarchie des modes de preuve qui permettent d'établir la mitoyenneté est la suivante : - La prescription acquisitive : appuyer un bâtiment contre le mur de son voisin pendant trente ans, sans protestation de sa part, permet de revendiquer la mitoyenneté de la partie du mur utilisée. - Le titre : c'est l'acte notarié qui va préciser si la clôture est privative ou mitoyenne, mais si ce titre n'est pas commun aux deux voisins, il ne constitue qu'une présomption soumise à l'appréciation du juge. - Les marques de non-mitoyenneté du mur (art. 654 du Code Civil) : lorsque le sommet du mur a un plan incliné ou encore lorsque ce mur possède un filet ou des corbeaux d'un seul côté, il est présumé appartenir à un seul propriétaire, celui vers lequel se dirige le plan incliné du côté duquel se trouvent les corbeaux ou les filets. - Les marques de non-mitoyenneté des fossés (art. 666 du Code civil) : lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé. - Les présomptions de mitoyenneté du mur (art. 653 et 666 du Code Civil) : un mur est présumé mitoyen dès lors qu’il sert de séparation entre deux bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre une cour et un jardin ou entre enclos dans les champs. - Les présomptions de mitoyenneté d’une clôture ou d’un fossé (Art. 666 du Code civil) : toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne à moins qu’il n’y ait titre, prescription ou marque contraire et tout fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
3- Droits des copropriétaires mitoyens
Chacun des voisins peut appuyer des constructions contre le mur et y enfoncer des poutres, avec le consentement de l'autre propriétaire du mur ou, à défaut d'un expert. Chaque propriétaire peut aussi appuyer des plantations en espalier, à condition de ne pas dépasser la crête du mur.
Chacun peut louer à des fins publicitaires la face du mur qui se trouve du côté de son terrain sans en référer à son voisin et sans avoir à partager la redevance perçue. Aucune ouverture (portes, fenêtres) ne peut être pratiquée dans un mur mitoyen sans l'accord du voisin.
Tout copropriétaire peut surélever le mur mitoyen ou augmenter son épaisseur. Il en supporte alors seuls les frais car la partie exhaussée ou augmentée est sa propriété. Si le mur mitoyen n'est pas en mesure de supporter la surélévation, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais. (Art 658 C.civ)
4- Obligations des copropriétaires mitoyens
Les deux voisins doivent contribuer en commun aux charges d'entretien, de réparation ou de reconstruction du mur mitoyen.
Cette règle se trouve cependant écartée lorsque les travaux sont rendus nécessaires par le fait d'un seul des propriétaires : ainsi, le propriétaire qui démolit son immeuble doit effectuer les travaux d'imperméabilisation du mur mitoyen subsistant, désormais soumis sans protection aux intempéries.
Source : Notaires.fr

o Le notaire, votre unique interlocuteur
Vous pouvez confier à votre notaire l'ensemble de votre projet immobilier : de la signature de l'avant-contrat à l'acte définitif, des formalités administratives (déclarations préalables, purge des droits de préemption....), en passant par le calcul des différentes taxes et leur déclaration à l'administration.
De plus, votre notaire établira l'éventuelle déclaration de plus-value immobilière et versera l'impôt à l'Administration par prélèvement "à la source" sur le prix de vente.
o Le notaire, garant de la sécurité juridique
En France, toute vente immobilière passe par le notaire. Il veille, en tant qu'officier public, à la bonne exécution du contrat et lui confère, outre la confidentialité, la sécurité juridique nécessaire.
Il rassemble en amont les documents et évite ainsi au maximum toute contestation ultérieure. On chiffre à plus de cent les points juridiques et fiscaux auxquels le notaire prète une attention méticuleuse lors de la préparation d'un acte de vente.
Par exemple, le notaire peut :
- chercher et demander l'identité des parties au contrat, leur statut matrimonial.
- vérifier le titre de propriété du vendeur, la situation hypothécaire du bien, les servitudes conventionnelles et les règles d'urbanisme applicables
- purger les droits de préemption.
- vérifier que les diagnostics préalables à la vente, obligatoires, ont bien été faits avant la signature de l'avant contrat.
Par sa connaissance juridique accrue et par sa connaissance des éventuelles modifications législatives, il offre la meilleure garantie juridique au moment de l'avant-contrat (préalable à l'acte de vente).
Vous n'aurez donc pas de mauvaises surprises . Une fois l'acte signé, il fait l'objet d'une formalité importante à la publicition foncière .
Il s'agit de l'enregistrement au Service de publicité foncière, de la situation juridique du bien. Le but est de conserver la trace des droits de propriété existant sur l'immeuble, et des hypothèques qui les grèvent.
Les notaires, en tant qu'officiers publics, détiennent un monopole d'accès à ce fichier. Enfin, le notaire garantit la conservation du titre de propriété en le gardant durant 75 ans dans son étude. Passé ce délai, ils sont conservés aux archives nationales, et bientôt, sous forme électronique.
Les notaires apportent également un conseil juridique et fiscal dans les opérations de lotissement, de construction ou de rénovation.
Source : www.notaires.fr


L'achat d'un bien immobilier en nue-propriété permet de se constituer un patrimoine à moindre coût, d’en préparer la transmission en optimisant la fiscalité, où d'anticiper la baisse de ses revenus à la retraite
1- Différence entre nue-propriété , usufruit et pleine propriété
Définition nue-propriété : Droit d'un propriétaire de disposer d'un bien, sans pouvoir l'utiliser, ni en avoir la jouissance conférée à un usufruitier, ni en tirer un revenu locatif. Le nu-propriétaire peut vendre son droit de propriété, sans vendre la jouissance du bien
Définition usufruit : L'usufruit est le droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les revenus, sans en être propriétaire. L'usufruitier a des droits et obligations. Le droit à l'usufruit est temporaire.
La différence tient aux droits plus ou moins importants sur un bien. La pleine propriété est composée de l'usufruit et de la nue-propriété:
Les attributs du droit de propriété (occuper un bien, le vendre, en percevoir les revenus) peuvent être répartis entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. On parle dans ce cas de démembrement du droit de propriété.
|
Différences entre usufruit, nue-propriété, pleine propriété |
|||
|
Droits sur le bien |
Pleine propriété |
Nue-propriété |
Usufruit |
|
Disposer du bien (le vendre par exemple) |
Oui |
Oui |
Non |
|
Utiliser un bien (l'occuper par exemple) |
Oui |
Non |
Oui |
|
Percevoir des revenus issus de ce bien (des loyers par exemple) |
Oui |
Non |
Oui |
2- Le principe de l'achat en nue-propriété
Vous achetez la nue-propriété d'un bien immobilier (maison, appartement) dont l'usufruit est acquis le plus souvent par un bailleur social (plus rarement une société ou un particulier).
L’usufruitier percevra les fruits (les loyers) et assurera la gestion locative du bien durant toute la durée de l’investissement, en général de 15 à 20 ans.
3- Les avantages d'acheter en nue-propriété -
Un prix attractif : L'achat en nue-propriété vous permet de constituer un patrimoine immobilier à moindre coût, avec une décote sur le prix d'achat de l'ordre de 40 % par rapport au même bien acquis en pleine propriété. -
L'absence de charge pour le nu-propriétaire : L'usufruitier se charge de donner le bien en location et assure les réparations d'entretien de l’immeuble (parties privatives et communes). Attention, les grosses réparations sont à la charge du nu-propriétaire (article 605 et 606 du Code civil). -
La pleine propriété sans frais et sans fiscalité à la sortie : Au terme de la période de démembrement, vous retrouvez la pleine propriété du bien, sans avoir un euro de plus à débourser. -
Défiscaliser ses revenus fonciers : Pendant toute la période du démembrement, l'opération n'a aucune incidence en termes d'impôt sur le revenu dans la mesure où vous n'encaissez pas les loyers du logement donné en location. En cas d’acquisition à crédit, les intérêts d’emprunt sont déductibles des autres revenus fonciers à condition que l’usufruitier soit un bailleur social ou un bailleur imposable à l’impôt sur le revenu. -
Réduire sa base ISF : L'usufruitier doit déclarer le bien dans son patrimoine imposable, à condition qu'il soit assujetti à l'ISF. Il est alors redevable de l'ISF sur la pleine propriété du bien. Pendant toute la période du démembrement, le nu-propriétaire n'a pas a en tenir compte pour évaluer son patrimoine imposable à l'ISF. En revanche, les dettes afférentes à la nue-propriété ne peuvent plus être déduites de l’actif taxable à l’ISF depuis la loi de finances rectificative pour 2013 (article 885 G quater CGI) -
Transmettre à moindre coût fiscal : Si vous souhaitez transmettre le bien à vos héritiers, dans la mesure où seule la nue-propriété leur sera transmise, les droits de donation seront calculés uniquement sur la valeur de cette dernière.
Source : www.notaires.fr

Pour le candidat acquéreur, l'offre d'achat est un moyen de réserver un bien à des conditions qu'il fixe lui-même. Il s'engage à acheter le bien en cas d'acceptation du vendeur. L'acquéreur doit avoir la capacité juridiquede signer un contrat, car l'offre d'achat est destinée à aboutir à la signature d'un acte de vente.
L'offre doit être écrite et contenir les éléments suivants : - Désignation du bien - Date de l'offre - Prix fixé par l'acquéreur - Durée de validité de l'offre de 1 ou 2 semaine(s)
Le délai de réflexion ou de rétractation ne s'applique pas pour une offre d'achat acceptée.
Attention
Le candidat acquéreur qui fait une offre d'achat ne doit verser aucune somme d'argent au vendeur.
Pendant le délai de validité de l'offre, le vendeur a plusieurs possibilités : - Il peut accepter les conditions de l'offre du candidat acquéreur - Il peut refuser l'offre si le prix proposé par le candidat acquéreur est inférieur à celui initialement fixé - Il peut faire une contre-proposition écrite, c'est-à-dire une nouvelle offre qui rend l'offre initiale caduque
Si le vendeur accepte les conditions de l'offre, le candidat acquéreur et le vendeur sont engagés. Une promesse de vente ou, sinon, un acte de vente est alors signé.
Source : Servicepublic.fr

Pour le candidat acquéreur, l'offre d'achat est un moyen de réserver un bien à des conditions qu'il fixe lui-même. Il s'engage à acheter le bien en cas d'acceptation du vendeur. L'acquéreur doit avoir la capacité juridiquede signer un contrat, car l'offre d'achat est destinée à aboutir à la signature d'un acte de vente.
L'offre doit être écrite et contenir les éléments suivants : - Désignation du bien - Date de l'offre - Prix fixé par l'acquéreur - Durée de validité de l'offre de 1 ou 2 semaine(s)
Le délai de réflexion ou de rétractation ne s'applique pas pour une offre d'achat acceptée.
Attention
Le candidat acquéreur qui fait une offre d'achat ne doit verser aucune somme d'argent au vendeur.
Pendant le délai de validité de l'offre, le vendeur a plusieurs possibilités : - Il peut accepter les conditions de l'offre du candidat acquéreur - Il peut refuser l'offre si le prix proposé par le candidat acquéreur est inférieur à celui initialement fixé - Il peut faire une contre-proposition écrite, c'est-à-dire une nouvelle offre qui rend l'offre initiale caduque
Si le vendeur accepte les conditions de l'offre, le candidat acquéreur et le vendeur sont engagés. Une promesse de vente ou, sinon, un acte de vente est alors signé.
Source : Servicepublic.fr

Le permis de construire est une autorisation d'urbanisme délivrée par la mairie de la commune où se situe le projet. Il concerne les constructions nouvelles (telles que la construction d'une maison), même sans fondation, de plus de 20 m² de surface de plancher où d'emprise au sol. Des travaux d'extension et certains changements de destination des locaux sont également soumis à la procédure de demande de permis de construire.
La loi du 23 novembre 2018 dite loi ELAN prévoit que toutes les communes de plus de 3500 habitants devront à partir du 1 janvier 2022 avoir des procédures dématérialisées pour recevoir et instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme et certificat d'urbanisme.
Le permis de construire est une autorisation obligatoire d'urbanisme.
Le permis de construire permet notamment d'édifier toute construction nouvelle qui n’est pas dispensée de formalité ou qui n’est pas soumise à déclaration préalable (telle qu’une maison individuelle, la construction d’une piscine, de certains bâtiments indépendants de la maison, etc.) mais aussi d’entreprendre des travaux d’agrandissement d’une maison pour une surface supérieure à 20 m2 ou encore des travaux portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques.
De nombreuses règles d’urbanisme sont à respecter. Par exemple, une maison destinée à être louée ou vendue doit respecter les règles d’accessibilité. Par contre, si la construction de la maison individuelle a pour but votre usage à titre d’habitation, vous n’avez pas à respecter cette réglementation. N’hésitez pas à consulter un architecte pour connaître la faisabilité d’un projet.
A noter : Le recours à un architecte est obligatoire pour un projet de construction si la superficie du plancher dépasse 150 m2. Le recours à un architecte est également nécessaire pour tous les projets d’agrandissement soumis à permis de construire pour une surface de plancher ou d’emprise au sol de la construction existante de plus de 150 m2.
Exception : A noter que lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU ou par un POS, un permis de construire est nécessaire seulement si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m2 ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de construction au-delà de 150 m2.
La demande de permis de construire doit être effectuée à l’aide : - Du cerfa n°13406*07 pour une maison individuelle, - D’un téléservice.
La demande de permis de construire adressée à la mairie par le propriétaire du terrain doit comprendre certains documents : - Le formulaire cerfa, - La déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, - Le bordereau des pièces jointes, - Le plan de situation, - Le plan de masse, - Le plan de couple du terrain, - La notice, - Le plan des façades et des toitures, - Le document graphique, - Des photos pour situer le terrain dans son environnement proche et lointain.
En France métropolitaine, la demande de permis de construire doit également comporter une attestation de prise en compte de la réglementation thermique.
La mairie délivre un récépissé à la réception de votre demande de permis. En cas de dossier incomplet, la mairie a un mois pour vous réclamer les pièces manquantes.
Le délai d’instruction du dossier de demande de permis pour une maison et ses annexes est de 2 mois. La mairie dispose de 3 mois pour les autres projets.
Le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune ou au nom de l’Etat selon qu’existe ou non un plan local d’urbanisme.
La décision d'acceptation ou de refus de la demande de permis de la mairie prend la forme d’un arrêté. Il est possible de demander à la mairie de revoir sa position dans les 2 mois suivant le refus.
La durée de validité du permis est de 3 ans. Il est périmé si les travaux n’ont pas commencé dans les 3 ans ou si, passé ce délai, les travaux sont interrompus plus d’un an. Ce délai de trois ans peut toutefois faire l’objet d’une prorogation. La durée de validité initiale peut ainsi être prorogée deux fois pour une durée d’un an. La demande de prorogation doit être adressée à la mairie 2 mois avant l’expiration du permis.
Dans de nombreux cas, le silence de l’administration pendant un certain délai permettra l’obtention d’un permis tacite, c’est-à-dire sans que le maire n’ait à délivrer un arrêté.
Cependant, l’absence de réponse peut aussi signifier un refus implicite. C’est le cas pour un projet soumis à l’accord de l’architecte des bâtiments de France lorsqu’il a émis un avis défavorable ou favorable avec des prescriptions.
Le permis de construire est accordé si les travaux du projet de construction sont conformes aux règles d’urbanisme de la mairie. L’affichage du permis de construire sur le terrain est obligatoire. L’affichage doit être visible de la rue pendant toute la durée du chantier et comporter des mentions relatives obligatoires permettant d’apprécier la situation : - Le nom du bénéficiaire du permis (la raison sociale ou dénomination sociale pour une entreprise), - Le nom de l’architecte auteur du projet, - La date de délivrance du permis et son numéro, - La nature du projet et la superficie du terrain, - L’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté, - Les mentions légales des voies de recours.
Selon la situation du terrain (lotissement, etc.), d’autres éléments peuvent être à indiquer. Également, dans les huit jours de sa délivrance expresse ou tacite, un extrait du permis est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L’absence d’affichage ne rend pas l’autorisation illégale, mais permet un recours contentieux pendant la durée des travaux et jusqu’à 6 mois après leur achèvement.
Les tiers peuvent consulter le dossier en mairie et le contester à l’aide d’un recours gracieux.
Une fois les travaux autorisés par le permis réalisés sur le terrain d’assiette, le titulaire de ce permis doit déposer une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, l’administration disposant d’un délai de trois mois pour contrôler lesdits travaux (ce délai peut être porté à 5 mois dans certains secteurs ou pour certains immeubles).
Le permis de construire n’étant, sauf exception, pas délivré en fonction de la personne qui le demande mais des caractéristiques du terrain, il peut faire l’objet d’un transfert. En revanche, un permis délivré à un exploitant agricole pour les nécessités de son exploitation, et donc accordé en considération de la personne du bénéficiaire, ne peut être transféré qu'à un autre exploitant.
Les conséquences d’un défaut de permis de construire ou d’une irrégularité sont d’une telle gravité (pouvant aller jusqu’à l’obligation de destruction d’un immeuble), que le rôle du notaire lors de la signature d’un acte est fondamental. En effet, c’est lui seul, sous sa responsabilité, qui aura la charge et l’obligation de vérifier non seulement l’existence du permis de construire mais également sa validité au moins sur le plan formel. Il questionnera le vendeur et lui demandera toutes les pièces qu’il vérifiera pour s’en assurer. A la moindre anomalie, il informera les parties et les invitera à faire les régularisations.
Source : Notaires.fr
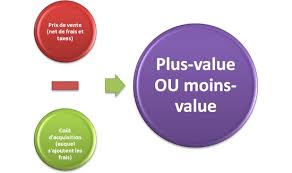
La plus-value que vous réalisez en vendant un bien immobilier est imposable, sauf s'il s'agit de votre résidence principale. Vous pouvez bénéficier d'exonérations selon les caractéristiques du bien ou votre situation personnelle.
1- QU’EST-CE QU’UNE PLUS- VALUE IMMOBILIERE ?
Lorsque vous vendez un bien immobilier dont vous êtes propriétaire, vous devez calculer la différence entre les prix suivants : - Prix de vente du bien - Prix d'acquisition du bien
Si le résultat de ce calcul est positif (vous vendez plus cher que vous n'avez acheté), vous réalisez un gain appelé plus-value.
Si le résultat est négatif, vous réalisez une perte appelée moins-value.
Exemple :
Vous avez acheté un logement au prix de 100 000 €.
Si vous le revendez au prix de 120 000 €, vous réalisez une plus-value de 20 000 €
(120 000 € - 100 000 €).
Si vous revendez le logement au prix de 90 000 €, vous réalisez une moins-value de
10 000 € (90 0000 € - 100 000 €).
Les plus-values immobilières sont soumises aux taxations suivantes : - Impôt sur le revenu - Prélèvements sociaux au taux de 17,20 %.
2- QUELLES SONT LES VENTES CONCERNEES ?
Vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu pour les plus-values immobilières réalisées dans le cadre de la gestion de votre patrimoine immobilier privé.
Vous êtes concerné dans les cas suivants : - Vente d'un bien immobilier (appartement, maison, terrain) - Vente des droits attachés à un bien immobilier (servitudes: Charge imposée à une propriété au profit d'une autre propriété (par exemple, un droit de passage) par exemple) - Vente par l'intermédiaire d'une société civile immobilière (non soumise à l'impôt sur les sociétés) ou d'un fonds de placement dans l'immobilier (FPI) - Échange de biens, partage ou apport en société
3- QUELLES SONT LES PLUS-VALUES EXONEREES ?
Les principales exonérations d'impôt sur les plus-values immobilières sont liées aux éléments suivants : - Caractéristiques du bien cédé - Situation du vendeur - Situation de l'acquéreur
La plupart des exonérations sont accordées sous conditions.
A- Exonérations liées au bien cédé
Vous êtes exonéré si vous réalisez une plus-value sur la vente de votre résidence principale et de ses dépendances (cave, garage, place de stationnement, cour, etc.)
Vous êtes aussi exonéré en cas de vente d'un logement autre que la résidence principale si vous respectez les 2 conditions suivantes : - Vous utilisez le prix de la vente pour acheter ou construire votre habitation principale dans un délai de 2 ans - Vous n'avez pas été propriétaire de votre résidence principale dans les 4 années précédant la vente.
Vous êtes exonéré d'impôt sur le revenu pour tout bien détenu depuis plus de 22 ans.
À noter : Un bien détenu depuis plus de 30 ans est aussi exonéré de prélèvements sociaux.
Vous êtes également exonéré dans les cas suivants : - Bien dont le prix de vente ne dépasse pas 15 000 € - Vente d'un droit de surélévation: Droit d’édifier une construction prolongeant verticalement les façades d’un immeuble préexistant tout en rehaussant le faîtage du toit. jusqu'au 31 décembre 2022 - Bien échangé dans le cadre de certaines opérations de remembrement
B- Exonérations liées au vendeur
Vous pouvez bénéficier d'une exonération si vous êtes dans l'une des situations suivantes :
Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement
Choisissez votre cas : - Vous touchez une pension de vieillesse - Vous avez une carte mobilité inclusion (CMI) - Vous résidez dans un établissement d'accueil de personnes âgées - Vous résidez dans un établissement d'accueil d'adultes handicapés - Vous êtes non-résident en France
C- Exonérations liées à l'acheteur
Vous êtes exonéré dans les cas suivants : - Bien vendu directement ou indirectement à un organisme en charge du logement social (jusqu'au 31 décembre 2022) - Bien vendu à un opérateur privé qui s'engage à réaliser ou achever des logements sociaux (jusqu'au 31 décembre 2022) - Bien exproprié sous condition du remploi de l'intégralité de l'indemnité pour l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de 12 mois - Bien cédé par un particulier ayant exercé son droit de délaissement: Droit du propriétaire d'un terrain concerné par une opération ou un projet d'urbanisme d'obliger la collectivité publique à acquérir le bien. dans certaines conditions, sous réserve du remploi de l'intégralité du prix de cession pour l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de 12 mois
4- COMMENT CALCULER LA PLUS-VALUE ?
Vous devez calculer la différence entre les montants suivants : - Prix de vente du bien - Prix d'acquisition du bien
Si vous réalisez une moins-value, c'est-à-dire une perte, vous pouvez la déduire d'une plus-value réalisée lors de la vente d'un autre bien uniquement de façon exceptionnelle.
Par exemple : vente en bloc d'un immeuble acquis par fractions successives.
A- Prix de vente
Le prix de vente est le prix indiqué dans l'acte.
Vous pouvez déduire du prix, sur justificatifs, les frais payés lors de la vente (par exemple, les frais liés aux diagnostics obligatoires).
Le prix de vente doit être augmenté des sommes versées à votre profit (par exemple, une indemnité d'éviction versée par l'acheteur au locataire en place).
B- Prix d'acquisition
Les règles diffèrent selon que le bien a été acheté ou reçu gratuitement :
a- Bien immobilier acheté
Si vous avez acheté le bien, le prix d'acquisition est indiqué dans l'acte de vente.
Ce prix peut être augmenté, sur justificatifs, des frais suivants : - Charges et indemnités versées au vendeur à l'achat - Frais d'acquisition (droits d'enregistrement, frais de notaire) pour leur montant réel justifié ou pour un montant forfaitaire de 7,5 % du prix d'achat - Dépenses de travaux (construction, reconstruction, agrandissement, amélioration sous conditions) pour leur montant réel justifié ou pour un forfait de 15 % du prix d'achat, si le bien est détenu depuis plus de 5 an - Frais de voirie, réseaux et distributions (frais d'aménagement pour lotissement par exemple)
b- Bien immobilier reçu gratuitement
Si vous avez reçu le bien par donation ou succession, le prix d'acquisition correspond à la valeur retenue pour le calcul des droits de donation ou de succession.
5- QUEL EST L’IMPÔT A PAYER SUR LA PLUS-VALUE ?
A- Abattement
La plus-value est diminuée d'un abattement qui dépend du temps pendant lequel vous avez possédé le bien.
L'assiette est différente pour le calcul de l'impôt sur le revenu et pour celui des prélèvements sociaux.
|
Taux d'abattement pour la vente d'un bien immobilier |
||
|
Durée de détention |
Taux d'abattement par année de détention |
|
|
Assiette pour l'impôt sur le revenu |
Assiette pour les prélèvements sociaux |
|
|
Jusqu'à 5 années |
0 % |
0 % |
|
De la 6e à la 21e année |
6 % |
1,65 % |
|
22e année révolue |
4 % |
1,6 % |
|
Au delà de la 22e année |
Exonération |
9 % |
|
Au delà de la 30e année |
Exonération |
Exonération |
Exemple :
Vous avez revendu un bien que vous possédiez depuis 10 ans. Vous avez réalisé avec cette vente une plus-value de 10 000 €. - Vous bénéficiez d'un abattement sur l'impôt de 6 % par an de la 6e à la 10e année, soit 30 % (6 % x 5). Vous avez ainsi un abattement de 10 000 € x 30 %, soit 3 000 €. Vous déclarerez donc un revenu de 7 000 € (10 000 € - 3 000 €). - Vous bénéficiez d'un abattement sur les prélèvements sociaux de 1,65 % par an de la 6e à la 10e année, soit 8,25 % (1,65 % x 5) . Vous avez ainsi un abattement de 10 000 € x 8,25 %, soit 825 €. Vous devrez payer les prélèvements sociaux sur la base de 9 175 € (10 000 € - 825 €).
Exemple :
Vous avez revendu un bien que vous possédiez depuis 25 ans. Vous avez réalisé une plus-value de 10 000 €.
Votre plus-value est exonérée d'impôt sur le revenu.
Vous bénéficiez d'un abattement sur les prélèvements sociaux de : - 1,65 % par an de la 6e à la 21e année, soit 26,4 % (1,65 % x 16) - 1,6 % pour la 22e année - 9 % de la 23e à la 25e année, soit 27 % (9 % x 3)
Soit un abattement total de 55 %(26,4 % + 1,6 % + 27 %).
Vous avez ainsi un abattement de 10 000 € x 55 %, soit 5 500 €.
Vous devrez payer les prélèvements sociaux sur la base de 4 500 € (10 000 € - 5 500 €).
Exemple :
Vous avez revendu un bien que vous possédiez depuis 30 ans. Vous avez réalisé avec cette vente une plus-value de 10 000 €.
Votre plus-value est exonérée d'impôt sur le revenu.
Elle est aussi exonérée de prélèvements sociaux.
B- Abattement exceptionnel
Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement
Choisissez votre cas : - Abattement lié à des opérations d'urbanisme ou de revitalisation du territoire - Abattement exceptionnel en zone tendue
C- Taux d'imposition
La plus-value immobilière est imposée à l'impôt sur le revenu au taux de 19 %.
Exemple :
Pour une plus-value imposable de 20 000 €, l'impôt sur le revenu est de 3 800 €
(20 000 € x 19 %).
Une taxe supplémentaire s'applique en cas de plus-value imposable supérieure à 50 000 €.
Le taux varie de 2 % à 6 % selon le montant de la plus-value réalisée.
Le formulaire n°2048-IMM-SD contient un tableau permettant d'en établir le montant (en pratique, il est calculé par le notaire).
La taxe ne concerne ni les ventes exonérées, ni les ventes de terrains à bâtir.
6- COMMENT DECLARER LA PLUS-VALUE ?
A- Formalités effectuées par le notaire
Le notaire chargé de la vente effectue les opérations suivantes : - Démarches auprès de l'administration fiscale - Calcul de la plus-value imposable et du montant de l'impôt à payer - Établissement de la déclaration - Paiement de l'impôt sur la plus-value immobilière auprès des services de la publicité foncière du lieu du bien
B- Indication de la plus-value sur votre déclaration de revenus
Vous devez indiquer sur votre déclaration de revenus les informations suivantes : - Montant de la plus-value déclarée par le notaire - Si nécessaire, plus-value exonérée en cas de 1re cession d'un logement autre que votre résidence principale
La déclaration des revenus par internet est obligatoire si votre résidence principale est équipée d'un accès à internet et que vous êtes en mesure de faire votre déclaration en ligne.
La période de déclaration 2022 des revenus est terminée.
La déclaration 2023 des revenus de l'année 2022 aura lieu en avril 2023.
Si vous devez faire une déclaration papier
Sources : Service public

Lorsque le vendeur et l'acheteur sont parvenus à un accord sur la vente d'un bien immobilier, ils peuvent signer une promesse de vente avant la signature de l'acte de vente définitif. Ce document n'est pas obligatoire, mais il est recommandé pour exprimer l'accord mutuel du vendeur et de l'acheteur. Il détermine les conditions précises dans lesquelles la vente du logement s'effectuera
La promesse de vente pour l'achat d'un logement existant peut prendre la forme
- soit d'une promesse unilatérale de vente,
- soit d'un compromis de vente (également appelé promesse synallagmatique de vente).
1- Définition d’un compromis de vente
Un compromis de vente peut être signé lorsque le vendeur et l'acheteur sont sûrs de vouloir conclure la vente du logement. Cet acte engage définitivement le vendeur et l'acheteur sauf s'il comporte une clause prévoyant, sous certaines conditions, un désistement de l'une ou des 2 parties.
Le compromis peut être réalisé sous 2 formes :
- Acte sous signature privée réalisé directement par le vendeur et l'acheteur ou avec l'appui d'un agent immobilier par exemple
- Acte authentique établi par un notaire (obligatoire lorsque le vendeur est une personne physique et que la durée de validité du compromis dépasse 18 mois)
2- Définition d’une promesse unilatérale de vente
Une promesse unilatérale peut être signée lorsque l'acheteur n'est pas sûr de vouloir conclure la vente. Cet acte lui laisse la liberté de lever l'option ou non (c'est-à-dire d'acheter ou non le logement). Il réserve ainsi le logement pendant un délai clairement précisé. Le vendeur s'engage à ne pas vendre le logement à un autre acheteur.
La promesse unilatérale de vente peut être réalisée sous 2 formes :
- Acte sous signature privée réalisé directement par le vendeur et l'acheteur ou avec l'appui d'un agent immobilier par exemple
- Acte authentique établi par un notaire (obligatoire lorsque le vendeur est une personne physique et que la durée de validité de la promesse dépasse 18 mois)
À compter de sa signature, une promesse unilatérale sous signature privée doit être enregistrée dans les 10 jours au service de l'enregistrement du vendeur ou de l'acheteur. Cet enregistrement sert à authentifier la promesse de vente.
Le vendeur et/ou l'acheteur peuvent soit déposer la promesse directement au service de l'enregistrement, soit l'envoyer par courrier simple ou recommandé.
3- Contenu d’une promesse ou compromis
A- Informations concernant les partiesLa promesse de vente doit mentionner les coordonnées du vendeur et de l'acheteur.
B- Informations concernant le bienLa promesse de vente doit mentionner les informations suivantes :
- Adresse du bien
- Origine du bien (date du précédent acte de vente, nom du précédent propriétaire, acte notarié...)
- Descriptif détaillé du bien, de ses équipements et de ses annexes
- Existence d'une hypothèque et/ou d'une servitude
- La promesse de vente d'un logement en copropriété doit par ailleurs contenir les informations spécifiques à la copropriété.
C- Informations concernant la venteLa promesse de vente doit mentionner les informations suivantes :
- Montant des honoraires du professionnel chargé de la vente (s'il y a intervention d'un professionnel) et à qui en incombe le paiement
- Prix de vente et modalités de paiement (avec ou sans l'aide d'un prêt immobilier)
- Durée de validité de la promesse de vente et date limite de signature de l'acte de vente définitif
- Informations relatives aux conditions d'exercice du droit de rétractation : le manquement à cette obligation d'information est passible d'une amende d'un montant maximum de 15 000 €
- Date de disponibilité du bien
À savoir
Des clauses suspensives peuvent être inscrites dans la promesse de vente. Ainsi la vente ne pourra se réaliser que sous certaines conditions. Par exemple, il peut s'agir de l'obtention d'un certificat d'urbanisme opérationnel ou d'un permis de construire, de l'obtention d'un prêt immobilier ou encore de travaux à réaliser par le vendeur avant la vente.
La promesse de vente doit être accompagnée du dossier de diagnostic technique (DDT).
4- Notification d’une promesse
La promesse de vente peut être remise en main propre ou envoyée à l'acheteur par lettre recommandée avec avis de réception.
Elle doit être réalisée en 2 exemplaires originaux (1 pour le vendeur, 1 pour l'acheteur), excepté dans le cas où un original unique est conservé par un professionnel (notaire, agent immobilier).
5- Sommes à payer
De nombreux mécanismes d'indemnisation ou de contrainte, plus ou moins différenciés, peuvent être prévus dans une promesse de vente. Par exemple, il peut s'agir de l'astreinte (versement d'une indemnité par jour de retard, notamment dans le cas où le vendeur ne délivre pas le logement à la date prévue), ou du séquestre qui est un acompte sur le prix total.
Certains de ces mécanismes sont couramment utilisés et diffèrent suivant la forme de la promesse de vente.
- Dans un compromis de vente
Des clauses inscrites dans le compromis de vente peuvent prévoir le versement de sommes d'argent dès sa signature ou sous un délai déterminé.
Cependant, avant la fin du délai de rétractation, une demande de versement est autorisée si 2 conditions sont remplies. Le compromis doit être conclu par l'intermédiaire d'un professionnel mandaté pour contribuer à la vente (un notaire ou un agent immobilier par exemple). Aussi, le versement doit être consigné chez un professionnel ayant une garantie financière dédiée au remboursement des fonds déposés (recommandé même en l'absence de demande de versement avant la fin du délai de rétractation).
Sinon, le fait d'exiger, de recevoir un versement ou un engagement de versement avant la fin du délai de rétractation est puni d'une amende de 30 000 €.
À noter
Si l'acheteur exerce son droit de rétractation, le professionnel doit lui restituer les sommes versées sous 21 jours à compter du lendemain de la rétractation.
Le montant demandé à l'acheteur se situe en général entre 5 % et 10 % du prix de vente. Il est recommandé de le consigner chez un professionnel ayant une garantie financière dédiée au remboursement des fonds déposés. Il peut s'agir d'un agent immobilier ou d'un notaire. Sauf pour un versement pendant le délai de rétractation, ce n'est pas une obligation, mais cette consignation offre une meilleure garantie de restitution des fonds si nécessaire. À la signature de l'acte définitif, ce montant sera déduit du prix total de la vente quelle que soit la clause du compromis à l'origine du versement.
- Dans une promesse unilatérale de vente
Des clauses inscrites dans une promesse unilatérale de vente peuvent prévoir le versement de sommes d'argent dès sa signature ou sous un délai déterminé.
Cependant, avant la fin du délai de rétractation, une demande de versement est autorisée si 2 conditions sont remplies. La promesse doit être conclue par l'intermédiaire d'un professionnel mandaté pour contribuer à la vente (un notaire ou un agent immobilier par exemple). Aussi, le versement doit être consigné chez un professionnel ayant une garantie financière dédiée au remboursement des fonds déposés (recommandé même en l'absence de demande de versement avant la fin du délai de rétractation).
Sinon le fait d'exiger, de recevoir un versement ou un engagement de versement avant la fin du délai de rétractation est puni d'une amende de 30 000 €.
À noter
Si l'acheteur exerce son droit de rétractation, le professionnel doit lui restituer les sommes versées sous 21 jours à compter du lendemain de la rétractation.
Le montant demandé à l'acheteur se situe en général entre 5 % et 10 % du prix de vente. Il est recommandé de le consigner chez un professionnel ayant une garantie financière dédiée au remboursement des fonds déposés. Il peut s'agir d'un agent immobilier ou d'un notaire. Sauf pour un versement pendant le délai de rétractation, ce n'est pas une obligation, mais cette consignation offre une meilleure garantie de restitution des fonds si nécessaire. À la signature de l'acte définitif, ce montant sera déduit du prix total de la vente quelle que soit la clause de la promesse à l'origine du versement.
6- Rétractation
Le droit de rétractation permet à l'acheteur de réfléchir et renoncer à la vente en respectant un certain délai après la signature de la promesse.
Le vendeur est quant à lui engagé dès la signature de la promesse de vente. S'il conteste la vente, l'acheteur peut en demander l'exécution forcée devant le tribunal c'est-à-dire qu'il peut obliger le vendeur à lui délivrer le logement.
L'acheteur dispose de 10 jours calendaires: Correspond à la totalité des jours du calendrier de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre, y compris les jours fériés ou chômés pour renoncer à la vente.
Ce délai commence le lendemain de la 1re présentation de la lettre recommandée notifiant la promesse de vente ou de sa remise en main propre.
Si le dernier jour du délai de réflexion est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'au 1erjour ouvrable suivant.
L'acheteur doit notifier sa rétractation au vendeur par lettre recommandée avec avis de réception avant l'expiration du délai de 10 jours calendaires
Sources : Services public.fr

Elle permet aux membres d'une même famille d'être propriétaire dans des proportions différentes ou pas, et de gérer ensemble un ou plusieurs biens immobiliers et ce, dans un but non commercial.
La SCI permet d'écarter l'application des règles de l'indivision et d'optimiser fiscalement la transmission de son patrimoine à ses héritiers.
La création d'une SCI est une décision qui ne doit pas être prise à la légère car elle peut présenter des avantages comme des inconvénients selon les situations
Une SCI est une société dans laquelle les membres d’une même famille apportent une quote-part d’un immeuble qu’ils possèdent et c’est alors la société qui en devient le propriétaire, chaque apporteur récupérant en contrepartie des parts sociales correspondant à son apport. L’apport peut également être en numéraire, c’est-à-dire, une somme d’argent. Dans ce cas, c’est la SCI qui achète le bien immobilier avec ces apports La SCI réunit des membres d’une même famille et alliés jusqu’au 4e degré, notamment enfant, parent, petit-enfant, frère/sœur, arrière grand-parent, oncle/tante, neveu/nièce, cousin germain. La SCI familiale, comme toute SCI, est réglementée par les dispositions communes à toutes les sociétés, des articles 1832 et suivants du Code civil, ainsi que par les dispositions communes à toutes les sociétés civiles, fixées par les articles 1845 et suivants du même code. Néanmoins, elle présente quelques caractéristiques spécifiques en raison des liens de parenté ou d’alliance entre les associés. Par exemple, elle échappe à la qualification de bailleur professionnel lorsqu’elle met un bien en location à des tiers ou aux associés de la SCI. Elle demeure un bailleur particulier qui peut conclure un bail d’une durée minimum de 3 ans et non de 6 ans. Cela constitue d’ailleurs la principale règle spécifique. En revanche, elle perd son caractère familial dès l’entrée dans la SCI d’un associé qui n’a pas de lien de famille ou d’alliance avec les autres.
Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d’un même bien, qu’elles l’aient choisi (en cas d’acquisition en commun par des époux séparés de biens, par exemple) ou non (en cas de succession), c’est le régime légal de l’indivision qui s’applique. Dans le cadre d'une indivision, seuls les actes conservatoires peuvent être faits à l'initiative d'un seul coïndivisaire. Pour les actes d'administration, (conclusion des baux ou réalisation de travaux d'amélioration), l'accord du ou des coïndivisaires représentant au moins les deux tiers des droits indivis est nécessaire (art. 815-3, al.1 C. civ.). Les actes de disposition (acquisition, vente d'immeuble, emprunt...) restent soumis à l'accord de tous les indivisaires (art. 815-3, al. 7 C. civ.). Cela peut générer des situations de blocage en raison du veto ou du silence d’un indivisaire. Il faut alors recourir au juge pour passer outre ( art. 815-4 à 815-6 C. civ.).
Dans une société, seules les décisions les plus graves sont en principe soumises à l'unanimité. Bien souvent, les statuts prévoient que la plupart des décisions sont prises à la majorité des associés telle qu’elle est fixée par les statuts, ce qui permet de passer outre le désaccord des minoritaires.
Pour éviter les blocages, les indivisaires peuvent à la majorité des deux tiers donner un mandat général d’administration, ou par convention et à l’unanimité nommer un gérant et lui donner certains pouvoirs. Mais ces pouvoirs sont strictement limités et la convention d’indivision à durée déterminée a une durée maximale de 5 ans (renouvelable). Dans le cadre de la SCI, un ou plusieurs gérants sont désignés et disposent souvent (par les statuts ou un acte annexe) de très larges pouvoirs : il peut en principe accomplir tous les actes de gestion réalisés dans l’intérêt de la société. La SCI permet également de distinguer la propriété des parts et leur gestion. Ainsi, des parents qui souhaitent transmettre des biens à leurs enfants tout en conservant la gestion de leur patrimoine, peuvent le faire par la création d’une SCI. Ils donnent alors les parts et se font désigner gérants. De même, les parents peuvent ne donner que la nue-propriété des parts à leurs enfants, tout en en conservant l’usufruit et donc les revenus produits par les biens. Ils veilleront dans les statuts à organiser la répartition des pouvoirs entre nus- propriétaires et usufruitiers.
De plus, elle garantit la pérennité du patrimoine sur plusieurs générations. La SCI, dotée d'une personnalité distincte de ses membres, est instituée pour une durée pouvant aller jusqu'à 99 ans (C. civ., art. 1835 et 1838). Un associé majoritaire ne peut pas imposer aux autres la dissolution anticipée de la SCI. La dissolution judiciaire peut être demandée mais seulement pour justes motifs (inexécution par un associé de ses obligations par exemple). La SCI exclut la vente forcée du bien. L’indivision est au contraire précaire : la loi prévoit que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision. Le partage peut donc toujours être demandé, au besoin par voie judiciaire (art. 815 C. civ.).
L’indivision n’est pas toujours souhaitée (lors d’une succession par exemple). Et lorsqu’un indivisaire décède, ses parts sont transmises à ses héritiers sans possibilité pour les coindivisaires de s’y opposer. Cela peut générer des conflits notamment en multipliant le nombre d’indivisaires. La SCI permet de choisir les personnes avec qui l’ont s’associe et ce, même en cas de décès ou de retrait de l’un des associés. En principe, la cession de parts sociales d’une SCI à un tiers nécessite l’agrément unanime des autres associés (sauf majorité statutaire différente ou accord des gérants si les statuts l'exigent).
Bon à savoir : sauf dispositions contraires des statuts, les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant ne sont pas soumises à agrément. Elle permet d’optimiser la transmission des parts sociales
Les donations de parts sont soumises aux abattements classiques (exemples : 100.000 par parent et par enfant, ou 31.865 euros pour les petits-enfants, renouvelables tous les 15 ans). Donner des parts de société plutôt que des biens immobiliers permet d’ajuster au mieux la valeur transmise et de ne pas dépasser les abattements. Les parents peuvent aussi se réserver l’usufruit des parts, l’assiette fiscale ne sera constituée que de la valeur de la nue-propriété. Au-décès des usufruitiers, les nus-propriétaires deviennent pleinement propriétaires des parts sans avoir de droits de succession à régler. De plus, si la SCI a souscrit un prêt pour financer l’acquisition d’un bien immobilier, la valeur des parts transmises tient compte de ce passif. Enfin, la valeur des parts peut bénéficier d’une décote. La valeur vénale des parts est en effet toujours inférieure à la valeur vénale de l’immeuble ramenée au nombre de parts. Cette décote joue pour les droits de donation et pour les droits de succession.
Des concubins peuvent y recourir pour sécuriser leur situation en cas de décès. Pour cela, ils peuvent effectuer un démembrement de propriété croisé des parts sociales. Chacun possède l’usufruit des parts de l’autre. Ainsi, au décès du premier d’entre eux, l’usufruit sur les parts du survivant s’éteint. Le survivant est donc pleinement propriétaire de la moitié des parts et conserve l’usufruit (la jouissance) des parts du défunt. Suite à l’extinction de l’usufruit, le survivant ne sera pas soumis aux droits de successions de 60%, ce qui constitue un avantage fiscal indéniable. Les concubins peuvent également constituer une SCI pour acheter leur logement “conjugal” et inclure une clause de tontine. Passer par une SCI évitera de payer les 60% de droits de mutation. Mais attention toutefois à la requalification possible par l’administration fiscale en donation déguisée. Les conseils de votre notaire vous guideront et vous permettront d’éviter les faux pas.
Deux personnes suffisent pour constituer une SCI. La loi ne fixe pas de nombre maximum d’associés ni de condition de nationalité, comme dans certaines autres formes de sociétés. Il est même possible pour un mineur d’être associé dans une SCI car elle n’a pas une vocation commerciale.
L’objet social est le type d’activité que la société exerce. Pour être civile, une société doit avoir un objet civil, et ne pourra pas faire d’actes de commerce à titre principal. Il est limité à la gestion d’un patrimoine immobilier. Par exemple est considérée comme une activité civile, l’acquisition de terrains en vue de leur revente après construction . En revanche, est considérée comme une activité commerciale l’achat d’immeuble en vue de leur revente en l’état.
Sa durée doit être déterminée dans les statuts et ne peut pas excéder 99 ans.
Il s’agit d’un contrat de société qui régit son fonctionnement. Ils doivent impérativement être rédigés par écrit. Leur rédaction est assez libre mais il est important d’y insérer certaines clauses relatives par exemple à l’étendue du mandat du gérant, aux règles de majorités lors des votes en assemblée générale, de limiter parfois le droit de vote aux seuls usufruitiers, de prévoir une réglementation spécifique en cas de vente ou échange de parts, de prévoir des règles de majorité relatives aux agréments en cas d’entrée dans la société ou de sortie… Il est recommandé d’avoir recours à un professionnel du droit. Lorsque les statuts constatent l’apport d’un immeuble et chaque fois qu’il y a matière à publicité foncière, ils devront faire l’objet d’un acte authentique rédigé par un notaire.
Les associés de la SCI répondent indéfiniment aux dettes de la SCI et proportionnellement à leurs parts dans le capital social. En effet, les créanciers de la SCI peuvent se retourner contre les associés , et saisir leurs biens personnels en cas de défaillance de la société mais seulement au prorata de leurs parts. En revanche, il n’y a pas de solidarité des associés, ce qui signifie que les créanciers ne peuvent pas se retourner contre un seul associé pour la totalité de la dette.
Les apports sont constitués des biens (immeuble constituant un apport en nature, somme d’argent constituant un apport en numéraire…) dont les associés transfèrent la propriété ou la jouissance à la société, en contrepartie desquels ils reçoivent des parts sociales. Il peut s’agit aussi de compétences ou d’un travail mis au service de la société (apport en industrie). Chaque associé doit faire un apport, quelle que soit sa forme.
Lorsque la SCI dégage des bénéfices, ils sont redistribués aux associés ou mis en réserve afin de garder des ressources à la société. Si les associés ont opté pour une SCI à l’impôt sur le revenu (IR), ils doivent déclarer les revenus qu’ils aient été distribués ou pas. La SCI peut opter pour l’impôt sur les sociétés. Ce régime sera obligatoire si la SCI loue en meublé ou équipé.
Un gérant est nommé pour traiter les affaires courantes. Le gérant est désigné dans les statuts ou dans un acte annexe fixant l’étendue de ses pouvoirs. Les statuts déterminent quelles sont les décisions qui doivent être prises en assemblée et à quelle majorité (généralement, les plus importantes). Certaines décisions sont obligatoirement soumises à la décision des associés (comptes annuels, modifications statutaires, révocation du gérant…). Il est possible de désigner plusieurs gérants. Le gérant peut également avoir des missions administratives : établissement des comptes annuels, du bilan, etc. Dans une SCI familiale constituée uniquement entre parents et enfants et où les parents sont cogérants, la durée de leur mandat n'est en général pas spécifiée et cesse à leur décès ou à la fin de la durée d’existence de la SCI.
Il conviendra dans un premier temps de vous rapprocher de votre notaire pour faire établir les statuts de votre SCI et ce, afin d’éviter tout écueil, leur rédaction pouvant s’avérer délicate. Il se chargera pour vous de faire toutes les formalités nécessaires (enregistrement des statuts, publicité légale, inscription au Centre de Formalité des Entreprises…). Votre notaire sera également d’une aide professionnelle précieuse lors d’une cession de parts sociales.
Source : Notaires.fr

Servitudes d’urbanisme, d’utilité publique, de voisinage, droit de passage….
La servitude est une contrainte qui s’impose au propriétaire d’un bien (fonds servant) au profit du propriétaire d’un autre bien (fonds dominant).
1- Les servitudes et les sources du droit - Les servitudes de droit privé : elles trouvent leur source dans le Code civil : articles 637 à 710 dans un titre intitulé "Des servitudes ou services fonciers".
Les servitudes peuvent aussi être prévues par des textes spéciaux, tels : le Code de l’urbanisme, le Code rural, le Code forestier… - Les servitudes d’urbanisme qui sont des limitations administratives au droit de propriété trouvent leur fondement dans le Code de l’urbanisme aux articles L 112-1 à 17 et leur partie règlementaire. Elles peuvent être instituées dans un périmètre de protection des biens et des personnes « en dehors des zones couvertes par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. » - Les servitudes d’utilité publique (SUP) ne trouvent pas leur fondement dans le Code de l’urbanisme, mais sont instituées par des lois ou règlements particuliers d’intérêt général. Le Code de l’urbanisme les cite pour préciser que les plans locaux d’urbanisme (article 1151-43) et la carte communale (article L161-1) doivent les prévoir en annexe lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’occupation des sols. Ces servitudes publiques figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat. Bon à savoir : le Portail national de l’urbanisme dit « Géoportail de l’urbanisme » permet de rassembler et rendre accessibles l'ensemble des documents d’urbanisme qui réglementent les droits d'aménager et de construire. Ces documents sont versés progressivement dans le Géoportail par les autorités compétentes (collectivités locales, Etat, gestionnaire de SUP). Si le document d’urbanisme n’est pas encore déposé sur ce site, il est consultable sur le site de la mairie ou intercommunalité. - Les servitudes en matière de droit rural des articles L152-1 à 23 du Code rural sont insérées dans le titre « Les équipements et les travaux de mise en valeur ». - Les servitudes de voirie et obligations de débroussaillement communes aux territoires, bois et forêts exposés aux risques d'incendie sont insérées dans les articles L134-1 à 18 du Code forestier.
2- Servitude active et passive
La servitude est dite active pour le propriétaire du fonds bénéficiaire et passive pour le propriétaire du fonds qui la supporte.
Exception à la notion de fonds dominant et fonds servant : en matière de servitude d’utilité publique, la notion de fond dominant et de fond servant n’existe pas, puisque celle-ci frappe uniquement un immeuble dans un intérêt public en application d’un texte légal. Exemples : les servitudes de halage et de marchepied le long des cours d’eau domaniaux, les servitudes de passage piétonnier le long du littoral, les servitudes de passage des pistes de ski ou celles relatives aux remontées mécaniques, et surtout celles dont bénéficient les services de distribution : eau, gaz, électricité et télécommunication...
Les immeubles pouvant être grevés d’une servitude L’article 637 du Code civil définit la servitude comme « une charge imposée sur un héritage ». Le terme héritage en ancien droit désigne toute propriété immobilière privée. Une servitude, au sens de l’article 637 du Code civil peut donc s’établir sur un immeuble bâti ou non bâti faisant l’objet d’une propriété privée, mais également sur les immeubles dépendant du domaine privé de l’Etat ou des collectivités locales.
Toutefois, l'article 2122-4 du Code Général de la propriété des personnes publiques permet aux propriétaires d’établir des servitudes par conventions conformément à l’article 639 du Code civil sur les biens du domaine public. L’existence de ces servitudes doit être compatible avec l’affectation des biens sur lesquels elles s’exercent.
3- Les différentes formes de servitudes
L’article 688 du Code civil distingue les servitudes continues et discontinues : - Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin d’une intervention humaine. (Exemples : une conduite d’eau, un égout, une vue…). - Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin de l’intervention de l’homme pour être exercées. (Exemples : le droit de passage, le droit de puisage, le pacage…).
L’article 689 du Code civil distingue les servitudes apparentes et non apparentes. - Les servitudes apparentes sont visibles grâce à la présence d’un ouvrage extérieur. (Exemple : une conduite d’eau apparente…). - Les servitudes non apparentes ou occultes sont celles qui n’ont pas de signes extérieurs de leur existence et qui sont invisibles. (Exemple : l’interdiction de construire…).
4- Comment établir une servitude ?
La servitude constitue un droit réel immobilier accessoire au droit de de propriété : elle est donc attachée au bien et non à la personne du propriétaire. Il est nécessaire, en cas de vente que l’acquéreur soit informé des servitudes existant sur le bien et, à plus forte raison, s’il s’agit d’une servitude passive qui déprécie la valeur du bien (articles 690 à 696 du Code civil).
ll est fortement déconseillé de constituer une servitude par acte sous signatures privées. En effet rien ne pourra garantir qu'elle sera connue des propriétaires successifs. Sa rédaction par votre notaire dans le cadre d'un acte authentique notarié et sa mention au Service de la publicité foncière assureront de façon certaine sa transmission et sa connaissance lors de toutes les mutations immobilières. Le notaire chargé de la vente pourra alors vérifier les servitudes conventionnelles inscrites dans les titres antérieurs. S’agissant des servitudes d’urbanisme, il prendra connaissance des documents d’urbanisme relatifs au bien, via notamment, le portail national « Géoportail de l’urbanisme ».
Les servitudes s'établissent de trois façons :
a- Par titre, c'est à dire par convention amiable entre voisins. L'étendue et les modalités d'exercice des servitudes conventionnelles sont définitivement fixées par le titre qui les institue et ne peuvent être modifiées que d'un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant.
b- Par prescription trentenaire, mais ce mode ne peut viser que les servitudes continues et apparentes (Article 690 du Code civil). Exemple : servitude de vue.
c- Par destination du père de famille lorsqu'il existe à la date de division d'une propriété un ouvrage permanent et apparent, signe d'une servitude (par exemple un chemin empierré) et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
Droits et obligations des propriétaires : - Le propriétaire du fonds servant doit avoir une attitude purement passive : il doit laisser la servitude s'exercer sans y apporter d'entrave. (Article 701 du Code civil) - Le propriétaire du fonds bénéficiaire de la servitude ne doit rien faire qui aggrave la situation du fonds servant. (Article 702 du code civil)
Servitudes perpétuelles ou temporaires ?
On dit qu'une servitude présente un caractère réel parce qu'elle est attachée à la propriété dont elle constitue l'accessoire et qu'en conséquence, tous les propriétaires successifs vont en bénéficier ou la subir. Elle suit le fonds, en quelque main qu'il passe.
Il en résulte qu’une servitude est en principe perpétuelle, mais la jurisprudence admet que l’on puisse constituer des servitudes temporaires.
Si le bien est vendu, il le sera avec la servitude. Il est donc nécessaire que l’acquéreur en soit informé par le vendeur et que l’acte de vente mentionne les servitudes notamment conventionnelles, mais également les servitudes non apparentes dont le propriétaire a connaissance.
En effet, l’article 1638 du Code civil rend obligatoire pour le vendeur, la déclaration des servitudes non apparentes dans le contrat de vente, lorsque ces servitudes sont de telle importance que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il les avait connues. En cas de non-respect de cette obligation, l’acquéreur pourra demander, soit la résiliation du contrat, soit des dommages et intérêts. La jurisprudence a étendu l’obligation du vendeur aux servitudes non apparentes d’origine légale ou administrative telles les servitudes d’urbanisme.
5- Les catégories de servitudes
Le Code civil distingue trois grandes catégories de servitudes :
a- Les servitudes dérivant de la situation naturelle des lieux (articles 640 à 648 du Code civil). Exemples : écoulement des eaux, bornage
b- Les servitudes imposées par la loi (articles 649 à 685-1 du Code civil) Ces servitudes ont pour objet « l’utilité publique ou communale ». Ce sont les servitudes d’urbanisme et d’utilité publique vues précédemment. Exemples : les servitudes de mitoyenneté (articles 653 à 673 du Code civil), de respect de distance des constructions (article 674 du Code civil), de vues (articles 675 à 680 du Code civil), d'écoulement des eaux pluviales (article 681 du Code civil), de droit de passage en cas d’enclave (articles 682 à 685-1 du Code civil). L’article 682 reconnaît ainsi au propriétaire d’un fonds enclavé, le droit de « réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionné au dommage qu’il peut occasionner. »
c- Les servitudes conventionnelles (articles 686 à 689 du Code civil) L'article 686 du Code Civil permet aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en faveur de celles-ci, telles servitudes qu'il leur plaît, sous réserve qu'elles ne soient pas contraires à l'ordre public. Il doit toujours s'agir d'une charge imposée à un fonds. Pour pouvoir être publiée au service de la publicité foncière, la servitude doit être constituée ou modifiée par acte notarié. Ainsi elle sera opposable aux tiers, notamment aux propriétaires ultérieurs
Exemples : une convention pour l’établissement d’une servitude de passage non règlementée par la loi, c’est à dire en dehors de l’existence d’un terrain enclavé ou pour l’interdiction ou la limitation de de construire résultant d’une servitude de cour commune.
6- Comment s'éteint une servitude ?
Conformément aux articles 703 à 710 du Code civil, les servitudes s’éteignent de quatre façons :
Bas du formulaire
Source : Notaires.fr
Oui, il est possible de signer un bail d'une durée de moins de 3 ans si les 2 conditions suivantes sont remplies : - Le bail est d'au moins un an - Un événement professionnel ou familial justifie cette durée exceptionnelle. Par exemple, le propriétaire va reprendre le logement pour y habiter après sa mise à la retraite ou pour permettre à un de ses enfants de poursuivre ses études.
Attention
Le motif qui justifie la durée de bail doit être indiqué dans bail.
Durant le bail, le propriétaire doit informer le locataire de la réalisation prochaine de l'événement, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 2 mois avant l'échéance du bail: Date à laquelle expire le bail, compte tenu de la durée pour laquelle il a été signé.
Si la réalisation de l’événement est retardée, le propriétaire peut proposer le report de l'échéance du bail, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 2 mois avant l'échéance initialement prévue du bail.
Un seul report est possible.
À savoir
Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le bail est considéré comme un bail de 3 ans.

Vous souhaitez vendre ou acquérir un bien immobilier ? Avez-vous pensé à la vente en viager ? Selon votre situation, cette transaction immobilière aux modalités bien spécifiques peut présenter des avantages. Comment fonctionne un viager ? Quels sont ses avantages ? On vous explique !
1- Le viager : qu’est-ce que c’est ?
Le viager consiste à vendre un bien immobilier à un tiers en échange du versement d'une rente viagère périodique (mensuelle, trimestrielle ou annuelle). Cette rente peut s'accompagner d'un bouquet, c'est-à-dire une somme d'argent versée comptant au moment de la signature de l'acte de vente.
Il faut distinguer deux types de vente en viager : - Le viager occupé : le vendeur cède son bien à l’acquéreur mais conserve son droit d’usage et d’habitation. Il peut donc continuer de l’occuper jusqu’à son décès. - Le viager libre : le vendeur cède son bien à l’acquéreur qui peut l’occuper dès la signature de l’acte de vente sans avoir à attendre le décès du vendeur.
Le principe d’aléa
La vente en viager repose sur le principe d’aléa. En effet, ni le vendeur ni l’acquéreur ne savent au moment de la signature de l’acte de vente pour quel montant le bien sera acquis, puisque ce montant dépend de la date du décès du vendeur. Une vente en viager dans laquelle l’aléa est absent peut être annulée. C’est notamment le cas si le vendeur, malade au moment de la signature de l’acte de vente, décède dans les 20 jours qui suivent.
2- Rente viagère : comment déterminer son montant ?
Le montant de la rente viagère est fixé dans l’acte de vente et doit prendre en compte plusieurs éléments : - La valeur foncière du bien - L’âge du vendeur - Le versement d’un bouquet et son montant -Le statut libre ou occupé du bien vendu en viager.
Par ailleurs, un bien vendu en viager occupé connait nécessairement une décote de sa valeur foncière afin de compenser la privation du droit d’usage et d’habitation subit par l’acquéreur qui court jusqu’au décès du vendeur.
3- Le viager : quels avantages ?
Les avantages du viager pour le vendeur
Le vendeur d’un bien en viager bénéficie d’une rente à vie à compter de la signature de l’acte de vente.
Par ailleurs, la rente viagère connait un régime fiscal avantageux.
Bien que soumise à l'impôt sur le revenu, la rente viagère bénéficie d’un abattement dont le montant varie selon l’âge du vendeur au moment du premier versement de la rente.
Ainsi, seule une fraction de la rente viagère est imposée, selon les modalités suivantes : - 70 % pour un premier versement à moins de 50 ans - 50 % pour un premier versement de 50 à 59 ans - 40 % pour un premier versement de 60 à 69 ans - 30 % pour un premier versement à plus de 69 ans.
Le bouquet est quant à lui exonéré d’impôt.
Enfin, le vendeur n'a pas à s’acquitter de la taxe foncière ni des travaux votés par le syndic de l’immeuble, par exemple, même s’il continue d’occuper le bien.
En revanche, s’il occupe le bien, le vendeur continue de s’acquitter de la taxe d’habitation.
4- Les avantages du viager pour l’acheteur
Pour l’acheteur, le viager présente l’avantage de pouvoir échelonner son paiement grâce à la rente viagère, dont le fonctionnement est similaire à celui d’un crédit, sauf qu’il en est redevable auprès du vendeur et non d’une banque et qu’en conséquence aucun frais ne s’y attache.
La rente viagère étant soumise à l’aléa que constitue la date de décès du vendeur, il n’y a en revanche aucun moyen de prédire une bonne affaire financière. En résumé, le viager peut potentiellement présenter l’avantage d’acquérir un bien à un prix inférieur à sa valeur réelle, tout comme il peut conduire à acheter le bien à un montant supérieur.
5- Le viager : comment se faire accompagner ?
Comme pour la vente de tout bien immobilier, il est indispensable de se faire accompagner d’un notaire afin de vendre un bien en viager. En effet, la signature de l’acte de vente du bien se fait nécessairement en présence d’un notaire.
Indispensable à la transaction viagère, le notaire saura par ailleurs vous aiguiller pour déterminer le montant du bouquet et de la rente, sans pour autant exclure une négociation entre vendeur et acheteur à ce sujet.
Source : Par Bercy Infos